Le coin de Meskellil
-
Féminisme et différence: les dangers.../Partie II
- Par Meskellil
- Le 09/10/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 0 commentaire
Féminisme et différence : les dangers d’écrire en tant que femme sur les femmes en Algérie
Marnia Lazreg
Traduction de Christine Laugier
p. 73-105 -
Féminisme et différence: les dangers.../Partie I
- Par Meskellil
- Le 11/09/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 3 commentaires
Partie I
Cette étude, ce regard, ce point de vue tranchent avec ce que l'on a l'habitude d'entendre, de lire sur le féminisme, et se propose de battre en brèche, de déconstruire tous les discours, écrits ayant pour thématique le féminisme dans les pays musulmans, dans les pays arabes, plus spécifiquement en Algérie, faussés et enfermants qu'ils sont par des paradigmes et des concepts complètement aliénés par une vision ethnocentrique aux antipodes avec la réalité des femmes Nord-Africaines et Moyen-orientales.... C'est aussi l'occasion de répondre aux questions de l'ami Mourad.
En fait, le mieux, c'est de lire cet article si vous en avez le courage. Comme il est très long, et que le temps et la disponibilité manquent, je le propose en trois parties. Bonne lecture...
Féminisme et différence : les dangers d’écrire en tant que femme sur les femmes en AlgérieMarnia Lazreg
Traduction de Christine Laugier
p. 73-105
Cet article est la traduction de : « Feminism and Difference : The Perils of Writings As a Woman on Women in Algeria », Feminist Studiest, 14 :1 (1988 : Spring), p. 81-107.
Le désir de démanteler l’ordre existant et de le reconstruire pour le faire correspondre à ses propres besoins est au cœur du projet féministe, en Orient comme en Occident. Ce désir est parfaitement exprimé par le cri d’Omar Khayyam :- Ah l’amour ! Puissions-nous conspirer avec le Destin
- Pour comprendre la marche de ce triste monde,
- Nous le réduirions en poussière – pour alors
- Le refaire, selon les désirs de notre cœur.
Cependant, les féministes, orientales et occidentales, ne sont pas unanimes sur la façon de comprendre cette « marche du triste monde » ni sur les outils qu’il convient d’utiliser pour le « réduire en poussière ». Elles ne sont pas non plus d’accord sur le fait de savoir si un processus de reconstruction est possible ou pas. En fait, les féministes académiques occidentales ont la possibilité de redécouvrir leur féminité, de tenter de la redéfinir et de produire leur propre connaissance d’elles-mêmes. Elles ne sont entravées dans cette entreprise que par ce que beaucoup perçoivent comme la domination des hommes. En fin de compte, les féministes occidentales opèrent sur leur propre terrain social et intellectuel et elles le font selon l’hypothèse implicite que leurs sociétés sont perfectibles. Dans ce sens, la pratique critique des féministes apparaît comme normale et elle semble faire partie d’un projet raisonnable (même s’il est difficile à mener), destiné à obtenir une plus grande égalité entre les sexes.
En revanche, le projet féministe algérien et moyen-oriental se déroule au sein d’un cadre de référence qui lui est imposé de l’extérieur et se déroule selon des normes qui lui sont également imposées de l’extérieur. Dans ces conditions, la conscience de sa propre féminité correspond à la prise de conscience que, d’une façon ou d’une autre, des étrangers, des femmes aussi bien que des hommes, se sont appropriés en tant qu’experts du Moyen-Orient. Ainsi le projet féministe est-il perverti et n’apporte que très rarement la possibilité d’une libération personnelle contrairement à ce qui se passe dans notre pays ou en Europe. Les formes d’expression utilisées par les féministes algériennes se retrouvent, en fait, coincées entre trois discours qui se superposent : le discours masculin sur la différence de genre, le discours des sciences sociales sur les peuples d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient et les discours universitaires (féministes ou proto féministes) qui sont tenus sur les femmes issues de ces sociétés.
Cet article est le fruit d’une réflexion préliminaire sur la nature et la spécificité de la théorie féministe américaine et sur la quête continuelle d’une épistémologie féministe. Mes incursions dans les écrits du féminisme américain, au moment où le féminisme semble subir une crise, m’ont fait comprendre que le féminisme académique doit absolument se détacher de l’héritage philosophique et théorique qu’il a si fortement contesté. Le savoir n’est pas seulement produit au sein d’un contexte socio économique et politique mais il l’est aussi au sein d’une tradition intellectuelle faite d’hypothèses explicites et implicites. Bien qu’il remette en cause les théories traditionnelles, le féminisme académique a souvent négligé d’interroger ses propres prémisses. S’il le faisait plus régulièrement, il deviendrait évident que les catégories « traditionnelles » des sciences sociales n’ont toujours pas été modifiées mais qu’elles ont plutôt changé de sexe.
Lorsque j’ai détourné mon attention de ce qui était au centre du débat sur la théorie féministe et sur l’épistémologie et que je l’ai reportée vers sa périphérie nord-africaine et moyen orientale, j’ai remarqué trois phénomènes intéressants. En premier lieu, l’intérêt des féministes américaines pour les femmes de ces régions du monde a provoqué un afflux d’écrits, qui se sont distingués par leur relatif manque d’apport théorique. À quelques exceptions près, les femmes qui écrivent sur les femmes nord-africaines et moyen-orientales ne se disent pas féministes. Pourtant c’est le besoin d’informations du féminisme académique sur leur sujet d’étude qui légitime leur travail. Ensuite, les féministes « orientales » écrivant pour des publics occidentaux au sujet des femmes de leurs pays natals sont tellement allées dans le sens de la théorie générale implicite que cela a permis l’expansion et l’installation du savoir féministe américain mais très rarement sa remise en question. Les femmes américaines issues des minorités ont, en revanche, à maintes reprises, contesté les projets féministes académiques de diverses façons. Elles ont ainsi mis en lumière des problèmes que le savoir féministe doit traiter et résoudre avant de pouvoir se présenter comme une alternative au savoir « traditionnel ». Enfin, bien que les féministes américaines (comme leurs collègues européennes) aient cherché à définir et à se tailler un espace sur lequel ancrer leur critique, les féministes « orientales » ont simplement ajusté leur recherche afin de remplir les blancs que le libéralisme féministe américain leur a laissés dans la répartition géographique. Ces observations sur le savoir féministe, occidental et oriental, m’ont amenée à chercher les liens reliant le savoir féministe occidental au sens large au savoir établi et ce par le biais de l’étude du cas concret de l’Algérie. J’ai découvert qu’il existe une continuité entre les modalités figées et traditionnelles qui sont celles des sciences sociales dans leur appréhension des sociétés nord africaines et moyen orientales telles qu’elles existent dans l’épistémologie coloniale française et l’approche qui est celle des femmes universitaires issues de ces sociétés. Cette continuité s’exprime, par exemple, dans la prédominance du « paradigme religieux » qui accorde à cette dernière un pouvoir d’explication privilégié. La plupart des pratiques académiques féministes se placent dans la lignée de ce paradigme reproduisant, par conséquent, ses présupposés et renforçant par là même sa position dominante. Ce processus se vérifie même lorsque les féministes affirment être conscientes des faiblesses de ce paradigme
J’ai également découvert une continuité temporelle et conceptuelle entre les discours des femmes (souvent proto féministes) et les discours féministes. Ce qui a été écrit par des femmes au sujet des femmes algériennes dans la première partie de ce siècle est reproduit d’une façon ou d’une autre dans les écrits des femmes françaises contemporaines et dans ceux des féministes américaines sur ce même sujet. Plus important encore, les thèmes qui ont été définis comme étant importants par le discours colonial et néocolonial français pour comprendre les femmes algériennes sont ceux que l’on rencontre aujourd’hui dans les écrits des femmes orientales.
Dans les pages qui suivent je vais décrire certaines de ces continuités et j’indiquerai de quelle façon le poststructuralisme les affecte. J’étudierai également le problème de la nécessité d’une nouvelle évaluation du projet féministe au sein d’un cadre éthico humaniste.
Les paradigmes des sciences sociales et les paradigmes féministesL’étude des sociétés du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a été confrontée à de nombreux problèmes conceptuels et méthodologiques ce qui a incité le sociologue anglais Bryan S. Turner à dire « qu’elle est à la traîne loin derrière les études d’autres régions, à la fois en termes de théorie et de contenu ». En effet, cette étude est « sous-développée ». Les travaux de recherche sur les sociétés nord-africaines et moyen-orientales se focalisent sur l’islam en tant que sujet de recherche privilégié qu’il soit abordé en tant que religion ou en tant que culture. De nombreuses hypothèses, qui posent en réalité problème, sous-tendent l’étude de ces sociétés. Tout d’abord, l’islam est considéré comme un système de croyance indépendant et défectueux, imperméable au changement. En sociologie, cette hypothèse trouve sa justification théorique dans le travail de Max Weber. Ensuite, on part du principe que la civilisation islamique a connu un déclin et qu’elle continue de décliner. La « thèse du déclin », parfaitement illustrée par le travail de H.A.R. Gibb and Harold Bowena incité David Waines à dire que « la naissance de l’islam constitue également la genèse de son déclin ». En général, on explique en termes de retour à l’islam les tentatives des peuples indigènes pour changer leurs institutions. Le travail de Clifford Geertz illustre parfaitement ce phénomène qu’il appelle le « scripturalisme ». Enfin, on suppose que « l’islam ne peut produire un savoir scientifique sur lui-même qui soit adéquat dans la mesure où les situations politiques des sociétés islamiques excluent tout travail de recherche autonome et critique. L’islam exige de la science occidentale qu’elle produise une connaissance pertinente de la culture du monde islamique et de son organisation sociale »
Cette science est parvenue à enfermer l’étude de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient dans une sorte de ghetto intellectuel dans lequel les développements théoriques et méthodologiques qui ont traditionnellement cours dans les sciences sociales sont, en quelque sorte, condamnés à être inapplicables. Par exemple, très récemment encore, on ne pouvait parler de classes sociales au Moyen-Orient mais seulement de hiérarchies sociales ou de mosaïques de peuples. On ne peut pas non plus parler de révolution mais seulement d’agitation politique et de coups d’État. On ne peut toujours pas parler de connaissance de soi mais seulement de « connaissance locale » ou « du point de vue des autochtones ».
Même lorsque des spécialistes bien intentionnés font l’effort d’adapter des développements théoriques ou méthodologiques provenant d’autres domaines, ils finissent toujours par renforcer les vieilles hypothèses qui posent problème. Par exemple, l’attention récente accordée à la « culture populaire » nourrit la vision d’un islam divisé entre l’orthodoxe et le mystique. De la même façon, l’introduction du concept de classe dans l’étude du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord a parfois fini par faire des théologiens et/ou des membres de sectes religieuses des rebelles prolétariens.
Un survol de la littérature écrite par des femmes, qu’il s’agisse de féministes ou simplement de femmes s’intéressant aux problèmes des femmes, montre que, dans l’ensemble, ces dernières reproduisent les hypothèses discutables qui sous-tendent l’étude du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.
Le travail académique des femmes sur les femmes de ces régions est dominé par le paradigme de la religion/tradition et il se caractérise par une variante de ce que feu C. Wright Mills appela « l’empirisme abstrait » Les sujets d’étude sélectionnés sont limités par la méthode qui est choisie pour les étudier. Une fois que les chercheurs ont, par exemple, choisi une méthode fonctionnaliste/culturaliste, ils ne sont plus en mesure de traiter d’autre chose que de la religion et de la tradition. Le résultat final est une conception réductive et anhistorique des femmes. Le fait d’insister sur le paradigme de la religion/tradition, combinaison d’hypothèses orientalistes et évolutionnistes, empêche de le critiquer en les obligeant soit à parler de ses paramètres dans le respect de la tradition ou à les subir. Le voile, l’enfermement, la pratique de l’excision sont considérés dans ce cas comme des exemples représentatifs de la tradition.
Historiquement, le voile a, bien sûr, acquis un intérêt à caractère obsessionnel pour beaucoup d’auteurs. En 1829, Charles Forster a par exemple écrit Mohammetanism Unveiled et en 1967, le révolutionnaire Franz Fanon écrivit au sujet des femmes algériennes sous le titre : Algeria Unveiled. Même la colère suscitée par cette imagerie injurieuse ne parvient pas à diminuer la fascination qu’elle exerce comme le prouve le titre du livre écrit par une féministe marocaine : Beyond the Veil. La persistance du voile en tant que symbole essentiellement représentatif des femmes illustre bien la difficulté rencontrée par les chercheurs lorsqu’ils ont à faire à une réalité qui ne leur est pas familière. Elle révèle également une attitude de méfiance. Le voile permet de cacher ; il éveille les soupçons. Par ailleurs, le fait de se voiler est proche du port d’un masque ce qui induit que le fait d’étudier les femmes issues de ces sociétés où le voile existe constitue une forme de théâtre ! Certaines féministes de ces régions du monde (l’Orient) ont poussé l’imagerie théâtrale encore plus loin en faisant du voile une partie intégrante de la personne de la femme.
La tendance évolutionniste qui imprègne une bonne partie des réflexions sur les femmes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord s’exprime à travers un préjugé radical contre l’islam en tant que religion. Bien que les féministes américaines aient tenté de concilier christianisme et féminisme ainsi que judaïsme et féminisme, l’islam est immanquablement présenté comme antiféministe. Ce qui opère ici n’est pas une simple tendance rationaliste contre la religion en tant qu’obstacle au progrès et à la liberté de pensée. Ce qui se manifeste ici c’est l’acceptation de l’idée qu’une hiérarchie des religions existe, certaines étant plus susceptibles de changer que d’autres. De même que la tradition, la religion doit être abandonnée pour que les femmes du Moyen-Orient ressemblent aux femmes occidentales. Dans cette logique, aucun changement n’est possible sans référence à une norme venue de l’extérieur, norme que l’on juge parfaite.
Bien que dans les sociétés occidentales, la religion soit considérée comme une institution parmi d’autres, elle est perçue comme le fondement des sociétés dans celles où on pratique l’islam. On a pris l’habitude de voir l’auteur utiliser la religion comme la cause de l’inégalité de genre tout comme on en avait fait la source du sous-développement dans la théorie de modernisation. De façon étrange, le discours féministe sur les femmes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord reflète l’interprétation propre aux théologiens au sujet des femmes dans l’islam. Les féministes universitaires ont aggravé cette situation en y ajoutant leurs propres définitions équivoques. Elles ont réduit l’islam à une ou deux sourates ou injonctions telles que celles ayant trait à la hiérarchie des genres et au châtiment des femmes adultères (qui s’applique également aux hommes).
Ce paradigme finit par priver les femmes d’une existence propre, d’un être. C’est parce qu’on subsume les femmes sous la religion présentée comme fondamentaliste qu’on les considère comme évoluant dans un temps ahistorique. Elles n’ont littéralement pas d’histoire. Toute analyse du changement est donc impossible. Lorsque les féministes « font » l’histoire, on a le sentiment qu’elles participent à une contre- histoire dans laquelle le progrès se mesure en termes de compte à rebours vers l’époque où tout a commencé et où tout a commencé à être élucidé. C’est-à-dire l’époque du Coran pour l’auteur féminin tout comme il s’agit du temps du Coran et des traditions pour l’auteur masculin. Cette focalisation tenace sur la religion qui est présente dans les travaux sur les femmes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord fait penser à la place du feu détenteur d’une fonction équivalente dans la mythologie et dans la première pensée scientifique. Une obsession/ fascination similaire pour le mystérieux pouvoir du feu a dominé l’esprit « primitif » tout comme l’esprit « scientifique » jusqu’à la fin du dix-huitième siècle.
La question qu’il nous faut à présent poser est la suivante : pourquoi le féminisme académique n’a-t’il pas dénoncé les faiblesses du discours dominant sur les femmes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord ? Des articles, des préfaces et même des anthologies ont dénoncé ce qu’Elisabeth Fernea et B.Q. Bezirgan ont baptisé les « écrits astigmatiques » sur les femmes du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. Certains travaux ont tenté de prendre leur distance par rapport au paradigme dominant – bien qu’ils n’aient pas réussi à le déplacer. Il est également important de rappeler que les paradigmes en concurrence sont « incommensurables » dans la mesure où les critères permettant de juger leurs mérites respectifs ne sont pas déterminés par des règles de valeur neutre mais sont l’œuvre de la communauté de spécialistes dont « l’expertise » a produit de l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient en tant que domaine de connaissance. Pourtant, aucun effort soutenu n’a été fait pour contester les présupposés épistémologiques et théoriques de la plupart des travaux sur les femmes.
La différence, en général, qu’elle soit culturelle, ethnique ou raciale a constitué un véritable obstacle pour les sciences sociales occidentales et ce, dès leurs débuts. L’ethnologie et l’anthropologie européennes du dix-neuvième siècle ont précisément été créées pour étudier les peuples différents et leurs institutions. Cependant, sans tenir compte des inadéquations et des approximations conceptuelles, théoriques et méthodologiques présentes dans les travaux de beaucoup d’anthropologues et d’ethnologues classiques, l’intérêt qu’ils manifestaient pour la « différence » ne constituait en fait qu’un outil leur permettant de mieux comprendre leurs propres institutions. Ce fut le cas du travail d’Émile Durkheim sur la religion, de celui de Marcel Mauss sur l’échange et de celui de Bronislaw Malinowski sur le complexe d’Œdipe pour n’en citer que quelques-uns. Bien que mon intention ne soit pas d’absoudre l’anthropologie occidentale de son eurocentrisme, il faut reconnaître qu’elle montra, dès son origine, une certaine capacité à identifier le dénominateur commun qui existe entre les peuples de cultures différentes, un lien humain. Les notions d’« universalisme culturel » ou de « pensée humaine », quoique problématiques, sont l’expression de ce lien commun existant entre les différents peuples.
Le féminisme académique contemporain semble avoir oublié cette partie de son héritage intellectuel. Bien sûr, le fait d’opposer les recherches féministes aux sciences sociales peut sembler sans intérêt. Les scientifiques femmes en sciences sociales ne font-elles pas partie de la même communauté et du même milieu intellectuel que leurs collègues hommes ? C’est évidemment le cas. Mais les féministes académiques ont généralement dénoncé les sciences sociales conventionnelles en raison de leurs perspectives concernant les femmes tant du point de vue théorique qu’empirique. Elles ont, en particulier, montré que ces sciences ont réduit la vie des femmes à une seule dimension (la reproduction et le travail domestique) et qu’elles ont échoué dans la conceptualisation de leur statut dans la société, en tant que statut évoluant historiquement. Le féminisme académique a donc apporté un bol d’air frais dans le discours des sciences sociales sur les femmes et a tenu la promesse d’une pratique plus impartiale et plus neutre. Il est donc surprenant de constater que les femmes algériennes sont traitées d’une façon dont les féministes académiques ne souhaitent pas être traitées.
En Algérie, on subsume les femmes sous l’expression, qui est loin d’être neutre, de « femmes islamiques », de « femmes arabes » ou de « femmes du Moyen-Orient ». Parce que le langage produit la réalité qu’il nomme, les « femmes islamiques » doivent être rendues conformes à la configuration des significations que l’on associe au concept d’islam. Les termes qui les désignent expriment ce qui devrait être considéré comme un problème. Le fait de savoir si les « femmes islamiques » sont vraiment dévotes ou si les sociétés dans lesquelles elles vivent sont des théocraties, sont des questions sur lesquelles, de fait, par cette façon de les désigner, on ne s’attarde pas.
Le parti-pris de ce discours sur la différence devient grotesque si nous renversons ses termes et si nous suggérons, par exemple, que les femmes de l’Europe contemporaine et de l’Amérique du Nord devraient être étudiées en tant que femmes chrétiennes ! De la même façon, l’étiquette « femmes du Moyen-Orient » lorsqu’on l’oppose à l’étiquette « femmes européennes », révèle son caractère trop généralisant. Le Moyen-Orient est une région géographique couvrant pas moins de vingt pays (si on le limite à l’Orient « arabe »). Ces pays montrent quelques similitudes mais aussi beaucoup de différences. Les féministes qui étudiaient les femmes à l’époque de l’Angleterre victorienne ou de la Révolution française ne se permettent pas, en tout cas peu le font, de subsumer les femmes françaises ou anglaises ou de type européen en tant que catégories de pensée sous l’étiquette très générale de « femmes européennes ». Pourtant, un livre sur les femmes égyptiennes a été intitulé « Femmes du monde arabe ». Michel Foucault avait peut-être raison lorsqu’il affirmait que « le savoir n’est pas fait pour comprendre ; il est fait pour trancher ».
Il existe une grande continuité dans la façon dont les féministes américaines traitent de la différence au sein du genre tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la société américaine. Dans chaque cas, un attribut, soit physique (race ou couleur) soit culturel (religion ou ethnie) est utilisé dans un sens ontologique. Il faut, cependant, ajouter un élément aux modes de représentation des femmes issues d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient utilisés par les féministes. Ces modes de représentation sont le reflet des dynamiques des politiques mondiales. Les attitudes politiques des États du « centre » se retrouvent dans les attitudes des féministes envers les femmes des États de la « périphérie ». Elly Bulkin remarque avec raison que « les vies des femmes et l’oppression des femmes ne peuvent être considérées en dehors des limites des conflits régionaux ». Elle insiste sur le fait que les femmes arabes sont représentées comme étant tellement différentes qu’on les considère incapables de comprendre ou de développer une quelconque forme de féminisme. Lorsque les femmes arabes parlent en leur nom, on les accuse d’être les « marionnettes des hommes arabes ». Ceci implique qu’une femme arabe ne peut être féministe (quel que soit le sens de ce terme) avant de se dissocier des hommes arabes et de la culture qui soutient ces derniers ! En fin de compte, les politiques mondiales viennent se joindre aux préjugés fermant ainsi le cercle gynocentrique occidental qui s’est construit sur la base d’une mauvaise appréhension de la différence.
La quête du sensationnel et du primitif de la part de nombreuses féministes illustre parfaitement l’orientation politique de ces représentations. Cette quête de ce qui n’est pas recommandable, quête qui renforce la notion de différence dans le sens d’une altérité objectivée, s’effectue souvent avec l’aide des femmes du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord elles-mêmes. Le féminisme a fourni à ces femmes un espace d’expression et une occasion de se décharger de leur colère envers leurs sociétés. L’exercice de la liberté d’expression fait souvent tourner la tête des gens et finit par se transformer en confession personnelle en guise de critique sociale. Les femmes de ces régions, prises individuellement, apparaissent dans le cadre du féminisme comme représentatives des millions de femmes de leurs sociétés. Jusqu’à quel point font-elles violence aux femmes au sujet desquelles elles réclament le droit d’écrire et de parler ? Voilà une question que l’on se pose bien rarement.
Dans son analyse du problème posé par le fait d’écrire sur les femmes du tiers-monde, Gayatri C. Spivak fait remarquer que les femmes du premier-monde et les femmes formées en Occident sont complices de la « dégradation » continue de l’image des femmes du tiers-monde dont elles interprètent la « micrologie » sans y avoir accès. Même bien compris, ce point de vue occulte le fait que la complicité est en général un acte conscient qui mobilise le statut social, l’identification psychologique et les intérêts matériels. Bien entendu, le fait d’inclure dans le « nous » pluriel toutes les femmes « formées en Occident » ainsi que toutes les femmes du « premier monde », constitue une simplification grossière de ce qu’est réellement, sur le terrain du féminisme, la rencontre entre les femmes occidentales et celles qui ne le sont pas. Malheureusement, la pratique féministe académique tout comme celle de ses prédécesseurs intellectuels n’est pas parfaite. Je refuse, pour ma part, d’être identifiée, même métaphoriquement, à Senanayak, l’anti-héros indien qui met son expertise au service de la répression de la révolution incarnée par Dopti, femme révolutionnaire. Il ne suffit pas d’affirmer l’existence d’une complicité. En effet, l’acte lui-même de traduction de cette nouvelle indienne pour un public américain n’a pas permis de combler le fossé de la différence culturelle. Cela va dans le sens de ce que Gaston Bachelard a appelé « le musée des horreurs ». Cette nouvelle fait la liste des actes crapuleux commis par les hommes indiens et dresse un tableau de la persécution des femmes indiennes. Le fait d’associer les lectrices occidentales et non occidentales au processus de victimisation est une façon originale de réduire le clivage existant mais pas de le gommer. C’est précisément là que réside le dilemme des femmes du tiers-monde écrivant sur les femmes du tiers-monde. -
Estrellas del Bicentenario
- Par algermiliana
- Le 08/08/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 6 commentaires
Une vidéo « Estrellas del Bicentenario, Les Étoiles du Bicentenaire », issue d’un projet télévisuel pour la célébration en 2010 du bicentenaire de l’indépendance du Mexique vis-à-vis de l’Espagne (déclarée en 1816), et aussi du centenaire de la révolution (1910) contre la dictature de Porfirio Díaz qui s’est progressivement enfoncée dans un système féodal quasi esclavagiste pour la majorité des paysans et surtout les indiens. Pancho Villa et ses hommes se sont soulevés contre l’oppresseur au Nord, Emiliano Zapata et ses hommes au sud. Les festivités ont consisté en une série d’événements culturels ayant pour vocation la remémoration des éléments fondateurs du pays pour une meilleure compréhension des valeurs et idéaux du Mexique d’aujourd’hui.
Tous les lieux de la vidéo se trouvent au Mexique. La faune et la flore sont exclusivement mexicaines aussi. Des images somptueuses, filmées au ralenti, dégagent une impression d’irréel, un monde mystique, fantastique, initiatique. Une relation éthologique douce avec la nature, les animaux. Une beauté naturelle saisissante, une biodiversité resplendissante, une musique inspirée des langues originelles des diverses ethnies. Une invitation à la méditation, à la communion, à l’humilité face au Beau, face au grandiose…
Il y en a pour tous les goûts ou presque : version longue pour ceux qui veulent s’installer et se laisser porter, version très courte (que je trouve assez brutale sur la fin), pour ceux qui manquent de temps et qui veulent passer en vitesse.
-
"Vacances! الزيّارة"
- Par algermiliana
- Le 27/07/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 3 commentaires
Trois mondes, Deux points de vue, Trois espaces en convergence vers Un Espace Commun
Un petit bijou que ce sketch, comme on n’en fait plus, et qui ne manquera pas, si regardé jusqu’au bout, de rappeler à quelques-uns ces moments doux vécus dans ces grandes maisons habitées par plusieurs familles, qui n’en formaient plus qu’une finalement, et qui partageaient El Mlih wa Douni.
Monde des hommes, monde des femmes, mondes des enfants. Irréductibles les uns aux autres, peu perméables, ce qui occasionne incompréhensions, malentendus et frustrations de part et d’autre, alors que chaque partie est de bonne foi. Les acteurs et actrices de chaque monde jouant au mieux les rôles qui leur sont attribués. Très complexes et parfois très compliqués.
Pourtant, tout peut être bousculé lorsque la rupture occasionnée par un réveil tardif, survient et sème le « désordre ». Elle finit à la fin, par amener ces acteurs et actrices à voir, à percevoir, à comprendre avec plus de clarté le monde dans lequel évolue l’autre homme, femme, enfant, débarrassés qu’ils sont de leurs costumes de scène.
La rupture comme perte momentanée de repères établis, comme déclencheur d’une communication naturelle, sincère, attentive, attentionnée, compréhensive débarrassée des représentations, des caricatures, et des méfiances. Un espace alternatif où hommes, femmes, et enfants se retrouvent enfin pour contribuer à cette entreprise commune qui séduit tout le monde, partir en vacances.
-
Décalages
- Par Meskellil
- Le 11/06/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 2 commentaires

Réveil matinal. Nuit relativement calme. Sensation diffuse mais persistante de décalage qui tourne en boucle, me colle à la peau. Depuis quand déjà ?
J’ai un truc urgent à faire dès ce matin… Je déjeunerai après…
Les clés de la voiture, les papiers, le GPS, précieux compagnon quoi que pas toujours utile. Je prends l’ascenseur qui se meut lourdement, blasé par ces va-et-vient permanents. J’aurais pu prendre les escaliers tout de même! …
Tout est vert dehors. Les arbres n’ont pas encore atteint leur pleine maturité, ils prennent leur temps pour s’épanouir... Pâquerettes, boutons d’or…, plus de violettes, dommage, c’est fini. Boutons d’or ? Tiens ! C’est nouveau ! Une toile immense verte parsemée de tâches blanches et jaunes. Un vrai ravissement ! Une brise intérieure tiède, légère, douce, traverse mon être. Il pleut… Le soleil chaud, bienfaisant me manque…, il aurait donné un éclat exceptionnel à ce magnifique tableau…
Quelques marches et me voilà devant l’entrée du parking souterrain collectif. L’esprit vaporeux, inconsistant, immatériel, flottant… j’ouvre la première porte qui donne sur une sorte de sas. Je change de clé, ouvre la seconde porte… Parfaitement grotesque, injustifiée cette frénésie à vouloir se barricader, barricader ses biens, s’y accrocher désespérément, comme à un fétu de paille dans une mer houleuse… se barricader contre qui, contre quoi ? Complètement absurde ! Déphasage total !
J’arrive au garage, une odeur familière de gasoil me prend à la gorge. Désagréable. Il aurait besoin d’être nettoyé à coups de Karcher ce parking ! Tiens ! Ça me rappelle quelqu’un ! « Descends là que je te casse la gueule » avait-il vociféré!
C’est le weekend, le parking est plein à craquer de voitures. Il faudra plusieurs manœuvres pour en sortir…
Je monte dans la voiture, me demande si le moteur est en phase, je tourne la clé. Il me répond joyeusement ! Bingo ! La radio réglée sur Nostalgie la dernière fois se met en marche aussi. Pierre Bachelet crie avec une impuissance poignante, infinie « et moi je suis tombé en esclavage… ».
L’esprit toujours dispersé, insaisissable, je prends la route familière. Tout est là, bien en place, bien en ordre, propre, rectiligne. L’ordre aseptisé aujourd’hui, le désordre grouillant et indiscipliné hier! Excessifs l’un comme l’autre! Décalage encore spatial, temporel…
Je finis de faire ce que j’avais à faire, et me dirige vers une grande surface, un véritable monstre. Ça vient d’ouvrir. Quelques victimes sont déjà là profitant de l’aubaine si rare d’un lieu de haute consommation presque désert, habituellement débordant, repu de gens et de victuailles, jusqu’à la nausée, jusqu’à l’épuisement. Je réalise que j’en fais partie puisque je suis là… Je m’arrête…
J’ai envie de jus d’orange frais ! Je m’enfonce dans une débauche de lumières artificielles, froides, agressives… Mon soleil n’est plus. Il m’a lâchée à moins que ce soit moi qui l’ai lâché… Pulsion, phasage hier, déphasage aujourd’hui… Fin de cycle…Un nouveau commence plus complexe, incertain, inédit...
Je passe par le rayon des fleurs. Promotion – 40% sur les brins de muguet porte-bonheur. Je cède à la tentation comme à la tradition d’offrir des brins de muguet. Je me fais plaisir et m’en offre deux. Ils sentent divinement bons. A nouveau je me sens en phase, et ressens cette tiédeur agréable palpitante se répandre en moi. Mon esprit me rejoint. Je suis bien. L’instant de cette fragrance printanière pleine, tonique, pétillante. L’éphémère se prolonge, mais sans l’enchantement de la première fois. Je passe en caisse puis quitte rapidement ce lieu.
J’ai envie de croissants chauds. Je vais à la boulangerie du coin. Là aussi promotion. Pour trois croissants achetés, le quatrième est offert. C’est la toute première fournée du matin. A peine tiède. Tant pis. Distraite, je le suis. La vendeuse me sourit poliment et me fait répéter ma commande. J’ai l’impression de hurler « Six croissants s’il vous plait ». La vendeuse qui est là depuis longtemps a perdu son entrain et sa joie de vivre légendaire avec le changement de propriétaire. Elle avait des échanges personnalisés avec tous les clients, et avait pour chacune et chacun une attention particulière, un mot gentil. Les échanges se sont réduits au strictement utile, vendre. Je lui tends l’argent. Elle me rappelle que c’est la machine qui encaisse et rend la monnaie. Je l’oublie toujours. Décadence et déshumanisation. Décalage perpétuel éprouvant. La vendeuse grimace un sourire. Une ombre assombrit son regard, et me contamine.
Je repars vers le parking. Tant d’espace ! Non, les gens n’étaient pas allés à la manif du 1er mai, les revendications, ce sont les autres qui les font. De toute façon, ça ne sert à rien ! Résignés, fatalistes. Tiens, j’ai déjà vécu ça, seulement hier ! Les jours et les propos se ressemblent dans un monde où tout s’achète et tout se vend, y compris son âme ! Les gens se nourrissent, se gavent à leur télé ou à leur ordi, du Fast Food en continu. Question d’optique…
L’esprit imprégné d’un certain désordre -qu’est-ce qu’on prend vite le pli, el welf kif sahel!- je grille allègrement stops et sens interdits. Ce n’est qu’un immense parking clairsemé de voitures après tout ! Je reprends la route du retour, l’esprit toujours en vogue, « Opération déstockage de matelas Haut de Gamme le 1er, le 2, et le 3 mai » lis-je sur une pancarte opportuniste. Le message s’insinue sournoisement dans mon esprit. Et si je changeais de matelas ? Mais de quoi, le matelas ? Il est très bien mon matelas ! « Souviens-toi, c’était un jeudi… », Joe Dassin chantant sur Radio Nostalgie. En phase, je fredonne le refrain à l’unisson avec lui, entre dans son histoire, l’esprit à nouveau vagabond…
J’arrive presque lorsque je vois, bonheur absolu, des lilas en fleurs. Ils sont là, libres, accessibles, offerts aux sens. Aucune clôture ne les enferme. Ils sont à tous. Pour l’instant! Harmonie parfaite. Je m’arrête, m’en approche, le cœur et l’esprit aériens. Je fourre mon nez dans les grappes et commence à les humer longuement, profondément. Un parfum si subtil, si sensuel, si addictif... Grisant! Ephémère le lilas. Un mois tout au plus. Jaloux de l’authenticité de son parfum, au même titre que le muguet encore plus fugace. Tous deux refusent catégoriquement de se livrer aux parfumeurs, les contraignant aux compositions de synthèse. Belle résistance…
Enfin, j’arrive, les bras chargés de fleurs, de croissants et de jus d’orange frais. Je mets en route la cafetière, mets les lilas dans un grand vase, le muguet dans un autre plus petit, les croissants au four pour les chauffer. Le café fume et exhale son arôme irrésistible ! Je me mets à table et déguste le jus, le café, les croissants, les fleurs aussi. Un moment de plaisir, de bien-être simple mais intense. Je me sens bien, si bien, phasage total…Tout comme hier sur le banc d'un jardin sous ces grands et beaux arbres.
Phasage, déphasage ? Et si c’était simplement une question de regard, d’écoute, de réceptivité, de compréhension, d’ouverture, de confiance, de disponibilité, d’attention, de sincérité, de spontanéité.... -
Sens, Contresens et Non Sens
- Par Meskellil
- Le 01/06/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 6 commentaires
Il est des mots qui ouvrent à la vie, qui donnent la vie, il est des mots qui étouffent la vie, qui tuent la vie. Il est dit que « Là où la vie est authentique, la tension existe toujours ». Les mots ne sont bien entendu pas neutres, mais situés socialement. Et dans un texte écrit donné, le sens n’est pas donné une bonne fois pour toutes, il n’est pas univoque. Un texte est construit ou plutôt reconstruit par l’interprétation, les interprétations qui peuvent en être faites en fonction de la manière dont cela résonne en chacun, selon les représentations qu’il a de lui-même, de son environnement social, culturel…,de son histoire de vie, de ses expériences, de ses connaissances…, du monde dans lequel il vit et de la manière dont il le perçoit. Les interprétations sont inévitables, et chacun interprète selon ce qu’il est. C’est là que réside tout l’intérêt, toute la richesse d’une communication. Dans un écrit, le sens n’est pas incorporé dans le mot. Chaque expression dépend de l’usage qui en est fait et de son interprétation. Comment pourrait-on sinon expliquer autrement les changements dans le sens d’un mot, ou les controverses entre les personnes qui lisent ces mots, les interprètes ?
La pensée trouve à s’exprimer par le langage qui n’est pas seulement outil de communication, mais aussi outil de réflexion. Dans l’expression de cette pensée intervient aussi un langage inscrit profondément en chacun, et qui est celui des représentations mentales, des constructions mentales, des images mentales. Lorsqu’on lit un roman, on se représente les personnages, leurs actions, les décors. De la même manière, les images matérielles que sont les dessins, peintures, photographies sont des traductions externes de l’imagerie interne. Des constructions subjectives propres à chaque personne.
À cet égard, le but de la communication n’est-il pas de réussir à mieux se comprendre ? Lorsque nous communiquons, nous sommes persuadés que ce que nous disons est compris tel que nous l’avons exprimé par les autres, de même que les autres sont persuadés que ce qu’ils ont compris est exactement ce que nous leur avons dit ! Pourtant, la réalité est bien différente pour chacun !
Peut-on éviter les interprétations d’un mot, d’un texte, d’une expression ? Oui, bien sûr ! Lorsque l’on recherche le consensus pour éviter tout achoppement, le langage devient un outil de communication neutre et indifférent aux rapports sociaux. Nous communiquons sans vraiment le faire puisque nous sommes tous d’accord ! Il ne subsiste plus aucune brèche, plus aucun espace d’interprétation ! Cela devient un langage neutre et informatif. Dans la communication consensuelle, Il n’y a plus lieu d’avoir la moindre réflexion, d’exercer la moindre critique puisque tout le monde est dans le consensus, et veille à le maintenir. Il ne subsiste plus aucune place pour une quelconque créativité !
La relation à l’autre dans tout cela ! Quelle est-elle ? Je reviens à nouveau à Carl Rogers et à ce qu’il dit concernant les trois attitudes fondamentales qui conditionnent l’entrée en relation avec l’autre :
Une compréhension empathique et exacte du cadre de références interne de l’autre avec les composantes émotionnelles et les significations qui s’y rattachent ;
Une considération positive inconditionnelle consistant à accorder une valeur positive à toutes manifestations de la personnalité de l’autre et ce, à travers une écoute attentive, dépourvue de jugement ou d’évaluation ;
Enfin, une congruence, reflet du degré d’authenticité dans la concordance entre ses propos et ses actes, l’accord entre ce que l’on ressent et son comportement manifeste.
L’empathie confirme à l’autre qu’il existe en tant que personne autonome, dotée d’une valeur propre et d’une identité.
Pour conclure ce chapitre, je dirais que les mots sont polysémiques, qu’un texte autorise une multitude de sens en fonction des représentations, des constructions, des images mentales de chacun façonnées par son contexte social, culturel, son histoire de vie, ses expériences, ses connaissances….Les mots allument la lumière dans les palais de nos cerveaux comme le dit cet auteur. Les mots peuvent nous blesser ou aussi nous aider. Les mots ne transmettent pas que des informations, mais aussi des émotions. Il est question non de « vidange émotionnelle », mais de « partage social des émotions » dont les bénéfices ne sont plus à démontrer. Nous sommes tous divers, différents, pluriels. Cette diversité, cette différence, cette pluralité devraient constituer notre force et notre richesse, et s’il y a un maître mot, une valeur maîtresse à ne jamais occulter, cela devrait être le RESPECT de l’autre à défaut de compréhension, de bienveillance, de tolérance.
Sous forme de boutade ou de caricature si on préfère, cette vidéo et son titre "Le Plaisir des Sens" (politiquement très incorrect). Surtout ne pas se laisser « piéger » par ce qui peut paraître tomber sous le sens (expression qui s’écrivait d’abord "tomber sous les sens" pour signifier "être directement perçu par les sens"). -
Clandestino/Playing For Change
- Par algermiliana
- Le 22/05/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 4 commentaires
Songs around the world
Playing For Change est un mouvement créé pour inspirer et pour relier, connecter le monde à travers et grâce à la musique.
« Clandestino » est la chanson de tous, et cette vidéo représente le cœur et l’esprit de tous ceux en quête d’un monde meilleur fait de justice, de paix, de respect, de tolérance, de fraternité et d'espoir.
-
Yahli/ Orchestre National de Barbès
- Par Meskellil
- Le 11/05/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 13 commentaires
Une chanson que je dédie à AlgerMiliana et à tous les AlgerMilianautes, aussi à toutes les Algériennes et Algériens Intra ou Extra Muros. Chacun et chacune d’entre nous y puisera ce qu’il y aura à puiser et qui lui parlera, mais que dans le positif, et encore positif. S’il n’y a rien à y puiser, il restera la chanson qui est bien agréable à écouter. Alors bonne écoute.
Bien amicalement à toutes et tous. -
Mazaar/Ali Azam
- Par algermiliana
- Le 20/04/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 2 commentaires
Mazar, chanson traditionnelle Afghane interprétée par le groupe iranien Nyaz. Juste pour se laisser transporter par l’enchantement, le bienfait, et le sentiment de paix que procurent la voix d’Ali Azam iranienne, la musique aux sonorités indiennes, et la magnifique vidéo qui les accompagne dans cette élévation.
-
Lluís Llach - Vida
- Par algermiliana
- Le 20/03/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 0 commentaire
Lluis Llach avec quatre « L », les ailes de la liberté, les ailes du rêve engagé ! Lluis Llach est un auteur compositeur interprète Catalan dont le chant d’espoir « l'Estaca (le pieu) » deviendra l'hymne catalan de résistance au fascisme de Franco. Pourchassé par l’oppression franquiste et contraint à l’exil, il n’arrêtera pas de chanter en Catalan, obstinément et toujours, la condition humaine, la vie, la liberté, l’amour, le soleil, la nuit, la mer, le vent. C’est un rêveur inspiré, sensible, généreux, parfois cinglant, jamais tragique qui aime à se définir comme le troubadour du peuple. Un rêveur des utopies, qui espère tout, qui exige tout, « nous voulons le possible pour atteindre l’impossible ». Ses influences musicales sont toutes méditerranéennes: musique grecque dans « Viatge a Itaca », musique catalane grecque et arabe dans « un pont de mar blava ». Ce « pont de mer bleue », c'est la fraternité du bassin méditerranéen, des deux côtés de la « maremar » « bressol de tots els blaus »
Ce sublime texte « VIDA » écrit et mis en musique par Lluis Llach pourrait être ressenti comme mélancolique, triste même, pourtant c’est un formidable hymne à la vie fort, beau, puissant, passionné et tranquille. Lluis Llach a cette voix ample, généreuse, chaude, qui se déploie tout en nuances, tout en souplesse sur des mélodies magistrales, des textes sensibles, puissants et bouleversants d’émotion. J’ai eu la grande chance de me trouver au bon endroit, au bon moment pour savourer un récital dans un beau théâtre aux dimensions humaines : une composition musique et textes unique, magnifique, intense ! Communion et ferveur unissaient Lluis Llach, ses musiciens et le public. Vibrant, beau, fraternel, universel en dépit de la non compréhension du Catalan. Lliuis Llach en dit : « Comme le public ne comprend pas le catalan, je passe l'examen du langage esthétique, à travers la mélodie, la voix, l'émotion ».
-
Les passantes /Georges Brassens
- Par algermiliana
- Le 16/02/2024
- Dans Le coin de Meskellil
- 4 commentaires
Pour rester dans le ton et l’air des derniers posts, cet hommage que Brassens, ce tendre poète, rend à toutes ces passantes qui traversent une vie.
Les passantes
-
Quand la musique se fait pont
- Par algermiliana
- Le 23/12/2023
- Dans Le coin de Meskellil
- 2 commentaires
_____________
Rencontre entre Rythmes Africains et Musique Classique Occidentale
Pour vous M. Mourad et pour tous ceux qui croient que mieux connaitre l’autre, l’alter ego, c’est l’enrichir et s’enrichir de lui pour entreprendre ensemble.
-
UN ILOT DE RÊVES
- Par algermiliana
- Le 18/11/2023
- Dans Le coin de Meskellil
- 3 commentaires
_____________________________
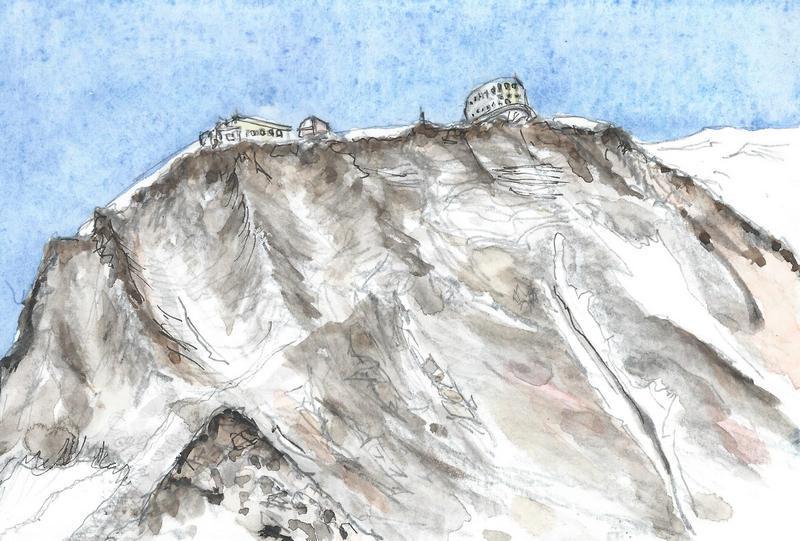
C’était un petit village niché haut, très haut dans les nuages. Aérien, inaccessible. Il fallait pour en trouver le chemin connaître l’un des villageois, même si parfois un voyageur égaré, fatigué de parcourir le monde échouait dans ce village par le plus heureux des hasards. Comme il était accueillant, chaleureux, hospitalier ce village ! La douceur de vivre qui y régnait gagnait aussi progressivement tous ceux qui ne s’y arrêtaient que pour une brève halte.
Il faut dire que ce village isolé était assez particulier ! Il y faisait beau à longueur d’année ! Le soleil brillait de son chaud éclat tous les jours, la brise y était fraîche, les sources pour se désaltérer très abondantes, l’eau était claire, cristalline, et étanchait la soif dès la première gorgée. On y trouvait des fleurs de toutes sortes partout, des arbres de toutes essences partout, des jardins luxuriants magnifiques partout ! Ce qui rehaussait son charme, son attractivité. Un havre de paix, un sanctuaire où l’on se retirait volontiers, et sans aucune résistance loin du monde tumultueux tout en bas sur terre. Les habitants ressentaient un agréable bien-être les envelopper au fur et à mesure qu’ils s’enfonçaient au cœur du village, soucis et tracas diminuaient en conséquence jusqu’à disparaitre complètement parfois. Il y régnait une douceur de vivre à nulle autre pareille. Les habitants permanents tout comme les visiteurs occasionnels goûtaient à ce bonheur nouveau avec beaucoup d’étonnement, et avaient toutes les peines du monde à imaginer leur vie ailleurs que dans ce village, et même s’ils étaient contraints par quelque obligation extérieure de le quitter, ils y revenaient dès qu’ils le pouvaient pour retrouver cet enchantement, cette impression d’échapper au temps. La renommée de ce village devenait de plus en plus grande, et la population du village augmentait au fur et à mesure en conséquence.
Les habitants, tout en étant très différents les uns des autres, et venant d’horizons très divers avaient réussi à trouver une sorte de consensus, d’entente harmonieuse qui les satisfaisaient tous. En apparence tout du moins. Respect, ouverture, tolérance, liberté d’être et d’agir dans la limite du consensus. Les villageois permanents ou de passage y trouvaient leur compte, et se complétaient assez bien dans la répartition des tâches et responsabilités. Le comité des sages qui veillait à préserver la quiétude du village intervenait non seulement pour alimenter, nourrir les membres de ce village chacun selon son appétit, mais également pour améliorer leur confort en aménageant de nouveaux et beaux espaces, en construisant de nouvelles maisons, en embellissant et fleurissant les moindres coins et recoins. Le village était tout le temps en mouvement, en vie. Le comité des sages organisait aussi rencontres et fêtes, informait de ce qu’il se passait dans le monde ce qui, et selon les nouvelles enflammait, enchantait ou attristait les cœurs et les esprits. Par moments, il pouvait bien sûr y avoir des petits accrocs, des malentendus très vite dissipés cependant grâce à la générosité des uns ou des autres, et le souci constant d’un bien-être collectif. La vie reprenait toujours son cours. Grouillante, créative, imaginative, bienheureuse. Un bonheur simple dont chacun avait fait son affaire. On l’alimentait et on s’y alimentait à son tour dans une saine et chaleureuse convivialité. C’était une sorte d’entreprise artisanale où chacun selon ce qu’il était et ce qu’il connaissait le mieux fabriquait des parcelles de bonheur, du sur mesure ou presque.
Le comité des sages laissait les villageois vivre comme ils l’entendaient à condition de se respecter les uns les autres et de respecter cette œuvre commune. Chaque jour, les villageois prenaient connaissance de la parole du jour du comité des sages. Il suggérait aux villageois d’une voix douce et tranquille des thèmes de réflexion qui participaient de la régulation de la vie dans ce village. Les villageois étaient sollicités pour une unique chose : donner un peu de soi, un peu de sa force et de son énergie pour entretenir la belle harmonie qui semblait exister dans ce village. Ce don de soi n’était pas borné par des critères ou des normes. Toute manifestation aussi modeste soit-elle, était accueillie avec joie, bienveillance, grand ouverture d’esprit. Mais alors, me direz-vous, c’était un véritable paradis, l’homme est finalement très vertueux, la preuve ! Oui ! On voudrait le croire ! On voulait le croire ! Hélas, l’être humain est aussi l’artisan de son propre malheur. L’harmonie qui régnait dans ce village pouvait voler en éclat et précipiter le village et ses habitants dans le chaos. Telle était la menace qui pesait sur ce village et ses habitants, le chaos et le néant. Tout le monde en était conscient, et tentait de faire de son mieux. Ce n’était pas facile tous les jours ! C’était un travail difficile, un effort de tous les instants, une vigilance douloureuse parfois ! Ainsi en est-il, et en a -t-il toujours été, à la grande infortune des villageois animés des meilleures intentions, du comité des sages si accueillant, si bienveillant si attentif au maintien de cette douceur de vivre.
Cette partie de l’histoire est hélas triste, bien triste, et il me coûte de l’évoquer. De plus en plus, les villageois, distraits qu’ils étaient par des considérations et des vues toutes étroites, toutes personnelles ne voyaient pas que cela pouvait faire voler en éclats l’harmonie du village. Chacun y allait de sa petite pierre qui pour certaines d’entre elles étaient de gros pavés qui occasionnaient fissures et lézardes dans les maisons individuelles, et dans tout le village, mais surtout, surtout dans le cœur du comité des sages abattu, désorienté, incrédule, hébété, profondément blessé par autant de légèreté, d’indifférence, d’égoïsme et d’ingratitude. Il est un fait que l’on ne peut en permanence prêter le flanc aux frondes, ni même fermer les yeux, serrer les dents, et continuer à sourire ! Et pourtant, et pourtant ! Le comité des sages a, en dépit de tout, décidé de passer outre, de s’effacer, de faire taire sa douleur pour tenter une fois de plus au profit du bien-être des villageois de préserver leur îlot. Le comité des sages aurait eu mille raisons de se détourner de ces villageois, de les abandonner à leur sort, il n’en a rien fait ! Et, l’on ne sait toujours pas, à ce jour, si les habitants permanents ou occasionnels du village ont réalisé que cette parcelle de poésie a failli s’évanouir, ont senti passer ce grand froid glaçant, le néant !
-
L'homme qui plantait des arbres"
- Par algermiliana
- Le 04/11/2023
- Dans Le coin de Meskellil
- 26 commentaires
-
Brève histoire du voile
- Par algermiliana
- Le 10/09/2023
- Dans Le coin de Meskellil
- 11 commentaires
_________________________________________
 Dans les années 60, majoritairement, les jeunes filles ne se voilaient. Certaines d’entre elles portaient un treillis, une casquette, une arme, et se battaient contre l’oppresseur pour faire triompher la liberté, la justice. D’autres, voilées se servaient de leurs haïks pour convoyer argent, armes et autres documents, c’était le temps de la lutte pour que triomphe une Algérie libre. Pour d’autres jeunes filles encore, c’était une fois mariée qu’elles mettaient le haïk ou pas. Nos mères, nous les avons toujours connues avec le haïk et le 3jar (voilette). Voilées ou pas, à l’intérieur de leurs foyers ou à l’extérieur, les femmes ont été présentes, engagées, actives, pour l’atteinte d’un idéal commun : vivre dans un pays libre, indépendant, juste et équitable.
Dans les années 60, majoritairement, les jeunes filles ne se voilaient. Certaines d’entre elles portaient un treillis, une casquette, une arme, et se battaient contre l’oppresseur pour faire triompher la liberté, la justice. D’autres, voilées se servaient de leurs haïks pour convoyer argent, armes et autres documents, c’était le temps de la lutte pour que triomphe une Algérie libre. Pour d’autres jeunes filles encore, c’était une fois mariée qu’elles mettaient le haïk ou pas. Nos mères, nous les avons toujours connues avec le haïk et le 3jar (voilette). Voilées ou pas, à l’intérieur de leurs foyers ou à l’extérieur, les femmes ont été présentes, engagées, actives, pour l’atteinte d’un idéal commun : vivre dans un pays libre, indépendant, juste et équitable.
Dans les années 70, beaucoup de jeunes filles qui avaient arrêté leurs études prématurément et ce, pour diverses raisons, se voilaient dès que leurs corps s’épanouissaient et suggéraient plus la femme que l’adolescente. Elles mettaient alors une gabardine (un imperméable de couleur claire généralement) et une toute petite pointe (petit foulard) assortie, et le 3jar bien sûr. C’était plutôt les parents et en particulier les pères qui imposaient ce voile qui ne couvrait ni les jambes puisque ces gabardines arrivaient juste au niveau du mollet, voire au-dessus, ni complètement les cheveux vu que les pointes en question étaient petites, tout comme les voilettes d’ailleurs. A cette époque-là, c’étaient les maris qui autorisaient ou pas leurs femmes à enlever ce voile. Parfois cela faisait partie des « Chrouts » (conditions) sur lesquelles on pouvait s’entendre avant de conclure un mariage. D’autres femmes, celles qui n’avaient pas besoin d’être affranchies par un père, un frère ou un mari, décidaient elles-mêmes de se défaire du voile. C’étaient en général des femmes divorcées ou veuves qui suscitaient la méfiance, la défiance en raison de leur statut de femmes « seules ». Bien sûr, ce n’était pas simple parce qu’elles devaient faire face à la désapprobation, parfois au dénigrement de la famille, et du voisinage.
Dans les années 80, on commençait à voir des femmes portant des hidjabs. Cela restait assez marginal. C’était encore inhabituel, et cela surprenait un peu. Parmi les femmes qui portaient le hidjab, il y en avait qui revendiquaient timidement, discrètement leur liberté de choix, leur différence. D’autres plus offensives le revendiquaient haut et fort, et multipliaient les réunions et autres assemblées pour convaincre de la pertinence d’un retour aux préceptes de l’Islam. Celles qui ne le portaient pas, encore majoritaires en ce temps-là, affirmaient quant à elle leur choix de ne pas porter ce hidjab (le problème ne se posait même pas en fait), et n’arrivaient parfois pas même à comprendre ce qui avait bien pu motiver celles qui portaient le hidjab à faire ce choix. En ce temps, les unes et les autres se lançaient des gentillesses du genre : « yal kafrine wach rahou yastenna fikoum fi djahannam, ennar takoulkoum mane 3aynikoum ! » Les autres répliquaient : « ya les 404 bâchées, ya les frustrées ! » C’était aussi l’époque du vitriol et autres agressions physiques et verbales sur celles qui ne portaient pas le hidjab qui commençait.
Dans les années 90, les femmes portant le hidjab étaient de plus en plus nombreuses. Une pression de plus en plus forte pesaient sur les autres femmes en conséquence. Beaucoup d’entre elles ont tenté de résister à cette pression, aux intimidations, aux menaces de représailles, aux représailles effectives même. Des pères, des frères, des collègues, parfois des femmes aussi, exhortaient les femmes réfractaires à porter un hidjab, à se couvrir les bras, la tête, les mollets pour être respectées, pour qu’on les laisse tranquilles, « essentri rouhek, raki bahdeltina, ou behdelti rouhek ! ». Ou alors, essentri rouhek, walla youkoutlouk ». Ces femmes, de plus en plus minoritaires ont progressivement fini par abdiquer, « choisissant » de mettre le hidjab par manque de choix ! Petit-à-petit aussi, nos mères ont également adopté le hidjab. Elles le trouvaient beaucoup plus pratique que le haïk, parce qu’il permet une plus grande aisance dans les mouvements (le haïk tel que porté non par nos grand mères était coincé dans la ceinture de leur Serouel Mdouar, ou retenu avec une Tekka (longue ceinture tricotée), ce qui libérait leurs mains. Souvent aussi, et surtout pour les femmes de la campagne, elles le faisaient tenir autour du visage en le coinçant entre leurs les dents (si, si je vous assure). Bon, il est vrai que ça ne couvrait que le menton ! Autre moyen une épingle à nourrice en dessous du menton. La manière dont les plus jeunes, portaient le haïk était plus compliquée. Une fois le haïk mis sur la tête, elles en prenaient les deux bords, les tiraient vers le haut pour le raccourcir, et mettaient le tout sous un bras qui devait rester serré pour que le haïk ne tombe pas. Pas évident d’y arriver avec un haïk glissant tout le temps ! Il faut un minimum d’expérience pour qu’il reste en place ! Avec la main de ce même bras, elles tenaient fermement le haïk sous le menton. Elles n’avaient donc qu’une main disponible pour tenir la main d’un enfant, pour tenir un couffin, un sac… Pas très pratique ! Et je comprends bien nos mères d’avoir adopté le hidjab même si je les trouvais belles avec leurs haïks en soie, leurs haïks El Mrama ! Et c’était une partie de nous-mêmes qui partait avec ce haïk. Mais là, n’est pas le propos.
Dans les années 2000, la tendance s’est inversée, les femmes sans voile minoritaires devenaient très visibles comme l’étaient les femmes vêtues d’un hidjab dans les années 80. Les toutes jeunes filles « choisissaient » librement ou pas de mettre le hidjab. Il est à noter que les espaces déjà restreints des femmes, se rétrécissaient comme une peau de chagrin. Les sorties des femmes ont toujours été et sont toujours utilitaires. Elles vont d’un point à un autre. Leurs sorties ont toujours un but : travail, courses, hammam, coiffeuse, médecin, famille, amies. Il n’est pas question d’aller flâner, de sortir faire un tour, de trainer le pas, d’avoir l’air de na pas savoir où on va. Cela s’avère tout de suite très suspect ! Mais cela n’est pas bien nouveau ! Détail intéressant par rapport aux écrits du site : ceux des abnounettes sont plutôt tournés vers des souvenirs d’intérieur, ceux des ferroukhiens plutôt d’extérieur même si parfois il y a des exceptions.
Mais, revenons au voile. Les années de plomb ont lourdement pesé sur les femmes, mais pas que, bien sûr ! Ça me fait penser à l’Espagne franquiste. Le pays avait besoin après près de 40 années de répression et de censure de vivre et de le manifester bruyamment ! La Movida (un pais que se mueve : un pays qui bouge) un mouvement collectif d’explosion de la vie, de la création, de la joie et du divertissement. Bon, je ferme la parenthèse, décidément je n’arrive pas à ne parler que du voile qui était le thème principal ! Donc, les hidjabs ont fleuri partout. Les motivations étaient diverses et variées : la foi et la conviction, la culpabilité et une sorte de rédemption, la facilité (plus besoin de se changer, de se coiffer pour sortir), l’opportunisme…. Les hidjabs étaient sombres, austères, uniformes, semblables. Cela a duré quelques années mais, c’était sans compter sur la capacité de la femme algérienne à s’adapter, à s’aménager une petite porte de sortie, à créer (même si influencée par les flots ininterrompus de séries égyptiennes qui se sont déversées dans les foyers des années durant. Certaines jeunes filles commençaient à parler couramment l’égyptien au détriment de l’algérien !), et voilà que je sors de mon thème, ah la, la !!
A l’approche des années 2010, les hidjabs tels que décrits ci-dessus n’ont pas complètement disparu, mais ils sont devenus peu nombreux. L’air était à la couleur, à la fantaisie, à la personnalisation des hidjabs. Pour d’autres femmes, les jupes ou robes ont fait leur retour, mais en version longue, les vestes aussi sont à manches longues. Pour d’autres, ce sont des pantalons et des liquettes, pour d’autres encore ce sont les mêmes tenues vestimentaires qu’avant le hidjab. Les femmes ont retrouvé une certaine coquetterie, une envie de plaire et d’abord à elles-mêmes, prenant la main pour reprendre un peu les choses en mains, ne serait-ce que sur leur apparence. Comme tout un chacun et à-fortiori les jeunes, les jeunes filles aiment la vie, ont besoin d’exister, d’être vues et reconnues. Elles sont en « conformité » avec la tendance générale de la société qui va vers plus de contrôle, mais Il semble y avoir plus de tolérance dans les choix faits par les unes et les autres. Dans quel contexte ont grandi ces jeunes filles, et qu’ont-elles connu ? Et quel projet de société leur a-t-on proposé ? C’est la génération des années 90 !! Et ça recommence, je m’éloigne du sujet, bon je reprends l’histoire du voile.
Les contextes socio-politico-économiques qui prévalaient en arrière plan de ces différentes périodes de mon histoire du voile sont volontairement tus. Je souhaitais surtout rendre hommage à la femme algérienne, la femme courage, qui a toujours su reprendre la voix qu’on a de tout temps essayé de lui confisquer, qu’on essaie toujours de lui confisquer, une voix de la résistance qui a toujours été au cœur de son combat face à ses détracteurs de tout acabit. Une voix de la résistance de tous les temps, de toutes les époques de son histoire, et de celle de l’Algérie. Cette fois-ci, je sors bel et bien du thème du voile, mais c’est volontaire ! Respect et admiration pour la femme algérienne voilée ou pas, là n’est pas la question !

