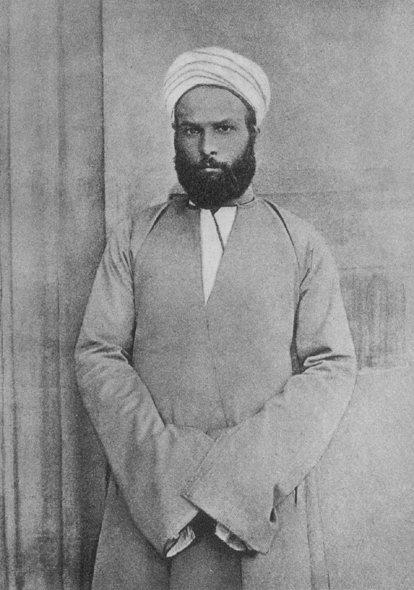Le coin de Slemnia Bendaoud
-
Entre le bar et le cimetière
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 3 commentaires
« Ici, c’est mieux qu’en face ! », annonçait discrètement le barman à ses nombreux clients presque tous apôtres de Bacchus et de l’air de la musique qui accompagne leur festin.
«Tous ceux qui reposent ici nous viennent d’en face !», lui répliquait le gardien du cimetière qui lui fait face, seul survivant et unique porte-parole de ce monde des morts, au repos forcé depuis leur venue en ces lieux calmes, tristes et bien sinistres. Ce dialogue à distance entre un monde terré dans un endroit de tout repos et un autre bien brouillant et très bruyant, lui faisant face, montre à quel niveau peut bien mener ces querelles de la vie qui n’épargnent ni les morts ni ces mots blessants pour ces êtres humains se chamaillant tout le temps, dans la perspective de squatter qui un lieu, sinon vanter, qui un quelconque espace. Dans Alger de l’époque coloniale existait un quartier qui portait le nom de Saint-Eugène ayant, depuis l’indépendance de l’Algérie, été rebaptisé Bologhine Ibnou Ziri.
La rue Abdelkader Ziari qui le traverse d’est en ouest met face à face le cimetière chrétien de la ville avec ce fameux stade de l’ASSE, truffée à l’époque de ses stars et renvoyant vers le cimetière, le dimanche venu, l’écho de tous ces chants bruyants qui réveillaient les morts d’à côté de leur sommeil du juste ou éternel. En bordure de ce stade existait alors cet estaminet vers lequel tous les matins cheminaient ces gens qui venaient shooter de la bière, puisque incapables de se mettre en short et de courir après un ballon à l’intérieur du périmètre de jeu, en tuf et bien poussiéreux dès que s’aventure sur les lieux le moindre vent de passage dans la région. Quelle que soit la saison de l’année, il fait toujours chaud et surtout bon vivre à l’intérieur de cette échoppe vendant bières, vins et spiritueux à ces habitués de Bacchus voulant échapper au climat oisif qui les contraint à trouver bonne place à l’intérieur de ces lieux de rêve où l’on marquait cette longue trêve par rapport à une vie lucide et bien souvent intrépide, ingurgitant à longueur de journée ces succulents liquides.
Ainsi aura été faite la vie de ces nombreux fêtards qui veillaient bien souvent très tard, accoudés à ces tables garnies de ce vin qui coulait à flots, leur inspirant ces rêves fous ou improvisés qui pouvaient parfois les mener au cimetière d’en face en prenant le risque de traverser discrètement la grande avenue qui sépare les deux lieux. Le bar et le cimetière vivaient ainsi leurs jours de joie et heureux et ceux de tristesse et bien malheureux. Cependant, chacun portait un écriteau à sa porte d’entrée accroché bien haut. Sur celle du débit de boissons alcoolisées, il y est écrit le règlement intérieur de l’établissement et ses horaires d’ouverture. Tandis que sur celle du cimetière, il y est fait cette mention: « Ici, le riche et le pauvre se rencontrent, c’est Dieu qui a créé l’un et l’autre ». Puisée dans cette morale qui vaut bien plus que toutes les démocraties du monde réunies, la phrase, lourde de sens et de conséquences, a de quoi faire peur à tout son monde pour en revanche le remettre rapidement à la raison.
Elle remet donc les pendules à l’heure pour cet individu, déjà complètement saoul, et remet au goût du jour ou de nouveau sur le tapis la valeur accordée à l’autre citoyen, aujourd’hui le corps enseveli sous le poids considérable de cette terre qui le couvre depuis sa mort. Et pourtant, d’un côté comme de l’autre des deux trottoirs ou rivages de la vie, il existe bel et bien ces règles scrupuleuses de la morale humaine à ne jamais dépasser. Bien que l’homme fréquentant le bistrot arrive souvent à les enfreindre suite à cette consommation effrénée sinon exagérée de ce breuvage, lequel le conduit parfois à faire beaucoup de tapage, énormément de ratages, bavardage inconséquent à l’appui ! Face à ces morts, les gens saouls font la houle, exultent et s’excitent de cette vie qui leur sourit ou nourrit ces ambitions que leur procurent cet espoir de vivre jusqu’à ostensiblement se moquer outre mesure de ces morts d’à côté calfeutrés dans leur silence et pelotonnés dans leur humilité.
Les seuls signaux en guise de réplique qu’ils peuvent leur refiler est ce vent de tristesse parcourant les lieux, les invitant donc sous forme d’échos-réponses à leurs cris de joie, à faire partie, un jour, de ce monde déjà parti pour de bon, en quittant, de gré ou de force, à jamais ou à trépas, ce monde ici-bas. En définitive, avec le temps et quelles que soient les générations, c’est le silence des morts qui aura le dernier mot sur ces jacqueries de soulards bien heureux à table et devant leurs derniers pots avant fermeture du bar qui aura à les expédier tout à l’heure de l’autre côté de la barrière. Et si le bar fait dans ce mode sélectif et très expéditif en n’invitant à son établissement, tous les jours que le bon Dieu fait, que les gens riches ou disposant du nécessaire sou ; le cimetière, lui, ne fait pas dans cette discrimination de race et d’espèce. Son invitation est officielle, bien solennelle et s’adresse à tout le monde. Gens riches et pauvres misérables meubleront toujours, à tour de rôle ou en groupe son grand espace, magnifique jardin, tout espéré du Paradis ou terrible enfer.
La plaque d’entrée renseigne parfaitement d’ailleurs sur ces indications d’usage et ces destinations éternelles. Les gens attablés à ce bar iront tout à l’heure prendre place dans le lieu d’en face, s’y couchant pour le reste de leur existence. Ils n’auront plus droit à la bière. Ils hériteront de droit et par devoir envers l’humanité de ce seul tombeau qui les différenciera de leurs pairs. Alors pourquoi se hasarder à vanter un quelconque espace de vie, si on n’est même pas capable de pouvoir librement disposer de son temps, lequel tôt ou tard nous enverra vers le périmètre d’en face, échouant tels des colis postaux à l’intérieur de ces cimetières honorables tout à l’heure longuement dénigrés et bien critiqués ? Bien évidemment, la morale ne s’en trouve nullement atteinte ; ce ne sont —disent nos sages— que des gens saouls qui ont fauté. Et comme ils manquent fondamentalement de lucidité, l’erreur a de fortes chances d’être plus tard rattrapée ou dans le fond bien corrigée. Le verdict populaire tombera sur le bistrot tel un couperet !
Comme on ne peut pas déplacer le cimetière, c’est donc l’estaminet qui a, un jour, complètement disparu ! Depuis, il n’y a certes plus de gens saouls ; mais le monde dans son ensemble a cessé de rêver. Le rêve est devenu donc carrément interdit pour les jeunes gens surtout ! Pour les fanatiques de l’ASSE et du bistrot, on ne leur propose en échange que cette mer à traverser, truffée de ses nombreux écueils et innombrables cercueils ! A vouloir tout le temps taquiner à partir de l’autre trottoir le cimetière d’en face, ne finit on pas par traverser cette seule voie qui y mène et y demander éternel refuge un beau jour ? Telle est donc la morale retenue par ces soulards et qui concerne malheureusement toute l’humanité.
-
Le souffle de la vie /Le Livre des Jours de Taha Hussein
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 2 commentaires
Ce texte a, entre autres, la particularité de démontrer le mérite à accorder à Mohamed Abdou dans le cheminement de la carrière littéraire et professionnelle de Taha Hussein.
En février 1947, André Gide préfaçait « Le livre des jours », de l’écrivain Taha Hussein, dans sa version traduite en langue française. Ce fut un évènement majeur pour la littérature arabe. Les traducteurs de l
ouvrage, Jean Lecerf et Gaston Wiet, auront, donc, su porter, plus tard, imparablement et admirablement, son excellent produit et succulent art bien au-delà de la vallée du grand Nil.
Ils en feront connaître plus loin la plume exceptionnelle d’un auteur assez singulier ou très particulier, sur tous les continents de la planète. Cependant, l’handicap visuel de cette plume de renom ne pouvait, donc, l’indisposer à transcrire toutes ces grandes merveilles littéraires venues des ténèbres de l’enfer de son exil intérieur. Dans ce titre autobiographique, l’auteur parle de sa vie, de son enfance, de sa jeunesse, de ses études, de ses sentiments, des premiers moments de l’éclosion de son talent et de son exclusion par tout un environnement qui lui était resté hostile ou incompréhensible. Il y décrit avec force détails son mal, expliquant au passage ces menus paramètres qui lui rendaient sa vie – amputée de sa vue – vraiment très difficile.
Comme l’indique son titre, dans cet ouvrage, l’auteur parle des jours, de ses propres jours (El Ayam). Il ne s’agit pas d’un livre-repère ou d’un cahier-journal. Il est plutôt question de toute une vie d’un illustre écrivain qui décrit – paradoxalement – ce qu’il ne voyait pas malheureusement. Contre son mal incurable, il n’avait que les mots comme moyen de lutte, unique remède et aucun autre intermède. Ses pulsions étaient sur le champ transformées en mots durs, drus, purs, solidement tissés et habilement tressés dans un texte qui faisait frémir les meilleures plumes du monde. En particulier, celles aidées par cette acuité visuelle dont l’auteur du « Livre du jour » en manquait au point de lui en substituer sa seule muse fusant de tout bois. Devenu aveugle dès l’âge de trois ans, Taha Hussein est natif d’un pauvre et misérable village de la moyenne-Egypte, en 1889. Il deviendra, plus tard, sans nul doute, le meilleur écrivain arabe de l’époque. Diplômé de la Sorbonne, en 1919, où il y soutiendra sa thèse, entièrement réservée à l’œuvre de mérite et à la vie de Ibn Khaldoun, il aura auparavant, en simple élève sous la férule du célèbre Mohamed Abdou, connu à la grande université classique arabe (religieuse) d’El Azhar, au Caire, puis, comme simple étape de transit encore, la toute récente université moderne de la même ville. Plus tard, de grands noms de la littérature occidentale, auteurs de prestigieuses œuvres et grands titres de mérite, se faisaient un honneur, lors de leurs visites au pays du Nil, de rencontrer, enfin, Taha Hussein, l’écrivain.
Et pour s’en convaincre, il n’y a qu’à se référer à la magnifique préface d’André Gide (prix Nobel en 1947), en plus de ses nombreux écrits sur l’œuvre de cette grande plume arabe, bien connue à travers les travées de notre planète. Aveugle mais, surtout, un brin polyglotte, Taha Hussein suscitait déjà ce grand complexe de l’inévitable paradoxe de la vie; tant l’auteur du « Livre des jours » était bel et bien à jour dans ses écrits et autres réflexions sur la littérature et les sciences sociales, de manière plus générale. Ne voyant plus rien de ses yeux, il consultait souvent le cœur et ce sixième sens qui l’aidèrent à mieux comprendre le quotidien de la vie, bien mieux d’ailleurs que ne pouvaient le faire pratiquement tous les prestigieux auteurs de la planète, ne connaissant pourtant ni handicap de la vue ni d’autre mal durable, incurable ou endémique. Dans le « Livre des jours », il faisait part de son autobiographie, poussé ou pressé par le seul souffle de la vie. Les yeux bridés, il n’avait pourtant nullement la vue ou l’esprit guindé par un quelconque empêchement de nature pour faire le récit de sa propre vie. Dans toute l’étendue de son austérité, de son antériorité, de sa complexité, tenant compte de la nature des éléments d’analyse qui ne reposent nullement sur l’élément palpable, mais plutôt sur le seul sentiment que véhicule une mémoire restée encore bien intacte.
Le plus curieux ou très fantastique à connaître encore dans la vie de Taha Hussein est que son auteur préféré n’était autre qu’un autre aveugle de la belle littérature, cette grande plume qu’était Aboul Alaa Al Maari (973-1057), très célèbre poète, plus connu pour sa virtuosité, l’originalité et le pessimisme de sa vision du monde, auteur de ces fameux vers : La vérité est soleil recouvert de ténèbres Elle n’a pas
d’aube dans les yeux des humains. Promu ministre de l’Education nationale, les Egyptiens lui doivent « cette éducation gratuite pour tous » et ces nombreuses écoles créées un peu partout sur le territoire de ce grand pays du Nil. Premier recteur de l’université d’Alexandrie qu’il avait créée en 1942, après avoir été le premier doyen de la faculté des lettres du Caire (1930), il fut aussi professeur de l’Antiquité, depuis 1919, soit dès son retour de France et jusqu’en 1925, où il aura à moderniser l’enseignement supérieur et à animer et dynamiser la vie culturelle du pays.
Ce doyen de la littérature arabe reste l’un des plus importants penseurs du XXe siècle, en sa qualité d’essayiste, romancier et critique littéraire hors-pair. Partout à travers le monde, il était, donc, considéré comme « le rénovateur de la littérature arabe ». Son « Livre des jours», édité en trois tomes (tous rédigés entre 1926 et 1955), en exprime d’ailleurs cette nouvelle structure narrative. Ce choix du récit autobiographique à prétention littéraire était alors quelque chose de vraiment neuf (nouveau) dans la littérature arabe. Ainsi, le premier tome « d’Al Ayam » (les jours) portait-il sur la mise en valeur de cette « quête individuelle d’une mémoire retraçant le cheminement d’un souvenir vers la raison ». Mais aussi, d’un autre côté, d’une « raison appelant la mémoire afin de se justifier aux yeux du monde ». L’itinéraire était, donc, bien tracé. Il consistait en cette succession de jalons proposés à la société afin de renaître d’elle-même. Elle constituait cette nécessaire passerelle pour « aller d’un âge imaginaire mythique, figé dans sa propre mémoire, à la maturité d’un regard scientifique et rationnel sur le monde ». Le « Livre des jours » traduit, donc, indéniablement le difficile souffle de la vie de son auteur, ses grandes peines et ses terribles douleurs, ses silencieuses frustrations comme ses insupportables exclusions; et parmi celles-ci, figure, bien entendu, sa privation de la vue, phénomène qu’il put cependant surmonter grâce à cette plume alerte et très diserte qui aura eu la très lourde charge de faire toute la lumière sur tout son itinéraire littéraire, depuis son enfance jusqu’à cette étape où il acquiert ou atteint le sommet de son art.
Sa proximité avec le très célèbre Mohamed Abdou ne lui a pas procuré uniquement que des amis. Bien au contraire, elle aura plutôt provoqué des remous dans le clan qui lui était opposé idéologiquement, au point où Taha Hussein sera entraîné dans un affrontement larvé avec la toute autre célèbre université religieuse d’Al Azhar, pour être aussi traité de mécréant vendu à l’Occident. En plus de ces nombreux reproches faits à l’homme de lettres de renom par les islamistes d’Al Azhar, son « Livre des jours » connaîtra la censure de certains de ses passages (quatre gros chapitres lui ont été charcutés) par les responsables du ministère de l’Education nationale, pour être par la suite carrément retiré (intégralement interdit) des programmes scolaires des écoles du palier secondaire en Egypte. Ce fut une deuxième mort pour l’auteur de cet ouvrage. Mais les jours suivant sa première mort furent encore plus douloureux pour la littérature arabe et universelle. Après sa disparition, ce sont des pans entiers de ce grand art scriptural qui disparaissent, à leur tour ! Avec leur inamovible auteur ! Dans sa vie, Taha Hussein aura connu, à la fois, le meilleur et le pire. Plutôt plus le pire… !
-
Entre sanglots de Césarée et tristesse de Iol !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 0 commentaire
Cherchell de ce début du troisième millénaire a beaucoup peur pour son histoire ! De sa propre histoire ! On y aura entre temps tout dépravé et tout détruit de cette mémoire collective qui fait remonter le temps et réactualiser les évènements.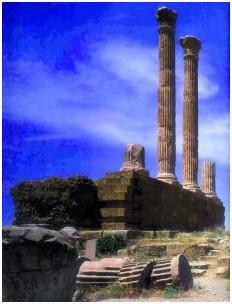
Le désastre y est grand ! La catastrophe énorme ! Les dégâts astronomiques ! Il est bien dommage qu'une histoire pareille parte en ruines, déchirée en mille morceaux !
Les quelques vestiges et sépultures, gisant tels des cadavres humains, seuls témoins vivants de cette grande tragédie, ne peuvent plus refaire l'histoire : l'oubli est trop important ! Les trous de mémoire auront donc tout détruit ! Ou tout emporté de cette mémoire qui refuse d'être inspectée !
Le puzzle est trop compliqué dans sa configuration pour être recomposé. Il est plutôt question de cette autre mentalité qui se moque royalement de l'histoire du pays, parce que tout le temps instrumentalisée par un pouvoir aux aguets, refusant toujours de reconnaître cette vérité qui l'exclue de toute gloire et l'efface de toute mémoire.
Un important pan de la société s'effrite : c'est sa mémoire collective qui est en danger ! Cherchell refuse ces bas-compromis et autres nombreuses combines faites à son sujet ! Elle tient à nous dicter sa propre histoire, décidant de se retourner vers ses aïeux et ses nombreux héros !
Ainsi, Iol et Césarée y sont pour l'occasion invités à sa rescousse, accueillant qui son fils qui son petit-fils dans leur giron, le couvrant de bénédiction pour l'amener bien loin de ces regards complètement désintéressés de son nombreuse population par l'état de déliquescence avancé de ces lieux d'histoire où l'archéologie en témoin plutôt gênant et millénaire tient le haut du pavé.
La ville, longtemps oubliée et à répétition piétinée, se recroqueville sur elle-même, se réfugiant dans son histoire la plus ancienne ! Plus grave encore, personne parmi sa nombreuse et bien éduquée population ne consent à l'en empêcher ! Ne se résout à aller la chercher au plus profond de ses tripes ! Au plus loin de son voyage fait à reculons jusqu'à décider de ressusciter sa gloire légendaire, ses héros immortels et son autorité, autrefois implacable sur toute la région !
Le recul est donc réalisé dans le plus intime de ses rêves ! Dans le plus inaccessible de son éternel sommeil !
Lorsqu'en 1984, en haut lieu de la hiérarchie du pouvoir algérien, on lia son sort à celui de Tipasa, les grands hommes de lettres et de bonne culture pensèrent un moment à cette union vitale entre cette utile histoire à conjuguer avec cette ancestrale culture à bon escient espéraient-ils !- dans cet espace touristique qui allait lui servir de véritable tremplin au plan géographique et spirituel.
Ils auront vite déchanté de voir les deux contrées vouées aux gémonies de l'enfer de cet oubli qui tue plus fort que l'arme de combat au milieu de ces cités-mouroir qui étonnent leur monde par leur salubrité et se bétonnent à tout va et contre le fait culturel.
Depuis, Cherchell, dépitée par tant de malheur qui lui arrive par la manière osée de sa propre progéniture, est donc retournée se calfeutrer à l'intérieur de ses plus vieilles hardes et très anciennes guenilles. Et comme dans un rêve, un peu moins inconscient, elle y rencontra Iol et Césarée, le temps d'une très brève sieste, lors d'une tempête de l'inculture annoncée mais jamais dénoncée !
Seulement son malheur dure dans le temps. Son calvaire perdure dans cette galère dont elle ne voit plus la fin !
Résultat de l'équation proposée : il n'y fait plus bon vivre comme autrefois et jadis !?
On y ressent ou y découvre donc cette tristesse de Iol, ces sanglots de Césarée et cet abandon à jamais de l'actuel Cherchell !
La ville, encore frustrée de son histoire magnifique et très honorifique pour le pays et la région, refuse donc de voir du côté de la mer. A présent, elle tourne carrément le dos à la Méditerranée, méditant son sort et s'accrochant de toutes ses forces à ce col auquel elle est tout le temps bien collée et qui la protège de ces vents chauds venant du sud du pays.
Juba, Jugurtha, l'Emir Abdelkader et bien d'autres héros et valeureux combattants pour l'indépendance du pays, se retourneront certainement dans leur tombe en prenant connaissance de son état lamentable de déliquescence du moment, difficilement admis au plan de la forme et surtout dans le fond pour une si belle perle de la Méditerranée d'antan.
Leur combat si noble et très fécond suscitera-t-il un quelconque intérêt pour cette merveilleuse ville qui refuse de mourir, de périr et de sombrer dans cet anonymat culturel ambiant et bizarre du pays ?
La contrée, bien vieillie et complètement dépouillée de ses nécessaires béquilles, ne peut plus relever la tête, se redresser sur pieds, se soulever très haut pour planer comme autrefois sur ce flanc de la Méditerranée.
Elle attend toujours le diagnostic de son médecin privé, lequel semble incapable de trouver à son mal le remède approprié.
Cherchell a surtout besoin de considération pour bien se réveiller. Pour revenir de nouveau à la vie ! Elle a vraiment hâte de renaître à la vie et couvrir de son charme discret le touriste éveillé pour lui faire découvrir sa grandeur, ses splendeurs, telle cette fleur printanière qui embaume de ses toniques odeurs l'atmosphère, ou cette resplendissante demoiselle qui étrenne sa beauté et ses rondeurs, dévoilant au passage ses formidables couleurs et répandant abondamment alentour ses enivrants parfums du terroir et de bonheur.
Sommes-nous conscients de tout cela ?
Ou alors lui a-t-on déjà préparé son cercueil au même titre que d'autres prestigieuses contrées du pays ?
Cherchell a tout le temps été perçue telle cette très élégante demoiselle jouant sur ses deux barres parallèles, où l'histoire et le quotidien de la ville ne sont plus que deux lignes droites qui ne se rencontreront jamais ! D'où d'ailleurs l'abandon forcé de cette culture qui fait l'histoire des civilisations !
La caricature est très expressive. Symbolique même ! Et à plus d'un titre. Elle nous empêche de regarder dans le rétroviseur ! De nous situer dans le temps ! De nous remettre tout le temps en cause ! De nous intéresser à la ville et à son histoire la plus ancienne !
Est-ce un nouvel état d'esprit ? Où est-ce encore l'effet néfaste de notre propre inculture ? L'absence de ce tourisme florissant des années soixante-dix du siècle dernier n'y est-elle pas pour quelque chose ?
Tout concourt à conclure que notre très difficile quotidien nous met à une bonne distance de notre valeureuse histoire, très profonde et bien féconde.
Ce choix douloureux, somme toute- aura peut-être été fait à dessein. Et seul l'avenir pourra y répondre, un jour ...Rédigé le 09/08/2011 à 05:42 dans Histoire, Tourisme | Lien permanent.
-
La vache suisse et le pétrole arabe
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 5 commentaires
La vache est pour la Suisse ce que le brut est pour tous les Arabes. A chacun d'eux sa propre richesse. D'où découle d'ailleurs l'essentiel de son économie. A chacun donc son métier et les vaches seront certainement bien gardées, dit la sagesse.
Pour l'instant, leurs maitres incontestables ce sont donc les Suisses. Puisque les arabes, eux, s'intéressent toujours et sans vergogne au pétrole. Les vaches Suisses ont depuis longtemps envahi les guichets de l'état civil helvétique. Leur recensement les évalue à présent au nombre de six cents mille bêtes. Toutes domestiques ! Toutes minutieusement identifiées. Et toutes détentrices d'un passeport national et d'un autre, le cas échéant, de type international, commun à toutes les bêtes du monde, en cas de voyage au-delà des frontières de ce petit, beau et tranquille pays.
Ce que pourtant l'on refuse manifestement à certains êtres humains des pays arabes (le cas typique de cette minorité du Koweït, en l'occurrence !) est donc devenu un droit indéniable ou absolu accordé à ces bien heureuses vaches Suisses.
Ces bêtes-là sans distinction de race ou d'espèce bovine- voyagent toutes, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce tout petit pays helvétique, munies de documents identitaires très officiels : le titre de voyage local pour l'une ou le passeport international pour l'autre.
Dans ce pays de la technique de précision, tout est donc bel et bien réglé à l'avance comme les aiguilles d'une montre qui marque l'impact indélébile du temps qui s'écoule ou celui qui manifestement nous écule.
Les vaches Suisses, sans être confondues dans le rôle de ces bêtes à la stature très religieuses de l'Inde, jouissent toutes et sans exception de ce haut standing et statut très relevé, tout ou très proche de celui purement humain.
A l'image du pétrole Arabe, elle est donc exportable. Seulement l'économie de ce petit pays au haut et très grand relief en dépend dans une très large mesure. Raison pour laquelle on n'en exporte pratiquement que l'excédent de son cheptel ou de son produit laitier et autre dérivé fromager. Sur les crêtes et autres nichés valons de ces hautes Alpes, le citoyen Suisse tient encore et toujours à sa vache, tout comme d'ailleurs cet Arabe qui s'accroche mordicus ou pour de bon à son baril de pétrole. Le premier cherche à vivre comme toujours des généreuses mamelles de son animal domestique pendant que le second pompe toujours ce précieux liquide de sa considérable énergie fossile.
Cependant, ce paysan des Alpages se dépense comme un nègre pour entretenir son animal et bovin laitier à l'inverse de ce bédouin Arabe qui pille et extirpe à longueur de temps ces indéniables richesses souterraines non renouvelables de son pays, afin de réchauffer avec cet occident qui grelotte de froid pendant la saison hivernale, moyennant ce gros pognon que draine cette grande énergie.
A l'animal domestique très généreux du premier correspond donc, de l'autre côté, ce très riche désert Arabe. Et pendant que celui-ci donne à manger à sa bête domestique, celui-là aspire et tire tout le temps et sans la moindre réserve sur les mamelles de cette très féconde terre Arabe, sans avoir à lui apporter la moindre contrepartie en matière d'effort physique, hormis celui de l'en déchoir de ses richesses fossiles.
C'est donc là où réside toute la grande différence au plan de la philosophie de la vie entre ces deux mondes, jugés bien distincts ou très éloignés l'un de l'autre.
Sans leur pétrole, tous les pays Arabes seraient, sans nul doute, déjà des nations très pauvres ou des pays mort-nés.
Nantie seulement de quelques villes de moyenne dimension comme Genève, Zurich, Bâle et quelques alpages en haute montagne, la toute minuscule Suisse arrive tout de même à bien se placer et durablement s'installer devant de bien immenses pays-continents comme l'Algérie, tenant surtout la dragée haute à de très grandes puissances économiques mondiales.
Et si ce petit pays helvétique est plutôt connu au travers de ses magnifiques montres qui régulent depuis des lustres déjà ce temps propre à toute l'humanité, il l'est également ou tout autant -sinon bien mieux considéré- au regard de l'élevage de son cheptel bovin laitier qui produit ce chocolat Suisse de grande qualité.
En dehors de sa neutralité politique avérée et de la grande assurance reconnue à ses banques, très anciennes et bien pérennes, la Suisse demeure ce grand symbole de l'usage du temps, tenant compte de cette grande précision dont elle garde si jalousement encore la bonne recette et qui défie la puissance astronomique des grandes nations du monde dans des domaines plus complexes et les mieux considérés.
Ce tout petit pays ne prétend jamais voir plus grand que son propre horizon. Il se contente seulement de ne rien ignorer ou mal considérer de ce qu'il voit ou entrevoit comme solution durable et acceptable en tout point de vue, à ses propres problèmes, dans la perspective de hisser davantage ce très haut relief parmi les nations les plus considérées de par le monde.
Depuis déjà très longtemps, la Suisse se maintient à ce statut enviable et très considérable de pays très tranquille, bien neutre, surtout très propre, et où il fait toujours bon vivre, malgré ses vents violents, ses interminables chutes de neige hivernale, ses pluies diluviennes, son cloisonnement et parfois même son obtus raisonnement.
Ainsi, la vache Suisse, pilier essentiel et donnée pérenne de l'économie helvétique, assure toujours une vie décente, heureuse et très colorée à ce peuple de montagnards et de très fiers campagnards, connus tous pour leur grande fierté et indéfectible dignité. C'est surtout- grâce à cela que la Suisse, chaque jour qui passe, avance d'un cran dans le concert des grandes sociétés et toutes développées nations. Son économie est des plus simples, sa recette-miracle des plus modestes encore.
Mais à la clef, il existe tout de même ce besoin impératif de conquérir ces hypothétiques espaces laissés entre-temps libres dont le grand profit scientifique ne peut être que des plus bénéfiques pour le futur de la nation et l'économie de la contrée.
Voilà donc maintenant vite refermée cette grande parenthèse consacrée à ce tout petit pays du vieux continent. Retenons, tout de même, que cette généreuse vache helvétique, encore bien gardée par ses pâtres des hautes Alpes, donne encore et toujours beaucoup de lait à plus de six millions d'habitants Suisses ainsi qu' à bien d'autres nations qui en sont dépourvues.Elle demeure au cœur même de cette facile mais durable équation de l'économie helvétique dont elle en constitue d'ailleurs la donnée de base ou essentielle. Plutôt celle fondamentale et bien capitale.
A l'opposé, qu'en est-il de ce brut arabe ?
Tous les indicateurs montrent, à l'évidence, qu'il reste encore cette 'vache Arabe''. Celle qui leur fournira toujours du lait sans pour autant leur exiger en contrepartie la moindre botte de foin ou une quelconque ration de son en vrac ou cubé.
Quant à leur exiger du trèfle ou de la luzerne, c'est plutôt leur demander l'impossible au vu de toutes ces conditions climatiques très défavorables à la prolifération d'un tel aliment de bétail, pourtant très prisé pour les ruminants producteurs de lait frais.
Ainsi, ils obtiennent tous de cette terre pourtant aride et bien nue du lait à profusion, accompagné le plus souvent de toute la gamme variée de ses nombreux dérivés, gratuitement et sans faire un quelconque effort, hormis celui obligatoire de l'aspirer, à longueur de journée et sans discontinuité, les pieds dans l’eau, à partir de leur retraite dorée ou demeure huppée, de ses mamelles tentaculaires et qui leur arrive jusqu'au pied de leur lit, sortant en courant des fins fonds des entrailles de ce généreux sous-sol.
Seulement, à l'inverse de ce gentil et très éduqué peuple helvétique, chez les Arabes, ce sont toujours les mêmes personnes ou familles politiques qui tiennent encore entre leurs mains ces pis pulpeux et juteux d'où jaillit ce merveilleux produit (liquide) de la terre qui arrive à concurrencer tous les autres liquides réunis ou combinés à eux-mêmes. Disposer en permanence d'une telle vache, laquelle produit, en plus, ce liquide qui coule à flots au sein des entrailles de la terre Arabe n'est pas de nature à les réveiller de très tôt de leur profond sommeil pour se préparer à aller travailler.
Ils auront tous appris à longtemps vivre de cette indéniable ou supposée intarissable rente qui leur épargne même de réfléchir un jour aux grandes difficultés de la vie.
Pour preuve, munis de tout leur gros pognon qui ne profite qu'aux banques de l'occident, ils restent tous, bien incapables de créer le moindre produit industriel ou réflexion scientifique bien féconde ou très pratique dans le quotidien de leur vie.
Ils sont donc bons pour tout juste consommer ce que l'Occident, depuis toujours, ou l'Asie, à présent, ne cessent de produire pour eux en quantités industrielles.
Une donnée économique donc très naturelle dont les lois de l'économie elles-mêmes réfutent, récusent et refusent de l'associer à un quelconque raisonnement futuriste et salutaire pour toutes ces nations Arabes qui vivent l'attentisme comme une fatalité. Sinon telle une très grande qualité au vu de ces grandes découvertes du brut qui voient le jour ça et là au sein de ce grand Sahara Arabe. Et l'on arrive donc finalement ou bien fatalement à cette conclusion plutôt terrible du moment : puisque la seule vache Suisse défie tout le brut des Arabes ! Il n'y a qu'à consulter pour cela le classement mondial des nations pour s’apercevoir de cette différence terrible qui existe entre l’esprit qui guide cet animal et celui en vigueur au sein de tout cet immense désert Arabe ! -
Mon meilleur cadeau
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 0 commentaire
Nous sommes le 31 mars 2014, à quelques heures seulement d’un tout autre 1er avril, celui de l’année en cours, bien évidemment. Mon portable se trémousse un instant, puis retentit, bruyant, sans discontinuité, distillant son refrain de musique coutumier. Le temps de me préparer à aller prendre l’appel, puisque me trouvant encore occupé un peu plus loin dans l’autre pièce de l’appartement, que celui-ci se tait à nouveau, avant de reprendre encore de plus belle.
-
De l’art graphique d’une culture prolifique
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 2 commentaires
Pour une surprise, c’en est une ! Et de taille celle-là ! Au hasard d’une promenade improvisée, je rencontrai l’auteur Mustapha Lotfi El Manfalouti, des décennies après sa mort. C’est en enjambant la Seine algéroise (l’Oued El Harrach, en l’occurrence), empruntant le pont piétonnier que son regard trop caricatural fixa le mien.
Surpris de trouver l’ouvrage en ce piteux état qui lui servait de tribune chez un misérable bouquiniste d’occasion, je réussis non moins habilement à subtiliser le «livre d’or» à son bourreau du jour, lequel ne connaissait que très vaguement la renommée de l’auteur ainsi que la valeur ô combien précieuse du titre considéré. Lui payant, en échange, cette modique dime en dinars symboliques afin de libérer le «prévenu». Il ne s’agissait pourtant guère de l’aîné des trois chefs-d’œuvre d’El «Ennadharat». Ce fut tout juste le cadet, connu à travers ce tome II, écrit en langue arabe, bien évidemment. Tout allègrement, je prenais donc, flegmatique, possession de ce «trésor littéraire» trainant par terre au milieu de cette boue qui surplombe et accompagne l’odeur puante et nauséabonde du fleuve qui lui tenait de cadre de jardin de présentation.
D’un geste machinal, je payais la caution -misérable rançon- pour obtenir libération de l’œuvre de renom, en tendant une seule pièce de monnaie à ce garde-chiourme calfeutré dans son manteau et ignorance.
 L’acte se réalisa donc au rabais de son prix public ou légal. D’ailleurs, les quelques pages feuilletées à la sauvette sous le regard vigilant du bouquiniste-kidnappeur ont suffi à me décider à acheter le livre proposé à la vente et exposé à même le sol, me demandant comment un tel numéro, unique en son genre, eut pu échapper au regard pourtant fouineur de ces «chasseurs de primes littéraires», peu nombreux certes à s’y aventurer à cette heure précise ? Nombreux étaient au contraire les passants, pressés de prendre le bus ou le train, en attendant les premiers essais du métro, mais étant en majorité des étudiants traversant en coup de vent le pont reliant l’université à leur demeure parentale. L’ouvrage était un vieux bouquin aux feuilles bien jaunies par l’effet du temps et tant de misère endurée ou subie dans la chair.
L’acte se réalisa donc au rabais de son prix public ou légal. D’ailleurs, les quelques pages feuilletées à la sauvette sous le regard vigilant du bouquiniste-kidnappeur ont suffi à me décider à acheter le livre proposé à la vente et exposé à même le sol, me demandant comment un tel numéro, unique en son genre, eut pu échapper au regard pourtant fouineur de ces «chasseurs de primes littéraires», peu nombreux certes à s’y aventurer à cette heure précise ? Nombreux étaient au contraire les passants, pressés de prendre le bus ou le train, en attendant les premiers essais du métro, mais étant en majorité des étudiants traversant en coup de vent le pont reliant l’université à leur demeure parentale. L’ouvrage était un vieux bouquin aux feuilles bien jaunies par l’effet du temps et tant de misère endurée ou subie dans la chair.Celles-ci sentaient l’humidité du papier mêlée à l’odeur du renfermé, avec en surface une bonne couche de poussière crasseuse pour tout caricaturer de l’état déliquescent de véritable relique dans lequel il se trouvait. Il symbolisait, en fait, ce savoir abandonné par ces commerçants courant derrière le lucre de la vie et ce dinar à gagner dessus ! Edité par la maison de la culture de Beyrouth (Liban), probablement bien avant la première moitié du siècle dernier, celui-ci ouvre, sans la moindre introduction, sur un texte titré de «El Bayan» (avis, communiqué…) évoquant le traitement du courrier provenant des citoyens par un ministre de la République que commente superbement l’auteur dans un arabe classique bien caustique.
Le vocabulaire qui y est employé procède de cette manière osée et très subtile de faire dans le style de l’opposition et de la transposition des expressions et qualificatifs de sens contradictoires, donnant toute sa dimension à cette belle métaphore, réalisée avec beaucoup d’aisance et d’à propos. Une approche bien singulière, sans laquelle le style de l’auteur aurait préché par manque de beauté, ne faisant par conséquent que rétrécir son champ de l’imagination et occultant le reflet de ces images magiques volées à cette fiction de haut vol. Riche de quelques quarante-six titres ou thèmes, l’ouvrage en question traite de sujets différents, mais assez cohérents et très puissants, poussant l’auteur à puiser ses mots symboliques et ses expressions magnifiques et mélodieuses dans ce volumineux répertoire et grand vivier de la langue arabe à la musicalité «chantonnante» et vraiment attachante, rythmée à cette forte tonalité et grande fonctionnalité qui en fait d’elle une langue très prisée et ses textes de qualité hautement confirmée.
L’acte d’achat contracté, le sourire aux lèvres, je refermais l’ouvrage brièvement ausculté. Assuré d’avoir réalisé une bonne affaire, je le rangeai dans ma sacoche et repartis tout de go flairer une quelconque opportunité le long du pont avant de me retrouver chez moi en fin d’après-midi, rouvrant de nouveau mon «trésor» acquis au dixième de son prix et au dinar symbolique de sa valeur nominale, vénale et culturelle. Je feuilletai, ivre de joie, de nouveau ses pages, folio après folio, voyageant de surprise en surprise, au cœur de ses formidables secrets et au sein de cet univers où la magie des mots prend, grâce à ses expressions justes et honnêtes, le dessus sur cette monotone vie qui nous est servie et tout le temps livrée sous toutes ses différentes facettes et nombreux aspects.
De prime abord, plusieurs chroniques et autres textes de référence mondiale contenus dans l’ouvrage m’intéressèrent. Et à mesure que j’avalai la première, je dévalai aussitôt cette pente qui me mena tout droit au second écrit. Je le fis sans halte, sans la moindre pause ou récréation, très conscient d’y avoir trouvé ce filon littéraire qui allait me faire découvrir à nouveau ces textes très prisés dont leur connaissance et familiarité remontaient à l’époque de mon enfance ou tendre adolescence. Je me régalai, me rassasiant de ces belles paroles couchées noir sur blanc sur de vieux papier, tenant difficilement le coup, défiant le temps, pour rester éternelles, immortelles…
Depuis, c’est du contenu bien précieux et très riche de ma «boîte à merveilles» que je cueille chaque matin mes belles et parfumées fleurs avant même que je n’aille retrouver mon travail. L’embaume de leur parfum du terroir et assez rare, me procure ce bonheur du jour et bien coutumier, sans cesse renouvelé. Je me plaisais à parfois sans relâche ressasser certaines d’entre elles, succulentes à souhait et instructives à l’évidence. De nombreuses réflexions y sont consignées et dont leur analyse reste d’actualité, leur finalité de bonne raison et la charpente du texte ayant servi à leur expression tout aussi puissante et bien convaincante.
Cependant, l’ouvrage s’illustre par cette singularité à aborder ces thèmes «inédits», traités à leur époque par cet érudit de l’art cursif d’expression arabophone dont le style se confond à merveille et en profondeur avec celui de cheikh El Bachir El Ibrahimi et s’apparente par endroits et à bien des égards à celui de l’autre référence et imminence grise littéraire ayant pour adresse cursive Taha Hussein. Mais, à mon humble avis, l’œuvre de Mustapha Lotfi El Manfalouti se situe bel et bien un cran au-dessus de celle de ses semblables et plumes comparables. A travers ses œuvres, il nous rappelle à la fois ce français de Guy De Maupassant et cet Algérien de Bachir El Ibrahimi, cet écrivain arabe dont les styles sont «jumeaux».
L’étendue de son espace culturel lui confère cette haute capacité de juger de «ces autres compétences» en investissant haut la main cet «espace intime» propre aux autres langues et «espèces littéraires» ; et il n’est point étonnant de découvrir chez cet auteur des thèmes abordant d’autres cultures révélant au passage des grands portraits de ces magnifiques plumes et autres érudits de la littérature universelle. A ce propos, l’ouvrage en question nous en refile quelques noms pelotonnés sous ces titres de «l’oraison funèbre de Voltaire» (taabin Voltaire), «A Tolstoi» (Ila Tolstoi) à côté de «Quatrins de Omar El Khayyam» (Robaiyyat El Khayyam). Bien que touchant à divers domaines, l’ouvrage se focalise essentiellement autour de la culture et de la littérature.
Des sujets comme «Traîtrise des titres» (Khidaa El Anaouin), «Voyage dans un livre» (Siyaha Fi Kitab), «Des larmes pour la littérature» (Damaa aala El Adab) sont très intéressants à connaître de leur précieux contenu, beauté littéraire et haute portée culturelle. En fait, ses regards sont des «regards croisés» sur cette culture universelle qu’emprunte ses textes littéraires qui font à chaque fois référence à ces génies de la plume dont Victor Hugo et l’oraison funèbre fracassante qu’il avait prononcée à l’occasion du décès de Voltaire, traduite vers l’arabe pour la circonstance près d’un siècle après la mort du défunt héros de la littérature française et principal animateur du siècle des Lumières. Hugo est donc plusieurs fois cité dans ses œuvres et écrits, lui louant, au passage, son langage juste, sa réflexion féconde, ses mots fouillés, ses phrases ciselées, ses vers bien mûrs et ses textes succulents à souhait. El Manfalouti n’est-il pas, en définitive, cette exception qui justifie la règle ? Celle de l’universalité de la littérature…!
-
Une beauté naturelle, éternelle… !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 3 commentaires
À Tipasa, tôt le matin, et quelque soit la saison de l’année, l’azur du ciel se confond profondément avec l’autre couleur bleue de la mer. Juste une question de nuance dans le bleu qui s’efface à mesure que le temps passe et que le jour se lève de bon pied, en quittant ses vieilles hardes et très anciennes guenilles.
Ici, tout près de la côte Méditerranéenne, cette lune de miel est naturelle ! Bien éternelle … ! Et chaque jour, elle se renouvelle ! Dans cette partie durable d’amour charnel et tout à fait naturel, le ciel se couche sur la mer. Il le fait de tout son poids et corps immense et compact, dégageant par moment le souffle de sa transpiration que la nature physique et celle humaine le subit de front et en profondeur dans sa propre chair.
Et seul au loin, un trait très fin couvert d’un bleu plus nuancé marque le territoire de chacun des deux partenaires, tantôt en action, tantôt dans leur état de décontraction. En plein milieu du ciel, le soleil de plomb qui darde ses rayons sur la région, du lever du jour jusqu’à son crépuscule, avec la même ardeur et le même souffle permanent et effréné de sa puissante chaleur et même force de frappe qu’autrefois et de tous les jours, laisse à penser qu’il tente de tout son poids de les séparer, par moment, l’un de l’autre.
Juste pour leur permettre de reprendre leur souffle et de plus tard revenir en force à leur grosse bise sans cesse répétée.
Avec le même refrain, le même rituel et la même folie d’amour. Avec cette même folie d’amour de retrouver au plus tard l’autre. Le partenaire. Ce partenaire naturel. Cette joie commune de partager avec lui les grands moments de plaisirs et de vrais désirs, bien affichés et longtemps manifestés envers l’autre sexe, sans lequel cette joie formidable n’aurait plus aucun sens !
A l’horizon, en pleine lumière du jour, le bleu céleste épouse donc celui bien marin.
Les écumes des vagues confondues avec ces nuages qui ratissent assez bas, au loin, les aspergent de cette brume matinale, comme pour leur annoncer le lever du jour imminent.
Le couple s’accouple dans son grand lit naturel, lequel tantôt berce son monde grâce à la beauté naturelle de son merveilleux décor et tantôt lui envoie ces fournées ininterrompues de chaleur de plomb qui les maintiennent cloués à l’intérieur même de leurs demeures.
Tarés et bien terrés pour un temps, parfois assez long ! Souvent c’est le temps que durera toute cette saison chaude et caniculaire. Très difficile à vivre, somme toute ! Dès la tombée de la nuit, faite de bleu et de blanc baignant dans le gris, des nuages venus en série et se
bousculant à l’horizon, rentrant à leur bergerie, le couple habillé le jour du bleu de l’espoir se voila soudainement la face.
Et dès le crépuscule annoncé, ils tombent tous les deux dans les bras de Morphée, emportés par leur sommeil éperdu, les yeux bien écarquillés sur le lever du jour du lendemain qui tarde à se manifester.
A ce moment-là, la mer et le ciel s’envolent dans leur rêve de l’intimité, convoler en justes noces, et bien loin des regards plutôt indiscrets de ces êtres humains restés médusés et circonspects devant le déploiement acharné de tant d’ombres épaisses et trop sombres que distille par doses saccadées l’arrivée impromptue et inévitable de la nuit, montée sur ses grands chevaux pour venir juste pour un temps leur tenir bonne compagnie.
Tipasa respire à longueur d’année la fraicheur de ses champs verdoyants et chatoyants, venant à tour de rôle se jeter dans la mer, fuyant par moment cette chaleur suffocante sévissant en été dans la contrée.
Ici, pendant le jour, l’été ou l’hiver, au printemps comme en automne, Tipasa, durant presque tous les jours de l’année, porte le même costume que la veille et qu’autrefois.
Celui donc taillé sur mesure par cette nature généreuse et féconde assistée de ce temps radieux et souvent bien ensoleillé, foisonnant et faisant miroiter au loin et à dessein ce merveilleux bleu où espoir et espérance se conjuguent et se confondent juste pour pleinement profiter de la beauté paradisiaque des lieux et du temps printanier qui y règne presque durant toute l’année.
Tipasa, la Romaine, garde de l’histoire ancienne de la région un bon bout sinon la bonne clef qui permet cet accès facile et bien discret aux fins fonds de ses profonds secrets dont les seuls vestiges en bordure de mer ou le mausolée de Hélène de Séléné, reine de Maurétanie, juchée plus loin et en haut de la colline qui la surplombe, tentent de vainement la replacer dans son contexte historique d’autrefois.
Se situant dans le prolongement de la colline qui prend naissance du côté de Koléa à l’est pour échouer à l’ouest aux abords de la plaine de Hadjout, ce dôme géant, pierreux et très rocailleux, puissant et très imposant par sa stature et sa carrure, fait face à l’imposant Mont du Chréa jusqu’à nous paraitre comme le taquiner à distance.
Koléa qui a tout le temps peur que le Mont Chréa lui tombe dessus ou sur la tète, selon l’anecdote racontée à son sujet, semble être très bien protégée par ce mausolée, se tenant debout et défiant le temps en très solide et véritable sentinelle, juste pour bien protéger la ville de l’osier et des généreux gosiers du chant « chaabi d’antan » contre les dangers de la nature. -
La leçon de l’artiste poète/Malek Haddad
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 2 commentaires
_
-
Rachid Mimouni...Tout l’intérêt d’une « peine à vivre » !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 3 commentaires
Quoi de plus symbolique que de réserver un espace à la hauteur de la réputation et des œuvres de qualité de l’auteur dans ce moment précis, coïncidant avec le dix-septième anniversaire de la mort de celui dont tous les titres ont été primés, l’honneur de la tribu en particulier !
En moins de vingt ans, l’auteur émérite aura écrit toute une dizaine de titres de mérite, dont la résonance de leur contenu porte plus loin que le territoire de son pays de naissance tant le style en « va-et-vient » épouse par moment « cette écriture en spirale » propre à Kateb Yacine dont il s’en est inspiré à merveille et qui séduit et conduit tout droit le lecteur à coller de tout son esprit et attention au texte souvent bien succulent et très singulier.
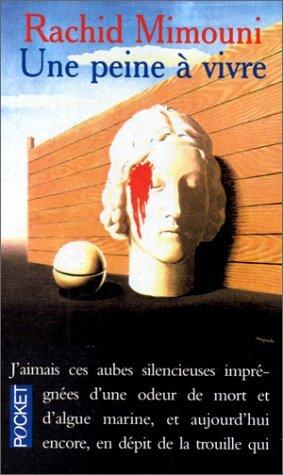
Soit en moyenne un ouvrage tous les deux années d’écriture besogneuse, tel que le dicte cette religion musulmane en référence à l’espacement des naissances engagé dans le cadre du planning naturel relatif à la science de l’accroissement démographique.
Oui ! Les livres font également partie de cette progéniture laquelle, avant de rendre hommage à leur famille, propage au loin et durant de longues générations le savoir dans toute sa dimension et profondes qualités humaines.
Mieux encore, ils sont ces fils qui ne demanderont, ni même jamais n’exigeront leur part à un quelconque héritage parental, rendant immortelles les idées de leur créateur et étreignant éternellement la grande stature de leur maitre, le rendant présent à tout instant.
Le savoir ne conduit-il pas, pour l’occasion, à l’immortalité du Savant, du bon conteur et de l’érudit poète-rossignol ?
Oui ! Il s’agit bel et bien du conteur et du rossignol, parce que la prose de Rachid Mimouni est composée de ces deux styles et formes d’expression cursive, tissés dans la même trame et brassés dans le même moule ou texte littéraire : celui qui ressuscite ce goût à la lecture des récits d’autrefois et de ces projections d’avenir, encore d’actualité.
Ce parallèle s’impose donc grâce à la magie des mots de l’auteur, puisque tous ses ouvrages, tels des vers sonnant encore grâce à l’apport conséquent de la force et puissance de leur rythme et tonalité, ont été primés.
Ils sont donc aussi considérés tels ses propres fils. Parmi les plus érudits et ceux très intelligents qui soient ! Eux aussi font honneur à la famille ! Bien plus que cela, ils le font de fort belle manière et pour toute l’Algérie, leur unique et véritable patrie !
Rachid Mimouni est donc cette plume multifonctionnelle qui trouve cette aisance à faire pâlir de jalousie ses semblables, puisqu’elle sait passer allègrement de ce style cocasse et très tenace à celui fin et très raffiné pour décrire ces scènes de la vie où se mêlent sans discernement et sans la moindre retenue l’amour, la sexualité, la dictature, le terrorisme, la hogra, la harga, la bureaucratie et tant d’autres maux sociaux qui constituent cette plaie sociale de l’Algérie des années deux mille.
Dans son style, il est incomparable tant ses parades et nombreuses escapades sont imparables, bien superbes et très subtiles. Souvent très utiles pour ces jeunes plumes qui cherchent à faire dans cette façon bien singulière sinon osée de narrer des évènements ou de raconter des récits dans ce bel art cursif de communiquer, avec beaucoup d’aisance et énormément de plaisir pour ces faces cachées de la vie en société.
Le choix de ses titres est déjà en soi une « invite express à leur lecture ». Et dès les premières lignes, c’est le lecteur qui s’y accroche ! Etait-il à ce point persuadé et si convaincu que c’est le titre de l’ouvrage qui accroche, sinon de lui-même le lecteur, vraiment dégoûté, décroche ?
En vérité, ni ses titres ni leurs contenus n’ont été en deçà des attentes de ce public qui connaissait déjà depuis le début des années soixante-dix la valeur réelle de « l’enfant du pays », et davantage avec cet « honneur de la tribu » dont il n’aura lésiné sur aucun moyen pour habilement le défendre, sinon farouchement le recouvrer.
A l’instar d’autres matheux comme Tahar Djaout, Anouar Benmalek et autres encore, Rachid Mimouni était donc happé par la magie des mots pour léguer à l’histoire les chiffres et leur exercice fastidieux.
Dans ce choix bien difficile, ce sont ces sciences exactes qui lui traceront sa carrière professionnelle pour être par la suite relayées par cette littérature de charme qui embarqua l’homme sur ce terrain magique des belles-lettres, celles qui le feront connaitre plus tard bien au-delà des murs algériens.
Ces chiffres-là lui auront probablement appris toute cette rigueur dans l’analyse des faits et évènements dont les lettres se chargeront tout à l’heure de leur bonne expression et magnifique traduction dans ce décor fascinant à plus d’un titre.
Il est parfois des choix ainsi faits. Et celui effectué par Rachid Mimouni à un moment crucial de sa vie a toujours été guidé par cet amour pour les lettres (bien souvent magiques) qui aura eu en fin de compte bien raison de ces chiffres immuables et par trop conventionnels.
A-t-il été très tôt inspiré ou admirablement séduit par un quelconque auteur classique pour le suivre plus tard à la « lettre » et au pas de charge sans se soucier de l’heure qu’il était, ni même de consulter « ces chiffres » que lui indiquait le cadrant de sa montre ?
Loin de ces chiffres assez fastidieux dans leur assemblage et expression, l’heure n’était-elle pas à ces joutes littéraires qui faisaient voyager l’être humain bien loin dans ses rêves les plus fous et les plus improbables ?
Pourtant à en croire l’auteur : « La mathématique est la seule véritable science. Tout le reste n’est que fioritures, ensemble de règles et de préceptes destinés à masquer un vide essentiel et surtout à décourager les amateurs. En mathématiques, les règles sont claires et connues à l’avance. C’est le seul exemple de vraie démocratie* ».
Rachid Mimouni était donc ce « fils du pauvre » semblable à celui décrit des années plus tôt par Mouloud Feraoun. Sa venue à la littérature, il la doit à son père, analphabète de son état, qui l’inscrivit à l’école française dès le début des années soixante du siècle dernier. Il venait d’un autre monde et ne disposait d’aucun livre chez lui.
Il était bien différent de ses semblables nommées Assia Djebbar, Maissa Bey, Ahlem Mostaghanemi et autres auteurs algériens qui ouvrèrent les yeux sur de véritables bibliothèques familiales appartenant à leurs géniteurs. Ce n’est d’ailleurs qu’en classe de 4ème qu’il s’intéressa à la littérature française en ayant eu à lire « le grand Meaulnes », œuvre qui le fascina et le consigna dans ces longues séances de lecture.
Ce fils du pauvre vivra dans la pauvreté pour mettre à profit ces moments de misère qui allèrent magistralement le propulser au sein de ce cercle très restreint des meilleures plumes du pays et du Maghreb.
Dans une « peine à vivre », l’auteur de la « Malédiction » fait ce « diagnostic clinique de la dictature dans le monde ». Il y décrit alors toute « cette peine à vivre » d’un peuple supportant très mal l’excès de zèle du tyran qui gouverne le pays d’une main de fer, au sein de ce parti unique grâce à ces méthodes iniques et peu pratiques alors en vigueur.
Il symbolise le dictateur à travers la panse de Idi Amin Dada, les insomnies de Staline, la moustache de Boumediene, les grossièretés en intimité de Hafidh El Assad, l’extravagance de Mouammar El Kadhafi et le regard trop méchant de Saddam Hussein. Tous ces présidents de fausses républiques incarnaient chacun à sa façon le dictateur de leur pays, que décrit Rachid Mimouni en appropriant au sien tous ces qualificatifs pour brouiller les pistes à celui qui cherche à s’y identifier grâce à quelques menus indices ou détails par trop insuffisants et peu consistants, glanés çà et là dans le texte de l’auteur.
Et c’est à la mesure des privilèges et à la hauteur des pouvoirs dont dispose le dictateur qu’il élève, lui, le sien et lui confère ce droit absolu de disposer de ses pauvres gouvernés comme de leur existence ou subite disparition et exécution sommaire ou sur le champ.
Rachid Mimouni utilisait à la perfection ce style de la rupture, du reste peu connu sinon totalement méconnu à cette date aux plumes Maghrébines, pour dénoncer ces pratiques en usage contre lesquelles s’élevait la morale citoyenne, aggravant de jour en jour la pauvreté de la basse société et enrichissant à l’extrême ces repus administrateurs de l’état.
Chez lui le style est très critique, semblable à la marque de l’impact d’un vrai stylet ; le verbe assez sec tel un claquement de fouet. Ses phrases sont tantôt très serrées et déballées dans cette spirale infinie et à la vitesse vertigineuse d’un sprinteur à l’approche de sa ligne d’arrivée, tantôt bien aérées, peu acérées et très espacées, exprimant ces images de contes de fées difficilement imaginables sans ce talent hors pair de celui qui les décrit si promptement.
Avec Rachid Mimouni, quelque soit la tragédie rapportée ou le malaise raconté, on est comme embarqué dans ce territoire de merveilles où les phrases parlent d’elles-mêmes, exprimant ces métaphores haut de gamme qui emportent le lecteur aussi loin que le mène les rêves les plus fous que seule la littérature de choix et de mérite est à même de susciter ou d’improviser.
Dans « une peine à vivre », Rachid Mimouni s’attaque à ces dictateurs dans le monde sans les nommer, prétextant que le sien habite ce pays sans nom ! Ce que d’ailleurs anonymat oblige, plume rédige, texte fustige et sécurité exige… !
Peut-être y cherchait-il après cette impossible « paix à vivre » pour ces éternels damnés de la terre ou de la mer ?
-
Giono, cette plume paysanne !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 3 commentaires
Jean Giono est l’un de ces rares auteurs à vous emporter en pleine nature, dès l’entame de la lecture de ses ouvrages. Dans Colline, il vous kidnappe à l’abordage de la première phrase de son titre. L’un des meilleurs que j’ai pu lire à présent, bien qu’il soit assez bref. Un peu bien concis.
Dans colline, vous êtes déjà en pleine campagne dès que vous ouvrez le livre. A peine entré dans son incipit.
 Viennent ensuite défiler sous vos yeux ou dans votre esprit, folio après folio, des collines, des prairies, des cours d’eau, des arbres, le territoire de son fief en haut relief, des troupeaux enserrés dans une bergerie, de la terre aride qui a soif de travail et d’eau, des terrains trop mouillés en dehors de la saison des pluies, et tout un monde paysan qui sait donner vie à sa campagne.
Viennent ensuite défiler sous vos yeux ou dans votre esprit, folio après folio, des collines, des prairies, des cours d’eau, des arbres, le territoire de son fief en haut relief, des troupeaux enserrés dans une bergerie, de la terre aride qui a soif de travail et d’eau, des terrains trop mouillés en dehors de la saison des pluies, et tout un monde paysan qui sait donner vie à sa campagne.L’auteur aime beaucoup la nature au point où il devint cette plume bien paysanne, laquelle décrit à merveille son berceau et reproduit à souhait cette vie dure et très difficile du monde rural, l’été venu, saison de l’effort et des grandes moissons.
Lourdement vêtu de ses idées géniales et phrases volées à l’idylle de la belle nature, tel un bon paysan vautré et calfeutré dans ses vieux guêtres, il vous étalera tous ses habits un instant plutôt portés à la moindre sollicitation, vous donnant au passage un net aperçu de cette hospitalité débordante de générosité propre au monde rural.
Giono est du genre à vous faire de nouveau découvrir ces lieux que vous avez déjà visités sans que vous ayez cette présence d’esprit à y bien voir ce dont il vous en parlera bien longtemps, s’attardant sur leurs menus détails qui forcent pourtant l’admiration.
Pareil à un roi dans son royaume, c’est dans sa chaumière qu’il est fier, détendu et bien inspiré, contant et racontant ce monde qui le fascine et le consigne chez lui pour lui réserver en retour le meilleur de soi-même, ce plus qu’il est le seul à pouvoir donner et savoir si bien le décrire.
Giono cultive cet art de la facilité des mots, de la simplicité des phrases, de la limpidité de l’expression puisée dans ces clairs cours d’eau, de la forte émotion qui vous secoue la mémoire et ravive l’esprit.
Lorsqu’il vous parle de la nature, c’est à croire qu’il est déjà dans son champ, travaillant la terre de ses aïeux, suivant leurs conseils et exauçant leurs vœux les plus chers. De derrière chaque colline il vous bondira tel un vrai loup, assoiffé de vous montrer sa belle contrée.
De derrière chaque rivière ou sur l’une de ses deux rives, il vous montrera le chemin à suivre de ce cours d’eau, l’espace de sa naissance comme celui de sa connexion aux autres affluents.
Jean Giono est pour Manosque-Les-Plateaux ce que John Steinbeck est pour la Salinas, ce que Gabriel Garcia Marquez est pour Maconde, ce que Michel Ragon est pour La Vendée, ce que Félix Leclerc est pour La Tuque (Québec).
En bon ami de la nature, il ne put se séparer de Manosque-les-plateaux où il a tout le temps vécu, ne la quittant que très rarement afin de rencontrer ses éditeurs et ses nombreux lecteurs.
Il est resté très fidèle à sa terre natale comme on le demeure pour toujours envers notre mère-nourricière, vantant ses splendeurs et ses prestiges, et décrivant ses jours pluvieux et de plein soleil. Il y aura vécu toute sa vie, lui consacrant le plus précieux de son temps.
A Manosque-les-plateaux, comme un poisson dans l’eau, Jean Giono est bien chez lui ; là où il aimerait bien y être et longtemps y demeurer. En bon ami de la nature, il n’aura jamais quitté son village natal, lui réservant ses meilleurs écrits, rythmés comme le vent qui parcourt dans tous les sens la contrée.
Dans le Déserteur, ce fut la première fois que Jean Giono avait quitté Manosque-Les-Plateaux et la Provence, mais c’était juste dans des écrits ; voulant sans aucun doute diversifier leur nature, objet et cadre de vie en allant enquêter dans Le Valais afin de créer l’histoire du héros dont son titre portera le nom.
Il lui aura offert toute une poésie haut de gamme et des textes de très grande qualité littéraire, pleins de sens et de saveur du terroir. N’oubliant ni le chant de ses nombreuses fontaines ni le murmure continu des vents.
Dans ses écrits, ses nombreux lecteurs ont toujours rendez-vous avec un arbre qui fleurit, un champ qui verdit, un cours d’eau très limpide qui séduit, une belle nature qui vous sourit. Bref, un monde qui à travers ses multiples atouts et nombreux atours énormément éblouit !
Sans Colline, toutes les collines de la Provence seraient restées probablement toujours inconnues par les habitants de ces mêmes lieux. Bien avant les autres ou leurs semblables de par le monde, parce qu’il détient cette providence à les décrire dans leur état de folie, de paix et de plaisir d’y vivre, mais aussi de tristesse lors de leurs nuits hivernales où elles affrontent bien seules les rigueurs de la saison et les affres de la dure nature, faites de tempêtes, de vents violents, de pluie et de neige continus.
Jean Giono restera parmi ces rares auteurs dont le héros de leur roman n’est autre qu’un vieil arbre, un minable hameau, un chétif rameau, un tout petit ruisseau, une terre très aride ou zébrée de ses nombreux bourrelets, une colline en forme de sein de femme tourné vers un ciel très haut et très beau, une source d’eau menacée de disparition, un troupeau de
moutons hébétés et apeurés par un féroce loup ayant les deux pattes avant en l’air, un cheval qui danse dans son trot, des oiseaux pris de joie ou de panique, un soleil confondu dans l’euphorie de ses brillants rayons en flèches cuivrées ou dorées, une fontaine dont le surplus coule en deux sources, une masure qui émerge à peine de ses blés drus et hauts…
Il restera cette plume alerte et experte qui hume l’odeur du pays, répandant au loin son parfum et ses nombreux bienfaits.
Dans ses écrits c’est le monde rural qui est en fête, la contrée paysanne baignant dans l’allégresse, arborant ses plus beaux habits et belles couleurs qui séduisent le monde et donnent vie à la nature.
En 1957, lorsqu’il décida de publier, à travers toute la planète, cette nouvelle intitulée L’homme qui plantait des arbres, écrite déjà trois ans plus tôt, Jean Giono se donnait alors, sans vraiment le vouloir ou le savoir, la dimension d’un véritable ambassadeur de la nature.
Ainsi, la réputation d’Elzéard Bouffer, le héros de la nouvelle, allait dépasser ce seul territoire à reboiser dans le Vaucluse français. Et toutes les nations se sentaient concernées à telle enseigne qu’on cherchait par tous les moyens à connaitre ce planteur d’arbres bien imaginaire.
Par millions, ils prenaient conscience de la grande utilité de l’arbre dans leur vie quotidienne. Giono était déjà aux anges. Depuis, il n’est plus redescendu de son nuage. Il flotte toujours dans notre mémoire à mesure que le vent farfouille dans les feuilles de ces arbres plantés suite à cette amicale ‘’ injonction’’.
Une belle initiative qui donne encore vie à l’auteur de Colline.
-
Kateb Yacine / Déjà auteur à 17 ans !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 3 commentaires
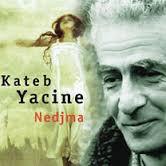 Oh oui, à juste 17 ans ! Et encore adolescent ! Il aurait pu rejoindre sur ce glorieux registre Honoré de Balzac et autres lumineuses plumes ! Mais, c’était sans compter avec la révolution et ses nombreuses contraintes. Les quelques mois qui séparent les deux auteurs de renom démontrent, à l’évidence, à quel point « aux âmes bien nées, la valeur n’attendra point le nombre des années ».
Oh oui, à juste 17 ans ! Et encore adolescent ! Il aurait pu rejoindre sur ce glorieux registre Honoré de Balzac et autres lumineuses plumes ! Mais, c’était sans compter avec la révolution et ses nombreuses contraintes. Les quelques mois qui séparent les deux auteurs de renom démontrent, à l’évidence, à quel point « aux âmes bien nées, la valeur n’attendra point le nombre des années ».En effet, c’est en 1948, aux Editions ‘’En Nahdha**’’ que Kateb Yacine publia son premier titre, intitulé ‘’ Abdelkader et l’indépendance algérienne’’, juste après avoir tenté un premier essai avec son recueil de poèmes ‘’Soliloques’’ chez Thomas – Bône (1946). Ce fut donc tout juste une année après les sanglants massacres du 08 Mai 1945.
Kateb Yacine habitait alors Sétif. Chez ses parents, bien sûr. Il y avait comme tous les algériens défilé dans ses rues bondées de monde, crié son malheur et misérable condition d’indigène spolié de son territoire, richesse, liberté, langue et dignité.
La deuxième guerre mondiale livrait l’Alsace et la Lorraine de nouveau à la France. Dans le même sillage, l’Algérie réclamait à la France l’intégralité de son territoire et identité. Au niet catégorique français répondront intempestivement ces manifestations sporadiques algériennes.
Et ce fut donc ces mouvements de foule continus, entre autres, à Sétif. Kateb Yacine y était, drapeau main. Comme tous ses concitoyens qui auront échappé à la mort plus que certaine, il sera incarcéré.
Sa détention aura duré cinq longs mois. Il ne dut sa libération que sous caution d’une intervention parentale affiliée au secteur considéré, dont il usera d’ailleurs à bon escient.
Sitôt libéré en léger différé et en l’absence du moindre délibéré, le rebelle restera toujours fidèle à ses idéaux et aux grands héros de la révolution algérienne.
Afin de l’aborder par le bon bout, il remontra jusqu’aux sources et origines du mouvement national algérien, consacrant tout un livre à celui qui fut le véritable fondateur de l’état algérien moderne.
Bien qu’encore tout jeune adolescent, il écrira ce somptueux ouvrage complètement consacré à l’Emir Abdelkader, contenant en tout et pour tout moins de cinquante pages.
Et dès l’incipit, il met son monde au contact de ce véritable monstre, à la fois, combattant, cavalier, auteur, poète, exégète, penseur, guerrier, stratège et homme de loi et de foi…
Pour aller droit au but, il paraphrase son héros grâce à cette citation de grande qualité littéraire et utilité civique publique considérable: « C’est par la vérité qu’on apprend à connaitre les hommes, et non par les hommes qu’on connait la vérité… ».
Ainsi, le commentaire qui suit résume à lui seul tout le contenu de l’ouvrage. Il y est écrit, je cite : ‘’Cette parole suffit à éclairer le fond même de la vie et de l’action d’Abdelkader’’.
C’était une façon bien singulière de présenter son grand héros, cet ‘’homme de piété, de goût et de bon conseil’’. Le reste de l’ouvrage portera sur son combat, sa résistance, sa bravoure, ses séjours (en France et en Syrie), son traité, son œuvre de grand intérêt pour de nombreuses communautés…
En 1883, peu avant sa mort, à Damas, l’Emir Abdelkader faisait ce souhait : « Je ne doute pas que l’Algérie accomplira son destin ».
Depuis, le destin de l’auteur est resté toujours lié à celui de son héros, accroché aux basques de l’œuvre de grande importance et qualité extraordinaire qu’il aura réalisée pour l’histoire et pour le pays. Seulement, dans l’intervalle, une belle et très érudite plume venait de naitre.
Il ne lui faudra pas plus qu’une petite brochette d’années afin de mieux s’affirmer, d’éclore convenablement et complètement, peaufinant et confirmant à mesure que les jours passent sa véritable ascension et indéniable promotion.
Avec Nedjma, son étoile brillera sous d’autres cieux, bien plus loin que son pays, l’Algérie. Il était à la recherche de cette lumière afin de bien éclairer avec son chemin et celui qui mènera juste quelques années plus tard à l’indépendance de son pays.
Ensuite, ce fut des titres à la série, tous aussi remarquablement bien écrits les uns comme les autres ; chose qui lui valut d’être longtemps porté en véritable héros en dehors des murs algériens et surtout d’être cité parmi les cinquante et une personnalités –presque toutes de grandes plumes- ayant les plus compté dans la vie de Jean Daniel***.
A l’indépendance de l’Algérie, Kateb Yacine dont Nedjma sera considéré le texte fondamental de la littérature algérienne d’expression française, n’ouvrira paradoxalement droit ni au ‘’Panthéon littéraire algérien’’ grâce à ses magnifiques œuvres ni même à la juste récompense du tribut payé à la révolution.
Lui-même, d’ailleurs, n’en voulait pas. Juste quelques pièces de théâtre meubleront son temps pour tenir enfin le coup, avant de tirer sa révérence dans la plus totale indifférence, solitude et grande ignorance de la sphère politique et culturelle de son pays.
Cet état d’esprit n’était donc pas nouveau pour lui. Déjà, du temps de Boumediene, le natif de Guelma n’était d’ailleurs pas en odeur de sainteté avec ce fils du pays qui muselait toute idée contraire à la sienne.
Et de nouveau, ce fut l’impasse pour lui. Elle durera d’ailleurs de bien longues décennies. Nedjma brillait bien plus ailleurs qu’en Algérie. Elle illuminera d’ailleurs tout son monde. Son auteur était resté depuis bien muet ! Circonspect !
Même si en 1976 il aura droit à quelques discours de circonstance ou de convenance, le temps de pimenter la dernière mouture de la charte nationale, revue et corrigée en 1986 avant d’être complètement remise en cause avec l’avènement de la constitution de 1989.
Ce fut donc l’année du décès du maitre de Nedjma. Juste quelques mois seulement après son adoption. Mais, notre auteur, gravement malade, ne survivra pas longtemps à cette parenthèse de l’ouverture politique et médiatique, aussitôt refermée comme ce fut de coutume, hier et jadis.
(*) Corneille – Le Cid.
(**) Kateb Yacine – Abdelkader et l’indépendance algérienne, Editions En Nahdha (1948) ; réédité en 1983 par le SNED (Algérie).
(***) Jean Daniel – les Miens folio- Gallimard – 2010. -
Des Auteurs et de leurs Œuvres
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 4 commentaires
En préfaçant l’ouvrage de Laurent Gagnebin* relatif à la critique de l’ensemble de son œuvre, Simone de Beauvoir devait conclure par : « On me lira mieux, vous ayant lu. C’est de grand cœur que je vous dis : merci ! »
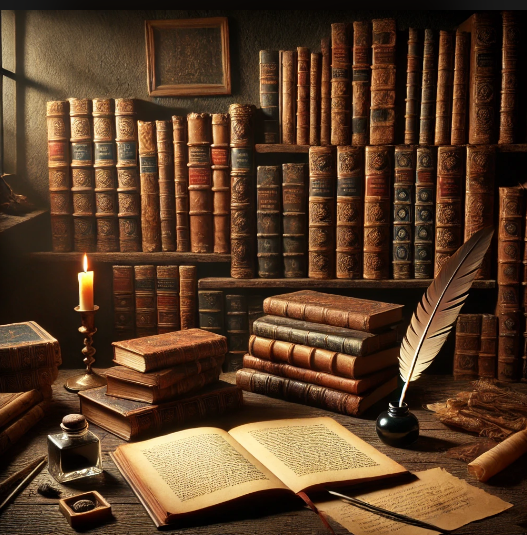
L’ouvrage en question s’intitulant « Simone de Beauvoir ou le refus de l’indifférence » ouvre sur un chapitre introducteur titré au travers « Une vocation » avec en prime, comme cerise sur le gâteau, cette question pertinente : pourquoi Simone de Beauvoir et non Sartre ?
Comme conclusion à cette très courte préface, on ne peut trouver mieux au plan de la réflexion, de la concision et de la précision. L’auteur, objet de la critique littéraire, se donne donc la pleine mesure de profiter de la critique qui lui est réservée et annonce déjà cet effet de synergie entre son œuvre et le titre qui en fait la critique.
Du coup, préfacer sa propre critique relève de ce grand fair-play littéraire dont Simone de Beauvoir s’est drapée pour démontrer le sens de cette capacité à d’abord assumer les observations, remarques, comparaisons et conclusions de son critique littéraire.
L’approche étant remarquablement bien menée. La finalité de ce travail ne pouvait inexorablement que vraiment plaire aux deux auteurs, celui dont les ouvrages auront été passés au crible en premier.
D’où d’ailleurs, cette petite conclusion en guise de remerciements. De compliments !
Entre ces deux auteurs, l’œuvre de l’un est l’objet d’un diagnostic que contient l’ouvrage de l’autre : son critique littéraire. Quant à lier l’incidence de la critique littéraire sur la lecture de l’œuvre complète de l’auteur objet de cette « rétrospective », il y a incontestablement de la sagesse dans les propos de cette grande Dame de Lettres.
On ne pouvait donc trouver meilleur moyen d’aborder pareil sujet, trop compliqué et assez difficile à cerner dans son ensemble. Surtout que leur avenir littéraire est du coup bien lié.
Cependant cette même question pose problème entre auteurs algériens et se trouve être très différente de l’exemple suscité dans sa configuration comme dans le fond.
La polémique opposant Rachid Boudjedra à Yasmina Khadra, deux auteurs assez prolifiques, du reste, lors de la tenue du Salon du livre (17ème SILA), en donne, en effet, cette preuve irréfutable que la donne littéraire algérienne est vraiment bien différente.
À l’inverse de l’exemple donné en introduction, le climat régnant entre auteurs algériens, à un haut niveau surtout, demeure assez violent, suspicieux, très complexe et bien dangereux pour la littérature algérienne.
Chacun d’eux fait de son livre son propre territoire, sa seule médaille, son unique logis, son exclusif Paradis, son grand fusil, ses propres galons, ses seuls mérites et tout un univers bien gardé.
On aura à distance taquiné l’autre, peut-être sans le vouloir discuté avec lui, indirectement, à distance et à couteaux tirés, provoqué son semblable, chambré cet autre auteur et bien indisposé tout son monde.
Le tout était de paraitre comme le plus fort, le meilleur de tous, le plus lu et plus considéré dans le monde, trônant son charme et étrennant son grand palmarès alentour et plus loin à l’horizon ou du manoir.
Ils nous auront fait oublier, l’espace d’une querelle byzantine, tant de belles plumes nominées et très distinguées, nobélisées et très bien valorisées.
La raison ? Ce sont eux qui se considéraient être les meilleurs –ou tout comme- en Algérie, nous brouillant la vue au loin et nous prenant en otage dans leurs abyssales analyses stériles, de leadership inconséquent et inconvenant.
Celui-ci traite celui-là de tous les noms d’oiseaux, alors que ce dernier répond au premier d’une manière moins élégante, plutôt malveillante. Et les deux versent intempestivement dans ces diatribes violentes et à peine injurieuses, indignes de ce haut rang qui est le leur.
Et dire que le premier avait honorablement fait le maquis et que le second venait depuis quelques années seulement de prendre sa quille, en leurs qualités respectives d’ancien maquisard et de haut gradé militaire.
Etait-ce cet uniforme qui leur donne toutes ces formes et trajectoires bien difformes pour aussi dangereusement ternir cette image de marque de la littérature algérienne qui peine déjà à trouver ses bonnes marques à l’étranger comme à l’intérieur du pays?
Aller jusqu’à se traiter mutuellement de tous ces noms et mauvaises expressions ; en fait : d’être ‘’tout sauf un écrivain’’ pour l’un, et de taxer celui-là ‘’d’être dans la contrainte’’ ne relève-t-il pas de cette insulte à la littérature ?!
Et pourquoi donc en arriver là ? Pourquoi pour l’un se mouvoir en censeur de toute une collective histoire bien glorieuse et très civilisatrice, et pour l’autre se cacher derrière cette fonction officielle et aura propre à cette « ouverture occidentale »?
Le peuple algérien n’a que foutre de ce que peut bien penser Gabriel Garcia Marquez des auteurs algériens et de la littérature algérienne. Il veut juger lui-même, par ses propres moyens, de leurs œuvres complètes sur pièce et sur place, et surtout de leur intérêt à porter très haut l’étendard algérien dans ce ciel de belles lettres et de grandes merveilles scripturales.
Un salon du livre à hauteur de celui qui se tient chaque année à Alger n’a que faire de ces « tirs à boulets rouges » dont participent à longueur de temps des plumes trempées dans la haine de l’autre, sans jamais élever le niveau de notre littérature.
Le « fauteuil » de littérature est très mouvant et bien chavirant, nous n’en voudrons pour preuve que ce prix Nobel qui change chaque année de titulaire.
Et s’il reste cet objectif que convoite toute plume confirmée et bien affirmée, seule la sagesse des propos et des acteurs intéressés à côté de leurs œuvres de mérite peut bien y mener un jour.
Ici, nous sommes bien loin de cette conclusion relative à cette très subtile et honnête préface de Simone de Beauvoir.
On dirait qu’on aborde un autre sujet, qu’on dérape sur un autre terrain, qu’on s’installe dans un autre univers !
Revenons donc vite à notre belle littérature … ! On était sur un terrain miné !
-
Cheikh Embarek, notre sympathique Salazar !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 6 commentaires
Du haut de son un mètre quatre-vingt-quinze, il ne pouvait être que le chef de tout son monde. Très grand de taille, il l’était également par le Savoir.
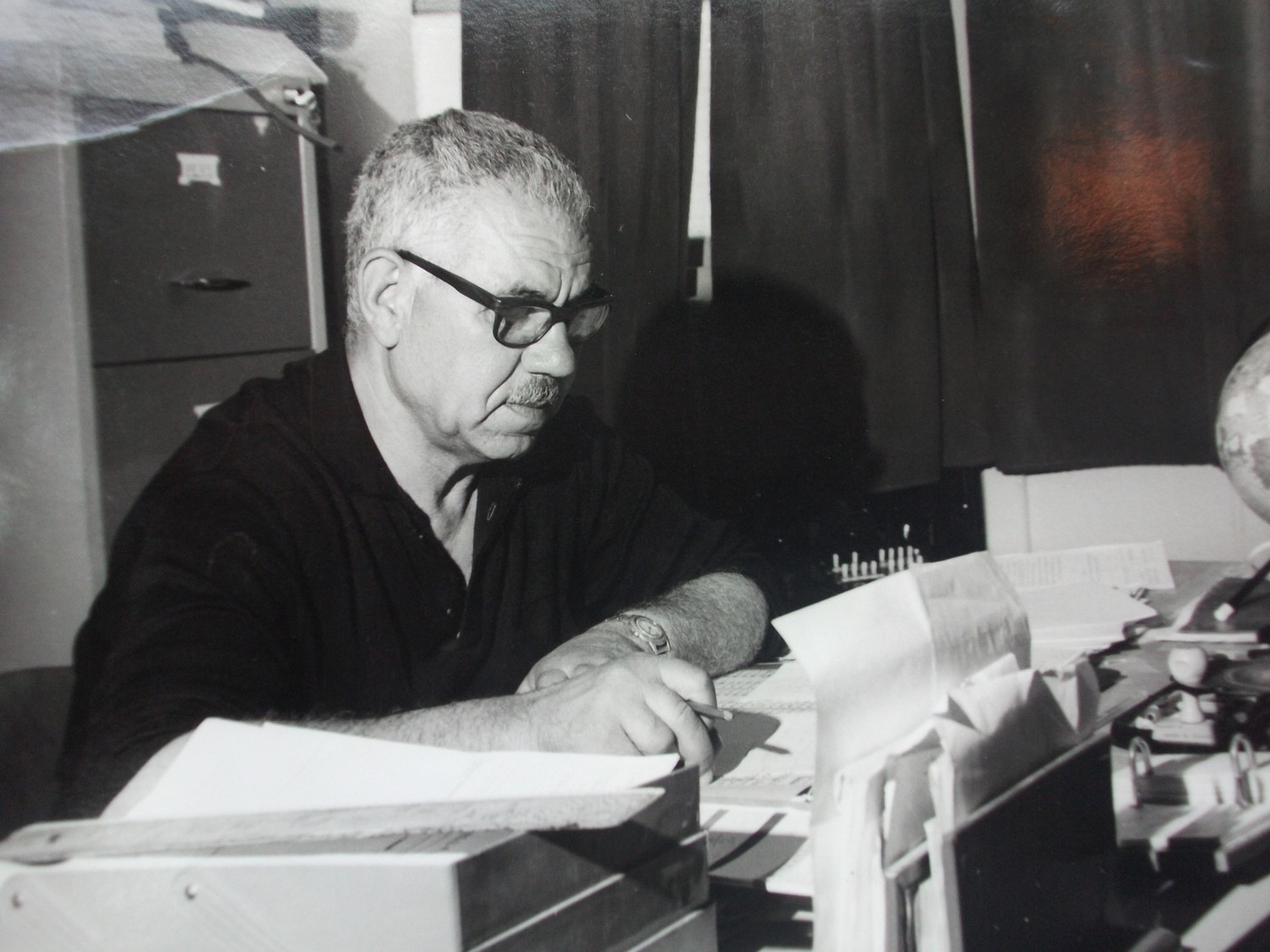 Déjà instituteur du temps de la colonie française, il s’est vu, à l’Indépendance du pays, confier la direction de la seule école primaire de garçons de la contrée. Il aura à inaugurer, juste deux années plus tard, son unique collège. Il s’y installera à sa tête, alors en catastrophe, afin de pourvoir à un besoin devenu bel et bien très urgent et très pressent. Il s’y affairera afin de pallier à une urgence en la matière et de faire sortir de l’anonymat toute une flopée de jeunes cadres de la nation, ayant tous fourbi leurs armes et appris cet inestimable savoir sur ces mêmes bancs d’école d’autrefois où ils usèrent leur fond de culotte plus de quatre années durant. On l’appelait donc à cette époque-là Salazar, sans même savoir vraiment à quoi cela rimait ou nous renvoyait finalement. Probablement, parce qu’il était très autoritaire. Nous étions très jeunes et il nous faisait très peur, rien qu’à le croiser déambulant à l’intérieur du préau des classes ou dans les couloirs de l’établissement. Il n’était d’ailleurs pas le seul à jouir de cette taille impressionnante, puisque Mograni, son surveillant général, l’était, lui aussi, étant, en fait, très fort physiquement et bien plus jeune que lui. Ainsi, cheikh Embarek héritait du surnom de Salazar, et Mograni, son surgé tout le temps insurgé, de celui de Mogo. Ce fut tout juste un diminutif du nom pour ce véritable gang. Les deux étaient donc très grands de taille, et loin d’être de simples échalas. C’étaient des mastodontes en puissance aux mains longues, rugueuses et bien grandes dont la claque sur la joue de l’élève restituait ou faisait plus loin trainer le bruit sonore et sulfureux de ce coup sec et habile de l’éclat d’un fouet. Aller à la surveillance était synonyme donc de partir en enfer. La dose de la note à récupérer était d’ailleurs bien connue de tous les élèves : une raclée sous la forme d’une bonne paire de gifles qui vous fera bourdonner les oreilles pour tout le restant de la matinée. Mogo était donc connu au travers de cette force de frappe impressionnante et bien infamante qui crevait du premier coup le tympan au malheureux adolescent, et Salazar l’était lui aussi pour ses coups de règles répétés et rigoureux qui vous feront gonfler la paume des mains pour quelques jours au moins. Dans les deux cas de figure et chez ces deux grands gaillards, le châtiment n’était autre que cette grande misère, un vrai calvaire, une véritable galère, la tannée instantanée, le dur coup de gourdin ou celui de cette raclée avec à la clef des joues rouges à les faire instantanément jaillir de sang, des yeux embués à cracher rapidement des larmes, une tête de taulier à faire frissonner les plus grands truands, un air désemparé à complètement chambouler l’esprit de ses inconscients camarades de classe… Plus dur comme châtiment, il n’y avait que celui du pénitencier dont on entendait vaguement parler à l’époque, puisque étant tous de très jeunes collégiens. Seulement, nous le considérions bien plus dur que celui que nous infligeait communément nos propres parents en fin de trimestre lorsque nos résultats et classement étaient peu reluisants ou pas du tout convaincants. Salazar, comme un malabar, veillait sur nous comme un tour tout alentour, dans une discipline de fer. Il incarnait cette autorité méritée, entière, parfaite, ni partagée ni ménagée, fortement engagée et au loin propagée, de la toile de cette haute dragée et jamais dérangée dans son ascension ou véritable apogée. Tôt le matin, à la porte d’entrée, il inspectait tout son monde, vérifiant la propreté des pieds, la longueur des ongles, des cheveux, la tenue vestimentaire débrayée ou inappropriée de certains élèves, leurs affaires scolaires, leurs devoirs, leur comportement, leur disponibilité à pouvoir convenablement étudier… Il connaissait pratiquement tout son monde, exceptés ces quelques rares anonymes élèves, si modestes, bien quelconques et très gentils jusqu’à passer inaperçus entre les mailles du contrôle ou lui filant entre les grands doigts. Il n’oubliait rien, se rappelant de tout et s’accrochait parfois à de menus détails qui nous paraissaient bien insignifiants ou sans la moindre incidence sur notre scolarité. Notre Salazar n’avait rien d’un Portugais, puisque n’étant porté ni sur le ferment et dur Porto ni même sur la pêche à long cours. Il partageait néanmoins avec le dictateur, portant le nom d’origine, sa façon de mener par le feu et par le fer leurs troupes, et surtout le côté académique de leur vie privée. Elle était rythmée à cette cadence infernale qui nous donnait la frousse même de tenter de lever sur lui nos pupilles, de se retourner en arrière ou de pousser le moindre cri et de faire l’essai du tout bénin mouvement. A l’école, nous étions tous comme à la caserne, le crâne bien rasé et sans le moindre uniforme ou un quelconque béret. On était donc ces papilles ou pupilles aux frêles et toutes innocences pupilles, cette autre pâte à modeler ou à convenance remodeler, à répétition ou à satiété tripoter. Il en sortira plus tard cette poterie de grande valeur, flopée d’étoiles, forgée à la maison avec grande rigueur, passion et utile raison de faire, laquelle trouvera bonne place à l’intérieur de ces grandes galeries d’art et de métier d’avenir et d’honneur qui feront tressaillir ou pâlir de jalousie ses pairs des autres établissements d’enseignement de la contrée. A l’Indépendance, il fut l’un de ces rares Algériens lettrés qu’avait malencontreusement produit une colonie française à bout de peine, vieille de plus de quatre générations bien accomplies. Il lisait beaucoup et s’appliquait à régulièrement nous parler dans ce français châtié et officiel digne du langage des grands praticiens du droit, en signe de reconnaissance au statut du grand chef qu’il arborait. Notre directeur était ce terrible dictateur que tout le monde craignait, que tout le monde, à la ronde, autant que faire se peut, évitait de lui adresser la parole ou même de se proposer d’aller voir même en cas d’une nécessité absolue ou d’un besoin impérieux. Il régnait déjà en maître absolu sur son monde, donnant des ordres par-ci et prodiguant des conseils par-là. Il était cette haute tour de contrôle qui contrôlait tout à l’horizon. Il ne laissait rien passer, filtrant toute les issues, toutes les discussions, les actions, les mouvements et autres tournures des évènements. Bien mieux, il y trouvera même le temps de faire de la politique à ses heures perdues ou de repos. Ainsi au petit Moscou, sa ville natale, il ne pouvait donc passer inaperçu. La question n’a donc rien à voir avec sa taille géante, ni même avec son grand Savoir et connaissances insoupçonnées. Elle a plutôt trait à son engagement politique sans faille en faveur de cette option politique «très socialiste» qui dérangeait l’oligarchie de la haute sphère du pouvoir, lequel décidera sur un coup de tête ou fourré et bien préparé de l’incarcérer durant de nombreuses semaines en compagnie de quelques misérables enseignants, pris pour des amateurs de la politique très dangereux pour la nation. Ce fut juste après ce tragique accident de la circulation qui l’handicapa quelque peu pour le contraindre à s’appuyer durant un bon moment sur sa canne, à la manière d’un véritable Empereur. En fin de carrière, un érudit théologien usa de sa diplomatie, de son aura et de sa grande stature afin de bénéficier de sa subtilité, position et grande influence sur l’administration à l’effet d’aider la confrérie à finir la construction de cette importante et imposante mosquée d’El Khadra de la ville dont il présidera la commission de son suivi organique, devenant l’un des nombreux fidèles de haut rang et grand poids social de la communauté musulmane de la contrée. Depuis sa retraite méritée, les gens du métier sont presque tous unanimes à affirmer que l’enseignement n’a plus la même valeur qu’autrefois et hier encore, n’est plus aussi ferme, aussi fécond, ne produit plus cette érudition du grand Savoir très utile à la nation. Nous sommes, avouent-ils, dans l’impasse de cette mauvaise passe qui nous éloigne davantage du Savoir et de ces valeurs hautement significatives propres à cet enseignement de haut rang que savaient si bien nous prodiguer cette race d’enseignants de valeur inestimable et incomparable, aujourd’hui absente à jamais de nos établissements scolaires. La perte ne peut être qu’énorme au vu de ce grand ratage et plus grand dérapage de tout un haut aréopage de carriéristes ministres de l’Education, devenus plus persistants avec la disparition en cascade de ces figures de proue du Savoir dans toute l’étendue de sa grande dimension.
Déjà instituteur du temps de la colonie française, il s’est vu, à l’Indépendance du pays, confier la direction de la seule école primaire de garçons de la contrée. Il aura à inaugurer, juste deux années plus tard, son unique collège. Il s’y installera à sa tête, alors en catastrophe, afin de pourvoir à un besoin devenu bel et bien très urgent et très pressent. Il s’y affairera afin de pallier à une urgence en la matière et de faire sortir de l’anonymat toute une flopée de jeunes cadres de la nation, ayant tous fourbi leurs armes et appris cet inestimable savoir sur ces mêmes bancs d’école d’autrefois où ils usèrent leur fond de culotte plus de quatre années durant. On l’appelait donc à cette époque-là Salazar, sans même savoir vraiment à quoi cela rimait ou nous renvoyait finalement. Probablement, parce qu’il était très autoritaire. Nous étions très jeunes et il nous faisait très peur, rien qu’à le croiser déambulant à l’intérieur du préau des classes ou dans les couloirs de l’établissement. Il n’était d’ailleurs pas le seul à jouir de cette taille impressionnante, puisque Mograni, son surveillant général, l’était, lui aussi, étant, en fait, très fort physiquement et bien plus jeune que lui. Ainsi, cheikh Embarek héritait du surnom de Salazar, et Mograni, son surgé tout le temps insurgé, de celui de Mogo. Ce fut tout juste un diminutif du nom pour ce véritable gang. Les deux étaient donc très grands de taille, et loin d’être de simples échalas. C’étaient des mastodontes en puissance aux mains longues, rugueuses et bien grandes dont la claque sur la joue de l’élève restituait ou faisait plus loin trainer le bruit sonore et sulfureux de ce coup sec et habile de l’éclat d’un fouet. Aller à la surveillance était synonyme donc de partir en enfer. La dose de la note à récupérer était d’ailleurs bien connue de tous les élèves : une raclée sous la forme d’une bonne paire de gifles qui vous fera bourdonner les oreilles pour tout le restant de la matinée. Mogo était donc connu au travers de cette force de frappe impressionnante et bien infamante qui crevait du premier coup le tympan au malheureux adolescent, et Salazar l’était lui aussi pour ses coups de règles répétés et rigoureux qui vous feront gonfler la paume des mains pour quelques jours au moins. Dans les deux cas de figure et chez ces deux grands gaillards, le châtiment n’était autre que cette grande misère, un vrai calvaire, une véritable galère, la tannée instantanée, le dur coup de gourdin ou celui de cette raclée avec à la clef des joues rouges à les faire instantanément jaillir de sang, des yeux embués à cracher rapidement des larmes, une tête de taulier à faire frissonner les plus grands truands, un air désemparé à complètement chambouler l’esprit de ses inconscients camarades de classe… Plus dur comme châtiment, il n’y avait que celui du pénitencier dont on entendait vaguement parler à l’époque, puisque étant tous de très jeunes collégiens. Seulement, nous le considérions bien plus dur que celui que nous infligeait communément nos propres parents en fin de trimestre lorsque nos résultats et classement étaient peu reluisants ou pas du tout convaincants. Salazar, comme un malabar, veillait sur nous comme un tour tout alentour, dans une discipline de fer. Il incarnait cette autorité méritée, entière, parfaite, ni partagée ni ménagée, fortement engagée et au loin propagée, de la toile de cette haute dragée et jamais dérangée dans son ascension ou véritable apogée. Tôt le matin, à la porte d’entrée, il inspectait tout son monde, vérifiant la propreté des pieds, la longueur des ongles, des cheveux, la tenue vestimentaire débrayée ou inappropriée de certains élèves, leurs affaires scolaires, leurs devoirs, leur comportement, leur disponibilité à pouvoir convenablement étudier… Il connaissait pratiquement tout son monde, exceptés ces quelques rares anonymes élèves, si modestes, bien quelconques et très gentils jusqu’à passer inaperçus entre les mailles du contrôle ou lui filant entre les grands doigts. Il n’oubliait rien, se rappelant de tout et s’accrochait parfois à de menus détails qui nous paraissaient bien insignifiants ou sans la moindre incidence sur notre scolarité. Notre Salazar n’avait rien d’un Portugais, puisque n’étant porté ni sur le ferment et dur Porto ni même sur la pêche à long cours. Il partageait néanmoins avec le dictateur, portant le nom d’origine, sa façon de mener par le feu et par le fer leurs troupes, et surtout le côté académique de leur vie privée. Elle était rythmée à cette cadence infernale qui nous donnait la frousse même de tenter de lever sur lui nos pupilles, de se retourner en arrière ou de pousser le moindre cri et de faire l’essai du tout bénin mouvement. A l’école, nous étions tous comme à la caserne, le crâne bien rasé et sans le moindre uniforme ou un quelconque béret. On était donc ces papilles ou pupilles aux frêles et toutes innocences pupilles, cette autre pâte à modeler ou à convenance remodeler, à répétition ou à satiété tripoter. Il en sortira plus tard cette poterie de grande valeur, flopée d’étoiles, forgée à la maison avec grande rigueur, passion et utile raison de faire, laquelle trouvera bonne place à l’intérieur de ces grandes galeries d’art et de métier d’avenir et d’honneur qui feront tressaillir ou pâlir de jalousie ses pairs des autres établissements d’enseignement de la contrée. A l’Indépendance, il fut l’un de ces rares Algériens lettrés qu’avait malencontreusement produit une colonie française à bout de peine, vieille de plus de quatre générations bien accomplies. Il lisait beaucoup et s’appliquait à régulièrement nous parler dans ce français châtié et officiel digne du langage des grands praticiens du droit, en signe de reconnaissance au statut du grand chef qu’il arborait. Notre directeur était ce terrible dictateur que tout le monde craignait, que tout le monde, à la ronde, autant que faire se peut, évitait de lui adresser la parole ou même de se proposer d’aller voir même en cas d’une nécessité absolue ou d’un besoin impérieux. Il régnait déjà en maître absolu sur son monde, donnant des ordres par-ci et prodiguant des conseils par-là. Il était cette haute tour de contrôle qui contrôlait tout à l’horizon. Il ne laissait rien passer, filtrant toute les issues, toutes les discussions, les actions, les mouvements et autres tournures des évènements. Bien mieux, il y trouvera même le temps de faire de la politique à ses heures perdues ou de repos. Ainsi au petit Moscou, sa ville natale, il ne pouvait donc passer inaperçu. La question n’a donc rien à voir avec sa taille géante, ni même avec son grand Savoir et connaissances insoupçonnées. Elle a plutôt trait à son engagement politique sans faille en faveur de cette option politique «très socialiste» qui dérangeait l’oligarchie de la haute sphère du pouvoir, lequel décidera sur un coup de tête ou fourré et bien préparé de l’incarcérer durant de nombreuses semaines en compagnie de quelques misérables enseignants, pris pour des amateurs de la politique très dangereux pour la nation. Ce fut juste après ce tragique accident de la circulation qui l’handicapa quelque peu pour le contraindre à s’appuyer durant un bon moment sur sa canne, à la manière d’un véritable Empereur. En fin de carrière, un érudit théologien usa de sa diplomatie, de son aura et de sa grande stature afin de bénéficier de sa subtilité, position et grande influence sur l’administration à l’effet d’aider la confrérie à finir la construction de cette importante et imposante mosquée d’El Khadra de la ville dont il présidera la commission de son suivi organique, devenant l’un des nombreux fidèles de haut rang et grand poids social de la communauté musulmane de la contrée. Depuis sa retraite méritée, les gens du métier sont presque tous unanimes à affirmer que l’enseignement n’a plus la même valeur qu’autrefois et hier encore, n’est plus aussi ferme, aussi fécond, ne produit plus cette érudition du grand Savoir très utile à la nation. Nous sommes, avouent-ils, dans l’impasse de cette mauvaise passe qui nous éloigne davantage du Savoir et de ces valeurs hautement significatives propres à cet enseignement de haut rang que savaient si bien nous prodiguer cette race d’enseignants de valeur inestimable et incomparable, aujourd’hui absente à jamais de nos établissements scolaires. La perte ne peut être qu’énorme au vu de ce grand ratage et plus grand dérapage de tout un haut aréopage de carriéristes ministres de l’Education, devenus plus persistants avec la disparition en cascade de ces figures de proue du Savoir dans toute l’étendue de sa grande dimension. -
Vestiges d’hier, trésor de demain !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 3 commentaires
 C’est, dit-on, de ses cendres que ressuscite le phoénix ! Egalement, de ses expériences et découvertes récentes que ressurgit inévitablement la science ! De ses échos favorables que continue encore à vivre la rumeur ! De ses vieilles archives et menus indices que renaît toujours la vérité !
C’est, dit-on, de ses cendres que ressuscite le phoénix ! Egalement, de ses expériences et découvertes récentes que ressurgit inévitablement la science ! De ses échos favorables que continue encore à vivre la rumeur ! De ses vieilles archives et menus indices que renaît toujours la vérité !De ses convulsions et soubresauts continus que se nourrit la propagande ! De ses anciennes pages expérimentales que se conçoit la vie, et est généralement perçue l’actualité ! C’est aussi dans ses guêtres que le misérable se retrouve enfin dans son bien-être !
De ses propres lettres que fleurit et embellit à jamais la littérature ! Autrefois, l’Algérien disposait de cette « providence » à avoir en tout lieu et tout espace « cette information à la source ».
Ainsi, le secteur de l’information disposait –si misérable soit-il !- de son support nommé El Moudjahid ; celui de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique avait également son Panorama ; celui de l’industrie métallurgique son Métallo et, entre autres, celui du sport (le MCA) disposait de son Doyen.
Et tout était donc codé et bien décodé, dans un sens comme dans l’autre. Etait-ce le fait même de cet Algérien qui lisait hier encore bien mieux qu’il ne puisse et veuille bien le faire à présent ?
Ou alors est-il devenu à ce point-là si fortement concurrencé par l’apport de cette image électronique et de son imposant impact –souvent instantanés-, très mouvants et bien convaincants, lesquels prennent-ils désormais plus de place et de considération dans le quotidien du citoyen ?
Le livre qui n’arrive plus à nourrir son maître n’est-il alors plus en mesure de rendre ivre de joie comme autrefois celui qui le consulte, à telle enseigne que le lecteur est poussé à donc irrémédiablement divorcer avec ces autres séances de lecture d’antan, bien utiles et très instructives à souhait ?
Pourtant, dans les années chères au « socialisme scientifique ou socialisant », les titres de revues et magazines sus-évoqués défiaient cette censure officielle qui les guettait en tout coin de rue ou du coin de l’œil, pour souvent les pousser à donner le meilleur d’eux-mêmes et à y découvrir la pleine mesure à ce talent prouvé de ceux qui les remarquablement rédigeaient et éditaient.
Fortes de leur potentiel culturel et animées de ce professionnalisme souvent osé, ces compétences établies et bien prouvées mettaient donc à portée de main cette nécessaire information au profit du citoyen algérien, malgré la bonne garde et totale surveillance, toujours aussi sévères et permanentes, de ces gardes-chiourmes de l’information nationale.
Et seul El Moudjahid, organe central du parti unique, faisait exception à cette règle. Puisque l’autocensure y était cette fonction régulatrice de l’information bien avant même qu’interviennent à leur tour ces autres barrages et différents filtres de tous les calibres scripturaux.
Ainsi, à l’heure où Promesse distillait ces textes succulents d’artistes de la plume en herbe, aujourd’hui, tous écrivains confirmés, sous l’œil correcteur et bienveillant du grand poète et érudit auteur Malek Haddad, faisant habillement ce lien nécessaire entre « l’élève et la leçon », « Sciences Sociales Panorama* » publiait déjà, sur un autre plan, ces autres études et réflexions de choix, portant sur des domaines très variés et bien complexes de la science, expérimentation des connaissances à l’appui !
Panorama fut donc cette revue trimestrielle, consacrée aux sciences sociales, éditée sous l’égide du ministère de l’Enseignement et de la Recherche scientifique.
Son premier numéro, datant de septembre 1979, présente à ses lecteurs une dizaine de réflexions et d’études scientifiques, dont deux mémorandums de colloques, une note de lecture et une contribution dont le texte est transcrit dans la langue arabe, portant sur le thème :
« Poésie ancienne et philosophie ».
Ont donc contribué à l’écriture des dossiers de ce numéro inaugural, d’éminentes matières grises et d’érudits hommes de science, de pensée et de réflexion, aux côtés de certaines plumes affirmées et bien confirmées, ainsi qu’un théologien de grand talent et envergure, traitant, lui, d’un texte d’Histoire parmi celles des plus anciennes de l’Algérie de l’époque berbère.
Tour à tour, ce sont donc des noms imposants comme cheikh Bouamrane, feu Abdelmalek Sayed, Benattia Farouk, Boutefnouchet Mostéfa, Ould Henia Baghdad, Kouribaa Nabhani, Dhina Attalah, Nacib Youcef et Rachid Mostefai, qui intervenaient, chacun dans son domaine, expliquant et explorant ces chantiers et champs d’intervention assez complexes et par trop compliqués.
Invités dès l’entame de ce premier numéro de la revue, des professeurs de renom dans des spécialités aussi pointues que sont la sociologie, l’urbanisme, la démographie, l’aménagement de l’espace, l’ethnologie, la prospective, la structure familiale ou la poésie ancienne, donnent déjà un aperçu assez éloquent sur le niveau très relevé de ces contributions, tenant compte très particulièrement de la valeur intrinsèque de leurs auteurs.
Cependant, un sujet assez insolite devait attirer mon attention. Ainsi donc, cette intervention « lumineuse » sur ce projet de « village solaire intégré », œuvre somptueuse de Baghdad Ould Henia, ingénieur enseignant à l’EPAU (Ecole supérieure polytechnique d’architecture et d’urbanisme), est donc à considérer comme une innovation en la matière à cette époque-là. L’auteur aborde donc sa réflexion par un préambule assez exhaustif des caractéristiques climatologiques et géographiques du pays et qui met en avant cette possibilité de lutte contre la sècheresse, l’érosion du sol, la désertification et l’exode rural.
Il arrive à cette conclusion que « la technologie solaire est en mesure de produire le miracle et d’apporter une réponse pour lever le paradoxe, comme ce fut le cas pour l’énergie gazière ».
 L’ensoleillement exceptionnel (une luminosité de plus de 300 jours dans l’année) est, dit-il, une donnée fondamentale dans la réalisation de ce projet d’envergure.
L’ensoleillement exceptionnel (une luminosité de plus de 300 jours dans l’année) est, dit-il, une donnée fondamentale dans la réalisation de ce projet d’envergure.
Il en situe cinq objectifs à graduellement atteindre :
1 – L’évaluation des possibilités par les énergies douces et à tester leur degré de fiabilité dans la satisfaction des besoins globaux d’une communauté aussi significative qu’un village agricole*.
2 – Esquisser une contribution concrète à l’opération des 1 000 villages socialistes agricoles.
3 – Intégrer les recherches menées dans les différents centres de l’ONRS** dans le cadre d’un même travail multidisciplinaire visant à la réalisation d’un même objet : le village solaire.
4 – Etablir un bilan exhaustif de l’opération.
5 – Tirer les renseignements pour la réorientation de la recherche dans le sens le plus approprié de manière à pouvoir généraliser les énergies douces à toutes les régions du territoire national.
A ce titre, il avait été retenu quatre macrosites que sont :
- Oued Rhir dans les Oasis, entre Tougourt et Biskra.
- Aïn Sekhouna, dans la wilaya de Saïda.
- Ouled Touil, dans la région de Ksar Chellala, à cheval sur les wilayas de Tiaret et Djelfa
- Le Hodna, dans la wilaya de M’sila.
Il aura à conclure sa réflexion, en ces termes assez éloquents et très convaincants :
« L’avènement du solaire pourrait apporter de profonds bouleversements dans la manière de structurer et d’aménager l’espace et des changements radicaux dans le mode de vie, de pensée et du travail.
Aux « Mégalopolis » alimentées en énergie par des mégacentrales au combustible fossile ou nucléaire succèderaient, peut-être, des villes moyennes et des villages fonctionnant à l’énergie solaire. L’homme est-il au seuil d’une nouvelle ère, celle de l’énergie solaire ? »
Ce projet datait donc de la fin des années soixante-dix du siècle dernier. Depuis, il s’est écoulé près d’un demi-siècle (quarante-quatre ans plus exactement), sans que cette idée lumineuse ne fasse son chemin.
Il est donc tout à fait naturel que l’on assiste, à présent, à toutes ces répétées ou intermittentes coupures d’électricité, à tous ces fâcheux désagréments, à toutes ces nuits sombres ou passées dans le noir.
Notre ingénieur enseignant était-il si hors sujet ou en hors-champ pour que sa formidable réflexion soit pour autant totalement ignorée, durant cette longue période ?
La nouvelle ère, celle de l’énergie solaire, semble donc être toujours hors de portée des Algériens.
Panorama avait donc vu juste. C’est plutôt le signal qui n’est pas arrivé à ceux d’en haut. Ces idées géniales d’hier ne constituaient-elles pas cette chance encore une fois ratée par les Algériens ?
Par manque de vision claire, ne sommes-nous pas encore et toujours dans l’attente de cette luminosité naturelle pour éclairer juste nos lanternes ?
Des archives pareilles montrent toutes à quel point on avait volontairement ou intentionnellement dévié de ce droit chemin. Aujourd’hui, celles-ci s’imposent avec force arguments à tout leur monde. Elles constituent ce trésor de données à désormais davantage les consulter afin de mieux être persuadés du bien-fondé de leur indéniable utilité.
Ces vestiges-là ne constituent-ils pas notre trésor de demain ? A charge pour nous de naturellement, cette fois-ci, bien ou mieux les considérer.
(*) Villages regroupant des attributaires de la révolution agraire propre au socialisme des années soixante-dix.
(**) Office national de la recherche scientifique. -
Le haut niveau et le bas de gamme
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 2 commentaires
toutes les autres voix discordantes ou dissonantes. Il faisait à sa manière dans la critique, lui consacrant juste un espace sous forme de billet dans sa dernière page.
L’espace comptait pour moins qu’un réduit dans notre immense Sahara, et il aurait fallu tout le grand talent d’un rusé chroniqueur afin de pouvoir l’utiliser à bon escient et l’exploiter convenablement. Face à ce tout petit cagibi, perché très haut dans un endroit insignifiant et presque caché, d’une surface totale de 25 cm2 environ, il fallait user de l’immense talent de Boussaad Abdiche pour pouvoir trouver la brèche hypothétique à faire passer en même temps que le texte qui faisait rire ce message à grande portée politique, né de l’image véhiculée en arrière-plan de l’écrit considéré.
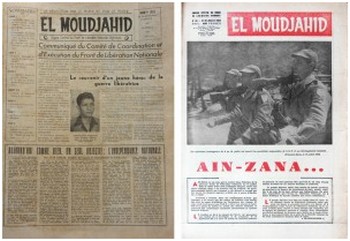 La gymnastique était de taille mais Abdiche, non plus, ne manquait pas de génie. Comme un prisonnier à l’étroit dans sa cellule, il arrivait tout de même à faire rigoler son monde et lui faire surtout passer un autre message entre les lignes. Beaucoup de jeunes accros au sport, faute de mieux, n’attendaient que son message dans le ‘divers’ du quotidien officiel, autrefois peu avare en mots qui intéressaient la basse-société, connue alors sous l’appellation de la classe prolétaire.
La gymnastique était de taille mais Abdiche, non plus, ne manquait pas de génie. Comme un prisonnier à l’étroit dans sa cellule, il arrivait tout de même à faire rigoler son monde et lui faire surtout passer un autre message entre les lignes. Beaucoup de jeunes accros au sport, faute de mieux, n’attendaient que son message dans le ‘divers’ du quotidien officiel, autrefois peu avare en mots qui intéressaient la basse-société, connue alors sous l’appellation de la classe prolétaire.C’était cette théorie de Marx qui ne nous quittait qu’à la tombée de la nuit, pour nous revenir illico presto à la moindre insomnie. Nous y étions tous réglés pour, et il fallait l’ingurgiter même si elle nous restait en travers de la gorge. C’était le parti-Etat ou l’état du parti qui voulait ça. Et nul ne pouvait déroger à cette règle bien générale. Boussaad Abdiche s’y conformait dans ses écrits, arrivant quand même à trouver cet espace nécessaire, lequel à la fois distrait et instruit, divertit et déglutit, construit et instruit, ne dérogeant pas à la règle ni ne dérangeant la haute sphère, puisque s’inspirant de l’usage des fables et des insinuations difficiles à pouvoir être décodées ou décryptées
On trouvait notre compte. Lui également. Le journal marchait bien. Le message du chroniqueur aussi. Le billet se monnayait contre argent fin et métal précieux. Sa cote ne cessait de monter jour après jour. Sa plume était en or pur, ne ratant jamais sa cible et ne faisant nullement dans les décors. En deux très courtes phrases, il arrivait à dire l’essentiel d’une synthèse de tout un livre ou même parfois tracer l’itinéraire d’une vie entière. Ce confrère était un journaliste très habile, très conscient de l’utilité de la portée de ses billets et de la profondeur des remous qu’ils suscitent ou provoquent.
Il avait le flair d’un chien de chasse très adroit dans la récupération de son gibier, en plus du sens élevé de cet humour qui vous fera désopiler la rate même dans votre tombe. Ce furent probablement ces deux qualités littéraires qui bernèrent longtemps nos hommes politiques de l’époque lesquels le laissèrent faire, emportés tous par l’euphorie ou la joie immense que provoquaient chaque jour ses délicieux billets. Lui, en vieux singe, montrait ses dents de lait pour en dissiper le contenu ‘’plutôt dangereux’’ du billet la veille pondu ou celui paraissant au petit matin du jour suivant. Sous le couvert de l’amusement, il jouait à son numéro, se jouant de tout son monde !
Et s’il était payé comme pigiste, il aurait certainement crevé bien avant même cette fin de mois synonyme de la solde. Tant l’encre qu’il aura gaspillée n’aurait probablement jamais suffi à faire une grosse tâche sur un cahier d’écolier tenu par un tout médiocre élève. Il savait qu’il faisait rire son monde d’en haut, raison pour laquelle il ne manquait pas d’interpréter la vie bien autrement en faveur de l’autre monde situé, lui, au bas de l’étage du long escalier social de l’Algérie.
Ce fut donc ce haut niveau du message extraordinairement pondu par le billet du chroniqueur qui tranchait fondamentalement avec cette maladroite manière de communiquer du journal. Ainsi, juste une opale en papier brillait de tout son luxueux éclat sur tous ces galets, faisant de l’ombre sur l’ensemble du fleuve qui les charriait. L’artiste prenait souvent à contre-pied tout son monde haut placé grâce à ses pirouettes littéraires qui le déroutaient, l’envoyant sur le pré cueillir ses magnifiques roses pour un bon moment avant de revenir à lui-même.
De sa toute petite lucarne, misérable prison littéraire, il nous alimentait en ces jets de lumière et d’encre scribouillée qui nous donnaient des airs de folie, de liberté et de joie immense de vivre, bien durable. Il était notre conteur, le sage du village, le véritable expert en la matière. On l’écoutait parler à distance et s’impatientait de renouer avec son article du lendemain. On n’ouvrait pour ce faire même pas le journal. On allait directement à cette page 24, en retournant carrément le fameux quotidien.
A lui seul, il symbolisait toute l’opposition au sein de ce journal où il était –il ne faut tout de même pas l’omettre- pratiquement impossible de placer le moindre signe de travers, encore moins d’utiliser ce fameux journal comme une quelconque tribune politique ou même médiatique au service d’intérêts étroits ou personnels. Boussaad Abdiche y était comme un somptueux coq. Bien hardi ! Seulement dans son tout petit et étroit poulailler, et sans la présence de la moindre poule. Il hurlait son malheur, ruant sur son brancard, avec comme seul support la minuscule tribune de son encart, cadré et bien encadré.
Il y était donc tous les jours, là, armé de sa seule plume qui versait son encre, couleur miel-fiel, afin de distraire avec ces autres gens haut placés et nous inspirer, nous autres, dans notre quotidien évanescent et déliquescent. Il savait nous emporter bien loin dans sa magique et très fouillée imagination, jusqu’à faire en sa belle compagnie ce grand et plaisant trajet au
travers de toutes ces longues travées de notre immense univers. Parfois, à la cadence de ses saccadés vers ! Il y était génial et bien impérial. Puisque sachant dire beaucoup de choses en peu de mots. Dans son réduit espace de communication. Avec beaucoup d’art et non moins de métier, il nous tenait en haleine, maitre de notre destination. Sans la moindre obstination de notre part. En toute compassion avec notre malheur continu. En toute circonstance et parfaite connivence.
On y était, nous aussi, bien branchés. Très convaincus de ces dits, déballés à moitié-mots, faute d’espace nécessaire justement. Le talentueux billettiste ne manquait pas de cet humour corrosif qui faisait, à lui seul, toute la différence par rapport aux autres, le plaçant bien au dessus de tout son monde. Tant ses menus et très brefs écrits étaient d’une excellente qualité linguistique et littéraire, en plus des messages très puissants qu’ils dégageaient ou suscitaient. Ses billets étaient tellement concis et précis mais très bien écrits que nous, ses lecteurs attitrés, les attendions toujours avec cette patience d’un loup affamé guettant au loin le moindre mouvement de sa proie préférée. A mesure que le temps s’égrène, ils deviennent encore plus succulents, ayant entre-temps bien mûri à l’ombre de l’absence prolongée de leur maitre, depuis disparu de la circulation et nous léguant en guise de trésor ses phrases devenues bel et bien éternelles.
De mémoire de jeune cadre que je fus à l’époque, je retiens deux de ses nombreux billets, qui me procurent encore à ce jour toute la sensation que j’éprouvais si bien autrefois. Sous le titre de la responsabilité, il écrivait un beau jour : « Elle est comme une rose. Ceux convaincus de sa vertu l’arrosent tous les matins. Les autres s’empressent déjà de la cueillir toute verte ». Plus tard ou bien plus tôt, je ne sais vraiment l’ordre chronologique de la parution des deux papiers, il titrera son billet par ‘’Le sous-développement ». Le texte était ainsi conçu : ‘’ Une ribambelle de garçons mal lavés qui courent les rues, cela fait déjà tiers-monde …
 Un amalgame de voitures luxueuses qui n’arrivent pas à démarrer faute de route, cela fait tout juste sous-développement… !’’. Près ou plus de trente ans plus tard, les deux textes considérés, même très courts et presque télégraphiques, provoquent en moi cette même émotion suscitée et éprouvée lors de leur première lecture, comme le jour de leur parution.
Un amalgame de voitures luxueuses qui n’arrivent pas à démarrer faute de route, cela fait tout juste sous-développement… !’’. Près ou plus de trente ans plus tard, les deux textes considérés, même très courts et presque télégraphiques, provoquent en moi cette même émotion suscitée et éprouvée lors de leur première lecture, comme le jour de leur parution.Il est ainsi des mots utiles et très subtils qui font vraiment chaud au cœur. Même si on n’est pourtant pas leur seul destinataire. À plus forte raison, lorsque leur auteur aura, entre-temps, tiré sa révérence. Avec son billet, il faisait de l’ombre sur tout un journal et ses nombreuses rubriques, différents reportages et tout un panel de journalistes réglés à l’heure de la politique socialiste d’antan. Il était de ce haut niveau qui tranchait avec ce bas de gamme !
-
Les cèdres : tout est à craindre !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 2 commentaires
 Transmission d'une chronique réalisée sur la cédraie d'El Meddad de Theniet El Had
Transmission d'une chronique réalisée sur la cédraie d'El Meddad de Theniet El HadMême dans son état sauvage, la nature reste captivante, clémente, fascinante, vraiment séduisante et très généreuse. A contrario, tout être humain connu dans cet état isolé et abandonné ou dans cet esprit traversé par ce courant dangereux, ne pense qu’à la détruire pour, au final, inéluctablement se détruire lui-même.
Mieux encore, ceux considérés dans leur mental plutôt comme « très naturels », ne font, eux aussi, parfois qu’emboiter le pas à ces gens un peu assez ou trop zélés dans leurs néfastes attitudes et comportements négatifs.
La nature, au travers de son beau couvert végétal, constitue incontestablement leur véritable souffre-douleur, tous pressés d’ailleurs de la déposséder de ses nombreux atouts, en vue de la dépouiller de son joli manteau, couleur herbacée, porté parfois l’été comme l’hiver, tel ce vert univers qui égaille nos plaines et enchante nos très hauts reliefs.
C’est justement au sein de nos imposants reliefs que le désastre écologique y est bien grand et que la catastrophe naturelle est des plus imminentes. Après ces riches plaines livrées sans merci aucun remord à ce béton envahisseur et très destructeur de notre environnement, voilà que le tour est venu de dévaster notre joli patrimoine forestier.
La forêt du Mont El Meddad qui surplombe imparablement la ville de Theniet El Had compte justement parmi ces autres merveilles de la belle nature, mais qui risque à terme de complètement se dénuder de sa grande verdure et très sobre habit végétal, tissé de cette fibre naturelle assez exceptionnelle.
Emmitouflée dans sa longue combe, creusée tout naturellement dans un relief qui se révèle déjà à fleur de peau, Theniet El Had, discrète et plutôt très inquiète au sujet de son avenir qui tarde étrangement à se manifester, se calfeutre dans ses haillons de très vieux guêtres pour regarder le temps lentement s’écouler, sans pourtant jamais pouvoir en profiter de ses nombreux bienfaits.
De Khemis-Miliana à Theniet El Had, la route qui s’élance et s’enfonce à l’allure d’une hyène vers le sud semble très rude. Sinueuse et nerveuse, elle coupe net par endroits, se trémousse, s’efface ou se retrousse dans ses cambrures, échancrures et autres fourrures de ses belles parures, à la manière d’un agneau gambadant gaiement ou d’un tout petit lièvre qui fait ses premiers pas, en s’adonnant à cœur-joie à son jeu innocent dont sa mère ne peut vraiment suivre la cadence et le rythme imprimés à ses répétés mouvements.
Traversant en coup de vent et à la foulée plusieurs collines et de nombreux valons, elle jouxte par endroits ces cours d’eau de rivières asséchées par mégarde ou par défaut de cette nature humaine qui ne sait malheureusement jamais profiter des indéniables opportunités qu’offrent pourtant ces hauts reliefs en matière d’emmagasinement des fortes chutes de pluie hivernales que connait à profusion cette région montagneuse.
-
Le livre, ses sous et ses dessous !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 2 commentaires

A coup de feuillets effeuillés, il se déclame. Parfois, il se réclame ! Nonobstant le fait qu’il a une âme et qu’il clame qu’il calme ce désir de divertir, au travers des merveilles des mots qu’il suscite, produisant du bonheur et de la joie au lecteur qui le consulte ou l’ausculte, il crée, souvent, cette extase, qui met ce dernier en phase avec son contenu, pour vraiment bien apprécier son quotidien menu.
Il est cet éternel compagnon, enveloppé dans des jolis fanions et très beaux rubans, qui ne dit jamais non à son farouche opposant au plan des idées qu’il distille et analyse avec une très grande rigueur, dextérité et bonne maitrise des mots utilisés et, par extension, des sujets abordés, puisque toujours assuré de le convaincre sans grande peine et sans avoir à le bousculer ou à vraiment l’influencer bien autrement.
Il est chargé de transmettre de génération en génération ce très lourd fardeau et riche trésor que constitue le Savoir dans toute l’étendue de ses définitions, notions, motions, mentions, émotions et grande dimension.
Ecrit d’une main de Maitre, il contient en son sein le génie de ces superbes plumes qui hument à la volée la belle parole et le sens de l’implacable conviction au travers juste des mots qui chantent et des phrases qui enchantent, grâce à leur musicalité, très forte tonalité, légendaire utilité et très grande fertilité.
Il fait honneur à celui qui peine vraiment à lui donner vie et une très juste existence jusqu’à lui assurer, en retour, et sans tarder, cette postérité séculaire longtemps partagée par les citoyens de tous bords et de tous les continents.
Dans la peau d’un enfant authentique, emblématique, charismatique et très « classique », il sait tout faire pour toujours plaire à la fois à son Grand Maitre et à ses nombreux lecteurs, tous pressés de le débusquer et de le provoquer d’un regard effaré et inquiet ou de complètement le dénuder jusqu’à toucher du doigt aux parties intimes du corps des sujets parfois brillamment traités et mis en valeur.
En enfant de bonne famille, il sacralise ce principe de ne jamais, plus tard et une fois bien majeur, lui demander (exiger) sa part à un quelconque héritage sauf celui purement biologique, étant très persuadé qu’il constituera lui-même à travers le temps et les futures générations cet autre héritage culturel inestimable qui profitera à toute l’humanité, sans distinction de race, de territoire et de religion.
Seulement, puisque souvent né sous cet autre toit de la famille hospitalière de « Madame la rotative » où il y aura à faire ses premiers pas et y grandir en futé produit intellectuel sous le
statut et dans la forme d’un vrai pensionnat, il y restera très fidèle, ne sachant par conséquent qui choisir finalement entre sa mère biologique et naturelle et celle d’adoption.
Produit de la grande famille de la belle, riche, envoûtante et succulente littérature, il tachera -sa vie durant- à ne jamais s’écarter de produire ce Savoir et cette formidable connaissance lesquels non seulement unissent entre elles ces deux dernières familles, mais aussi celles-ci au reste de toutes les familles du monde entier.
Dans son légendaire dictionnaire, il aura depuis sa naissance à jamais banni de son étoffé dictionnaire cette censure de l’information ou autre hypocrisie qui met en doute sa fidélité envers ses nombreux lecteurs, tous considérés sur un pied d’égalité et tous charmés par ce désir immense de le consulter à tout moment, et autant de fois que leur besoin se fait vraiment sentir.
Très soucieux de la perfection à toujours apporter à son art d’exister qu’il réalise par ailleurs avec un grand amour du métier, il ne néglige jamais le moindre détail de nature à mieux faire percevoir les choses de la vie, sinon à bien expliquer les sujets qu’il traite profondément et très minutieusement dans leur ensemble, globalité et grande variété.
A sa toute hâtive consultation, il répond debout, ouvert et présent pour dire vrai justement, mais aussi pour produire séance tenante ou sur le champ cette utile information demandée, accompagnée de ses sources documentaires ainsi que ses différentes interprétations et autres sens donnés à l’expression usitée.
Raison pour laquelle tout le monde lui accorde cette grande importance jusqu’à bien souvent lui consacrer de très prestigieux salons, de cycliques foires, de très relevés forums où se rencontrent et se croisent le fer les plus belles plumes de la planète.
A vol d’oiseau, il parcourt à grandes enjambées ou ininterrompues navettes l’immense planète et son très grand territoire, qu’il visite dans tous les sens et directions, bravant en véritable champion le mauvais temps et autres barrières naturelles et psychologiques, apportant à l’humanité de la lumière dans les idées mais aussi cette nécessaire dose d’espoir qui donne vie à ses nombreux consultants.
Rompu aux grands idéaux des peuples et nations aspirant à leur indépendance que consacre justement la liberté d’expression, il ne compte que des amis parmi l’humanité afin de combattre ensemble leur seul ennemi commun : l’ignorance, en l’occurrence !
Aussi précieux, sinon bien mieux que ces lingots d’or et autres prestigieuses parures dont disposent à satiété les très chouchoutées princesses des Grands Royaumes d’antan, il n’acceptera cependant jamais leur statut incommodant et très dévalorisant d’être tout le temps coffré, inutilement emprisonné, occasionnellement bradé ou même vulgairement échangé suite à un très bête coup de tête !
Des sous tout comme de leurs obscurs et très sombres dessous, il s’en moque royalement ou s’en offusque machinalement ! Il s’en fiche de leur triche à tout le temps courir après ces rusées et très lucratives niches d’enrichissement qui font pousser des ailes à ces nouveaux Seigneurs de riches d’une planète à la philosophe devenue à la longue désuète.
Seul témoin des grandes œuvres et autres choses importantes de la vie de ces très vieilles générations, il en conserve à travers le temps si minutieusement et très jalousement à la fois leurs précieuses archives et utiles documentations, telles ces solennelles déclarations d’où jaillissaient à coup de mots subtilement agencés la liberté des peuples autrefois longtemps opprimés.
A chaque rendez-vous de son habituel SILA (Salon International du Livre d’Alger), il est là à attendre impatiemment ou de pied ferme que son lecteur lui caresse à nouveau les rebords de sa nouvelle tunique de couverture aux couleurs de la saison, enfilée avec grand soin pour l’occasion, l’invitant à y entrer sans frapper et en toute tranquillité !
S’adressant aux riches comme aux pauvres de toute la planète, il leur tient un même langage et les traite de la même façon, n’accordant en revanche ses faveurs qu’à ceux dits privilégiés parmi l’humanité qui en font leur ami fidèle et confident de tous les temps.
Dans sa version papier, forme très traditionnelle, ou encore dans celle dite moderne et très numérique, il ne fait pas de jaloux autour de lui : à la première catégorie de ses lecteurs il refile cette odeur des rotatives qui lui colle au nez, et à la seconde il offre cette commodité à s’en servir à tout moment bien loin de son antre de bibliothèque.
Il est le produit de ces mots sans lesquels la vie n’aurait aucun sens. Il est le résultat de tant de postulats que la mathématique admet dans sa thématique de raisonnement. Il contient tous ces secrets de l’humanité qui font avancer les peuples, se développer des nations.
Continuer à l’ignorer, n’est autre que s’ignorer soi-même ! C’est plutôt s’égarer dans d’inutiles considérations. En tant que créateur de richesses inestimables et de grandes découvertes scientifiques dont profite l’humanité, il reste ce précieux support didactique qui fait vibrer les cœurs, cultiver les esprits, prospérer le progrès et avancer les peuples.
En bon ambassadeur des époques anciennes tout comme des temps modernes, il garde jalousement en son sein ces secrets inviolables qui défient le temps, les royaumes et les gouvernants.
Quoiqu’on dise quoiqu’on fasse, il restera toujours ce témoin privilégié des temps anciens qui nous fera tout le temps face, arguments à l’appui !
Et quelque en soit son prix, il n’est jamais évalué ou estimé à sa juste valeur ! Inculquer le Savoir est cette noble mission que tout l’or du monde ne saurait égaler.
-
Les raisons d’une comparaison
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 2 commentaires
***
Madame Taubira, l’ex Ministre de la justice au gouvernement français, est donc rentrée chez elle à vélo, tout en pédalant, en quittant à sa demande, cette haute fonction étatique. De plus, ce fut cette même bicyclette qui figurait dans sa déclaration de patrimoine d’avant sa prise de fonction, il y a juste une petite brochette d’années.
De l’autre côté de la Méditerranée, en Algérie plus particulièrement, non seulement on n’a pas –sauf rares exceptions- ancrée dans nos esprits, pratiques et autres mœurs politiques cette haute culture de la démission et de la déclaration plutôt très sincère du patrimoine, mais, en plus, on prend souvent le temps et le soin de longtemps garder sur soi à la fois les clefs du véhicule de service mais aussi celles de la villa occupée pour les mêmes besoins !
La première –même à distance- vivait donc toujours parmi les basses catégories de son peuple, et elle y retourne présentement, toute contente de le servir désormais à plein-temps, aujourd’hui qu’elle s’est totalement libérée et complètement débarrassée de cette casquette qui l’occupait et l’indisposait bien souvent le côtoyer, en l’accompagnant encore plus longuement dans son quotidien, dans ses espoirs, dans ses menus mouvements, dans ses préoccupations et autres perspectives d’avenir.
Ce lien solide et indéfectible qui la liait sans discontinuité et sans la moindre barrière psychologique au petit peuple, n’ayant jamais entre-temps été rompu ou interrompu, lui permet cependant de reprendre de façon permanente la place qui lui sied et de continuer leur combat commun, à l’effet de faire triompher les mêmes valeurs sociétales que sous-tendent des objectifs préalablement établis et définis dans le temps.
Ce juste retour de l’élément à son groupe d’appartenance ou d’origine conforte ce dernier dans sa cohésion, union et organisation pour cimenter à jamais la relation de l’individu avec la communauté, et de faire pérenniser des valeurs sociétales très anciennes.
Dans l’autre cas de figure, celui purement algérien, cette ancestrale liaison et très féconde relation, entre ces deux composantes ou entités de la même société, n’a nul droit d’exister, dès lors le grand commis de l’Etat, aujourd’hui démis de ses fonctions ou ayant consommé son mandat, a depuis déjà très longtemps décidé de ne plus rejoindre sa grande famille politique et les siens ni même encore ce tout petit peuple avec lequel il aura auparavant vécu et appartenu ou alors celui qui l’aura un jour bien élu et porté aux nues !
Dans son subconscient, tout retour à la case de départ ou à cette basse société est un véritable retour à l’enfer de la mouise, à la hallucinante hantise, au douloureux passé, à cette histoire de misère, à une page usée qu’on a déjà refermée ou complètement déchirée, à un ancien conte qui n’est plus désormais d’actualité, à un sujet largement dépassé autant dans le temps que par les évènements …
Une récente étude dans ce domaine n’a-t-elle pas révélé à l’opinion publique que sur les 700 ministres qui ont eu à gérer les portefeuilles de la gouvernance du pays, plus de 500 d’entre eux se sont de leur propre gré expatriés en France et en Europe, alors le restant du groupe réside, lui, au sein de la capitale Alger, tournant carrément le dos au pourtant vaste territoire et autres braves gens de leurs anciens hameaux et tribus !
Mieux encore, tout nouveau sénateur ou récent parlementaire n’est-il pas analysé par nos sociologues comme un potentiel émigré, intra-muros et en puissance, sachant que son passage par la Capitale marquera cette halte, au départ toute provisoire, mais qui s’étalera démesurément et considérablement dans le temps, faisant naitre chez sa toute jeune progéniture ce refus sans appel ou inconditionnel de regagner leur masure au sein de l’Algérie profonde.
En échange à tout cela, l’un et l’autre auront intégré une toute autre nouvelle société qui s’est substituée à celle dont ils sont originaires, vouée désormais à l’oubli ou à la raillerie, sinon bien incompatible avec la réussite de leur modèle de vie et autres projets d’avenir.
Et il est donc normal qu’ils y construisent toutes ces villas belles et très cossues, cet avenir si prospère et y tissent, entre autres privilèges, toutes ces relations d’intérêt qui leur font perdre leurs vrais repères et parfois une si grande histoire.
Ainsi donc se croisent les chemins de celui-ci avec celui-là, celui qui revient à la raison et à vélo aux siens avec celui qui refuse de remettre les clefs de la villa et de l’auto de service en quittant à jamais sa fonction et région d’origine, celui qui se ressource encore parmi ce petit peuple dont il est toujours resté à son écoute avec celui qui a brulé la politesse à tout son monde en changeant de domicile, de statut et de philosophie dans sa vie !
Cependant, la véritable comparaison ne doit pas s’arrêter à ce niveau assez superficiel de la perception des différences nées de ces comportements sus-évoqués et relevés avec beaucoup d’intérêt, dans la mesure où ce sont les raisons d’attachement au peuple qui dictent la nature même de l’attitude fièrement affichée par ce responsable et ce constat pour le moins incompréhensible et accablant de cet autre élus ou commis de l’état.
La leçon que nous enseigne cet ex garde des sceaux, de retour aux siens à vélo à l’issue de sa démission pour raison d’incompatibilité de sa fonction avec ses principes, traduit une très forte notion de moralité aux sens multiples des valeurs humaines et citoyennes qu’elle véhicule comme la retenue, l’humilité, la dignité, la probité intellectuelle, la sincérité de l’acte politique, la continuité d’un combat juste et durable ainsi que tant d’autres enseignements qui vont dans le même sens pour épouser la même portée …
Tandis que celle retenue dans le second cas de figure ne fait, elle, par conséquent, que relever au grand jour cette absence criarde de culture politique qui est à la base de tous ces mauvais comportements humains, lesquels ne cadrent nullement avec les bonnes valeurs sociétales pour ne compter que pour des maux sociaux et attitudes négatives à au plus vite combattre et anéantir de nos manières d’agir et de nous comporter.
A l’origine de cette différence de taille dans le diagnostic de ces comportements humains, il y a donc ce retour obligé et surtout fondamental au peuple ou au simple citoyen quant à l’exercice de tout acte politique au sein de ces pays démocratiques, sans lequel rien ne peut se décider ou se concevoir, se projeter ou s’entrevoir au sujet de son tout proche avenir.
A contrario, dans l’autre société, celle dite sous-développée, tout se programme, se trame, se fait, se défait, se complote, se décide et se comptabilise au dépens, au détriment, dans le dos ou sur le dos d’un peuple visiblement marginalisé, ignoré, timoré, exclu et méprisé par une oligarchie qui profite de cette anarchie pour tenir court la bride à des citoyens longtemps dupés et sous-représentés ; chose dont tiennent beaucoup compte leurs très controversés « élus nationaux » pour ne jamais en référer ou à la limite tout juste le consulter.
À la fois véritable constituant et surtout seul Déterminant de poids considérable dans la vie politique des Grandes Nations, ce peuple dont il est ainsi fait référence au sein de ces sociétés évoluées, ne compte au sein de l’autre équation rapportée aux pays dits sous-développés que pour rien au monde, tant il n’est jamais associé à ces décisions que l’on prend très souvent en son nom !
Ainsi donc apparait au grand jour toute cette différence à faire entre un peuple civilisé et aguerri et cet autre si méprisé et trop avili, entre ce monde évolué et très éduqué et cet autre dévalué et très critiqué, entre cette société moderne et très pérenne et cette autre plutôt encore « indigène » et moins sereine, plutôt vivant à la peine !
C’est à l’aune des progrès qu’ils réalisent que sont jugés les peuples et la grande culture des nations auxquelles ils appartiennent. Et si « Les peuples n’ont que les dirigeants qu’ils méritent », c’est parmi ces mêmes peuples que naissent toujours les véritables héros et grands révolutionnaires qui font avancer leurs pays et prospérer les sociétés modernes.
Tout le secret de la comparaison furtivement tentée dans ce texte à la va-vite esquissé réside dans cette fameuse pédale qui fait progressivement avancer les deux roues du progrès du premier pays cité à un moment où un peuple si ancien comme celui de l’Algérie ne fait que ce rétropédalage qui le bloque si longtemps au sein de cette ère propre au moyen-âge.
Au nord de la Méditerranée, on y va à la force des jarrets ! Sur son rivage opposé, on est encore à l’arrêt !
-
De Hugo à Mitterrand : barbarie et civilisation !
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 6 commentaires
********_********_********_********_********_********_
En signe de commémoration de la journée du Chahid, j’ai jugé utile de la célébrer en lui dédiant ce modeste papier, priant le Tout Puissant de l’accueillir en compagnie de ses pairs en son vaste Paradis.
« Je crois que notre nouvelle conquête est chose heureuse et grande. C’est la civilisation qui marche sur la barbarie. C’est un peuple éclairé qui va trouver un peuple dans la nuit. Nous sommes les Grecs du monde, c’est à nous d’illuminer le monde (…)*.
Ce fut ainsi que s’exprimait Victor Hugo au Général Bugeaud durant la première moitié du XIXème siècle, plaidant nettement en faveur de la colonisation de l’Algérie par la France. Ce sont donc ses notes récupérées, plus tard, par sa femme Adèle qui l’affirmèrent ou le confirmèrent.
Face au fait colonial, l’imminent philosophe et le Grand Homme de Lettres est-il pris en défaut ou à son propre piège ? Face à la droite concurrente et très menaçante, François Mitterrand, cet auteur de pas moins de sept ouvrages, devait, lui, croire dur comme fer en ce slogan « Changer la vie », adopté par le Parti Socialiste Français (PS) en 1972 !
Pourquoi alors Victor Hugo, cet auteur, entre autres,du best-seller des « Misérables » devait-il en exclure le combat de ces autres misérables algériens, si indigènes de leur état-civil et condition sociale, qui luttaient autrefois de toutes leurs forces contre l’occupant français ?
Et pourquoi aussi, François Mitterrand, devenu alors président de la république française devait-il, lui également, en 1981, abolir la peine capitale au profit des français alors qu’il avait même refusé la grâce, en tant que ministre de la justice durant la décennie cinquante du siècle dernier, à des Héros de la Révolution Algérienne qui furent aussitôt exécutés, en dépit des sollicitations et des médiations qu’il recevait d’imminentes personnalités du monde de l’art et des lettres de ces plumes françaises de qualité, tels André Malraux et Albert Camus … ?
Si, au plan de la belle littérature, Victor Hugo est ce grand monument qui a marqué de son empreinte et grande intelligence la culture françaisede son temps et celle plus universelle du monde entier ; sur la question de la colonisation de l’Algérie, l’homme de lettres a eu un tout autre visage ou si étrange comportement qui n’honore nullement cette probité intellectuelle qu’il affichait si aisément dans ses succulents vers et autres magnifiques écrits.
Même son attitude clairement affichée en faveur de la libération de l’Emir Abdelkader après son emprisonnement par Louis-Philippe, à un moment où la liberté lui était promise par ses geôliers, ne pouvait tout de même le dédouaner aux yeux des Algériens mais aussi devant l’Histoire de l’humanité.
La fameuse phrase qu’il devait prononcer à cette occasion : « Si la parole de la France est violée, ceci est grave. » ne lui accorde ou concède, en revanche, sur ce planprécis que peu de crédit, dès lors qu’il envisageait que la France peuplerait la Mitidja, ce grand plateau au milieu de l’Afrique, où s’installeraient des colons civils qu’appuieraient des troupes françaises en nombre suffisant.
Pour illustrer le tout, il prit pour comparaison une lance dont « la manche serait le civil et le fer serait la troupe ; de façon à ce que les deux colonies se touchassent sans se mêler », faisait-il encore remarquer.
En 1862, dans le chapitre des Misérables où il dresse le bilan du règne de Louis-Philippe, Victor Hugo revient encore sur sa parole trahie à l’Emir Abdelkader et, dans sa liste de « ce qui accuse » le souverain, il ajoute la violence de la conquête de ce pays : « L’Algérie trop durement conquise et, comme l’Inde par les Anglais, avec plus de barbarie que de civilisation, le manque de foi à l’Emir Abdelkader. »
Cette condamnation n’en fut, par conséquent, que très discrète, plutôt à la limite du discours politique très hypocrite, devait-on s’en rendre compte avec du recul. Ramenée ou confondue avec ces autres déclarations très colonialistes, faites par lui-même au crépuscule de sa vie, le 18 Mai 1879, lors d’un banquet commémoratif de l’abolition de l’esclavage, l’intervention de ce grand Homme de Lettres devait dissiper tous les probables doutes.
Notamment lorsqu’il affirmait : « L’Asie a son histoire, l’Amérique a son histoire, l’Australie elle-même a son histoire, qui date de son commencement dans la mémoire humaine ; l’Afrique n’a pas d’histoire ; une sorte de légende vaste et obscure l’enveloppe [...]. Les deux peuples colonisateurs, qui sont deux grands peuples libres, la France et l’Angleterre, ont saisi l’Afrique ; la France la tient par l’ouest et par le nord, l’Angleterre la tient par l’est et par le midi. Voici que l’Italie accepte sa part de ce travail colossal. [...] Au XIXème siècle, le Blanc a fait du Noir un homme ; au XXème siècle, l’Europe fera de l’Afrique un monde. ** »
Que vaut doncla parole violée de la France au sujet de la promesse faite maisfinalement non tenue à l’endroit del’Emir Abdelkadercontre cette toute dernière affirmation : « Au XIXème siècle, le Blanc a fait du Noir un homme ; au XXème siècle, l’Europe fera de l’Afrique un monde » ?
Et que vaut aussi, sur un autre plan, cette abolition de la peine de mort destinée à tous les citoyens français contre ce très catégorique refus de grâce manifesté avec une si grande arroganceet grand mépris –afin de leur sauver la vie- à ces Héros de la Révolution Algérienne, qui luttaient courageusement de toutes leurs forces pour l’indépendance de leur pays ?
Dans le premier comme dans le second cas, il est donc question debarbarie d’un peuple et de civilisation d’un autre. Ainsi, la colonisation de l’un serait-elle assimilée à de la civilisation par celui conquiert un quelconque espace alors que la lutte pour l’indépendance de ce même pays conquis par le premier n’est que sauvagerie et barbarie ?!
Aussi, l’invasion des pays d’Afrique n’est-elle pas aussi vue ou perçue que sous cet angle où le « Blanc en fasse du Noir un homme » ?! Le résultat logique obtenu, un siècle plus tard, n’est-il pas que « L’Europe ait fait de l’Afrique un monde » ?! Le siècle des lumières de ce continent ne lui commandait-il pas de faire l’impasse sur cette sombre occupation de cet autre du Sud de la Méditerranée ?
Devant tant de déclarations flamboyantes et tendancieuses ou d’actions discriminatoires et très sélectives qui défient l’évidence même quant à la considération accordée à ces nations jadis colonisées par leurs bourreaux, anciens gouvernants et autres hommes de lettres ou de cour, la seule logique historique se trouve être vraiment impuissante à convenablement dénouer l’écheveau, dès lors que ces derniers se sont soustraits de leur devoir de dire la vérité pour trahir à jamais toute une mémoire collective.
Faut-il, pour autant, considérer séparément et très différemment ces deux hommes ? Sinon admettre qu’ils soutenaient apparemment le même raisonnement et leur seule nation ? Au sujet des causes défendues, de par leurs œuvres ou fonctions, l’Histoire les juge, cependant, comme justement très partiaux ou très injustes à l’égard des autres !
Qu’en juge donc, à notre tour !
Pour Victor Hugo, « Ce fut ce peuple éclairé qui va trouver un autre peuple dans la nuit, c’est la civilisation qui marche sur la barbarie » dans cette perspective de l’éduquer et de le civiliser; la suite ou la conséquence à en tirer se situeront, elles, dans le même prolongement de cette action.
Pour François Mitterrand, il est question de ce même raisonnement, repris aussitôt bien autrement à son propre compte, plus tard, assez fantastiquement paraphrasé par Charles de Gaule grâce à cette citation reprise par son Ministre de la Culture André Malraux : « L’Algérie restera Française comme la France a toujours été Romaine » !
A vrai dire, de Victor Hugo à François Mitterrand, en passant par Charles de Gaule, le raisonnement de la France coloniale au sujet de l’Algérie n’a pas tellement changé ; bien que deux longs siècles se soient déjà écoulés et qu’une toute nouvelle génération, côté français, est désormais au pouvoir.
En d’autres termes, celui qui n’a pu réserver ne serait-ce que juste quelques lignes griffonnées à la hâte à la douloureuse misère que vivait le peuple Algérien dans salongue quête de retrouver au plus vite son indépendance et sa liberté dans son ouvrage intituléLes Misérables, ne peut toutefois restituer toute cette vérité dont est investi tout homme de lettres qu’il fut. Lui manquait-il vraiment du courage pour le faire ? Ou encore de la sincérité dans ses propos et actes ?
Quant à François Mitterrand qui avait choisi, lorsqu’il fut élu à la tête du parti socialiste français (PS) au milieu des années soixante-dix du siècle dernier, ce subtil slogan « changer la vie », bien avant même de sauver la vie aux condamnés à mort de la justice française en abolissant sous son règne et septennat la peine de mort dans son pays, ne pouvait-il pas faire juste un clin d’œil à ces prisonniers algériens que le régime au sein duquel il officiait allait sous peu les exécuter ? Les prenait-il juste pour de vulgaires terroristes ? De simples fellagas ? Ou encore de très dangereux criminels ?
Pourquoi donc ce premier socialiste élu président de la république française au suffrage universel, le 10 Mai 1981, s’était-il tu ou muré dans son silence près d’un quart de siècle auparavant lorsqu’il s’agissait de sauver des vies humaines à des Algériens (ces autres sujets français de l’époque coloniale !) pour ensuite déclarer au soir de son élection : « Les français ont choisi le changement que je leur proposais (…) ? N’avait-il alors rien à proposer à ces indigènes dont le sort n’était autre que la guillotine ?
Déjà, en date du 10 Décembre 1848, Louis Napoléon Bonaparte, le Premier Président Français, ne soutenait-il pas : « Je saurai remplir les devoirs que le peuple m’imposera … Je jure fidélité à la République (…) »
Aussi, toutes ces différentes déclarations ne font nullement référence au triptyque « Liberté, Egalité, Fraternité », principes autour desquels ont été pourtant fondées la République et la Démocratie Françaises.
« Rester fidèle à la République » est-il si incompatible avec la liberté des autres ? A-t-on cette présence d’esprit que « le changement proposé aux nôtres » peut également par ricochet être valable ou se propager aux autres ? « La France a-t-elle finalement illuminé Monde » comme le souhaitait jadis Victor Hugo ?
Comment donc ce génie humain qui a pu si intelligemment transformer la nutrition en gastronomie, le besoin sexuel en sentiment amoureux, le combat en stratégie, l’instinct grégaire en politique, l’eau en lumière, le bois en mobilier, la pierre en statue, le sable en produit de la fonderie, la terre en Paradis, l’image visuelle en peinture, l’abri en architecture, le son en musique, le langage en littérature, le robot en contremaitre, le mouvement en voyage, puisse laisser les peuples du monde se distancer et leur séparation si profondément ou démesurément se creuser dans le temps sans que son apport ne daigne pour autant y remédier ?
Où en est-on donc dans ce rapport de la barbarie avec la civilisation des peuples du monde, des siècles après ces premières invasions ? Chez les peuples autrefois opprimés, la colonisation reste la principale cause de leur sous-développement qui dure encore dans le temps ! Et pourtant, au sein de l’autre camp, on dit toujours être partis chez le voisin d’à côté ou celui plus lointain dans l’optique de le civiliser. De l’éduquer, au moins !
Qui dit vrai ? Et qui ment ? L’histoire n’a-t-elle pas déjà répondu à la question ?
-
Rocher de Sel », entre miel et fiel
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 1 commentaire
________________________________
Bien souvent le coup de hasard n’est que le produit d’un bonus de la providence ! L’apport de la chance à saisir y est vraiment grand. Même si l’impact de la pure coïncidence y est, lui, prédominant. Il reste que l’un ne va pas sans l’autre.
« Les paroles s’en vont, mais les écrits restent ». C’est, en fait, de l’écriteau « INFIRMERIE INDIGENE » furtivement déniché au Musée local de Djelfa que l’auteur –voulant sans doute lui trouver son prolongement dans l’histoire de la contrée- s’engagea dans sa splendide aventure qui le mènera à Ain-Maâbad (Djelfa), pour ensuite se diriger vers le « Rocher de sel ».
Le titre « Rocher de sel » renvoie au bourg de naissance du premier romancier Maghrébin de la langue française*. Il s’agit d’un descendant de la famille Bencherif, portant autrefois le nom de Mohamed Bencherif (1879-1921), capitaine au sein de l’armée française mais surtout doyen des écrivains Algériens.
Il relate un combat pour la vie pour un indigène qui fut le pur produit de la prestigieuse école de Saint Cyr. Mais aussi celui d’une plume d’une grande tente des hauts-plateaux et de la steppe Algérienne. Là où le souffle du vent siffle à pleins poumons et en toute liberté. Jusqu’à remuer dans les regs des terrains ocre et nus qui séparent le Tell du Sahara, la terre arable des plaines intérieures du sable fin du grand désert.
A mi-chemin entre le récit et le roman, le réel et la fiction, la biographie du soldat et le portrait de l’écrivain, l’histoire d’un « valet du pouvoir » et celle d’une plume « plutôt bien indigène », ce Rocher de sel déterre tout un passé d’une famille et sa région afin de faire ressusciter des fins fonds de la steppe la légende du premier écrivain Nord Africain.
Sonder à postériori le personnage central de son roman en vue de pouvoir en constituer une approche qui colle le mieux possible au portrait-type de ce fils de Bachagha, était pour l’auteur de cet ouvrage d’une rigueur telle que la phase documentaire ayant intervenu dans la conception de Rocher de sel paraissait des plus denses, des plus longues, et surtout bien fouillée et très argumentée.
L’idée d’explorer une telle piste –au demeurant pratiquement méconnue même si l’aventure en fut des plus exaltantes- relève plutôt du souci du détail dont fut animé l’auteur du récit/roman, en sa qualité de natif de la région considérée, mais aussi de par son statut de chercheur versé dans le domaine culturel à temps perdu ou à ses heures de repos.
Cet agronome de formation, retraité du secteur public, Ahmed Khireddine, dont le manuscrit de son ouvrage avait été au préalable préfacé, annoté et corrigé par Guy Dugas, professeur
de littérature française et comparée de l’université Montpelier III, avance dans le liminaire de son titre que son « essai est un devoir de mémoire » envers celui qui fut victime comme de nombreux semblables de « l’oubli collectif », fut-il encore cette toute première plume Maghrébine d’expression française, celle venue au monde au cours de la seconde décennie du siècle dernier**.
Déjà, la remarquable préface en situe d’abord et à tout hasard, à la fois, le très dense contenu truffé de son volet documentaire mais aussi la véritable complexité d’un tel ouvrage, destiné avant tout à recomposer le puzzle de l’arbre généalogique de la famille Bencherif, et surtout à l’effet de faire un sérieux éclairage au sujet d’une fine plume des grandes tentes steppiques de nos hauts-plateaux agro-pastoraux.
Selon les termes mêmes de la préface, cet ouvrage « restitue l’oncle à son neveu » et les deux, ensemble, à l’Histoire de l’Algérie indépendante. Il s’agit –poursuit-elle- dans son logique enchainement d’un « travail modeste mais très profond » ; car fort documenté et très fouillé, supports administratifs et photos de famille à l’appui.
Cependant, le préfacier tient à souligner le caractère assez singulier de « la trajectoire complexe de la destinée des grandes familles » qui durent « fréquenter la France au plus près sans forcément trahir leur patrie ancestrale » ; raison pour laquelle il titra son introduction par cette expression plutôt très originale et assez paradoxale : « Réconcilier le goumier et le Moudjahid ».
Dans le cours normal de l’histoire du pays, le combat de la famille Bencherif est étudié et décortiqué sur pas moins de quatre générations astucieusement réunies dont notamment celle du grand-père, Khalifa de son état auprès de l’Emir Abdelkader, de son petit-fils Mohamed, écrivain et néanmoins officier au sein de l’armée française, et de son arrière-petit-fils Ahmed, devenu plus tard Moudjahid mais aussi ex grand commis de l’Etat Algérien, celui désormais libre, indépendant et souverain.
Très souvent, un simple indice aide à remonter de fil en aiguille le long itinéraire de toute une vieille histoire. A l’épreuve du temps, la mémoire se fait manu militari convoquer pour appuyer des documents, confirmer des dires, interpréter des actes, désigner des noms et identifier des lieux, déchiffrer des symboles, traduire des signes ou donner un sens à des insinuations, expliquer des comportements restés ambigus, témoigner des faits avérés, élucider des situations complexes et faire parler des chiffres immuables, des archives très anciennes et des photographies souvent immortelles.
C’est donc à l’épreuve de ce fastidieux projet et non moins fabuleux exercice de conscience, très ambigu et assez compliqué du reste à mettre en harmonie et en œuvre, que l’auteur Ahmed Khireddine s’est consacré, en s’engageant dans son extraordinaire entreprise ayant pout but de faire renaitre à la vie une aussi méconnue plume d’expression française que le temps a malencontreusement ignorée et minorée et très tôt enterrée ou manifestement jetée à l’oubli.
Dans cet ouvrage, l’auteur, fils de ce pays de nomades, un des leurs, parmi ceux très intéressés à exhumer cette grande culture de la région, s’attaque de front à son Histoire ensevelie sous le poids de tant d’années ou perdue au sein de cet immense territoire du « Monde des Grandes tentes ».
Celui souvent tenté de changer à chaque fois de domicile et de faire dans cette obligatoire et permanente « transhumance », en quête de pâturages et de gains substantiels à engranger par ces tribus vivant essentiellement d’une économie agro-pastorale.
Il eut cette ingénieuse idée de faire ressusciter l’auteur disparu –surtout à travers son œuvre pionnière restée plutôt inconnue au sein de sa famille et dans son propre jardin et pays- au prix d’une louable tentative qui aura eu le privilège de recouvrer à la steppe son produit du terroir et label littéraire.
Articulé autour d’une douzaine de thèmes inégalement répartis en termes d’espace qui leur est consacré et un épilogue en guise de synthèse, ce titre est riche de près 280 pages dont quelques unes servant juste de support d’images de famille, réunies et illustrées pour les besoins de sa confection.
Ecrit dans un style léger, plutôt fin, alerte, simple, vif et incisif, propre au véritable récit, cet ouvrage dont la trame a été brillamment imagée, incarne manifestement le métier du journalisme d’investigation confondu avec celui d’un vrai romancier.
Ainsi, les quelques « fragments de la vie de son héros » restés encore obscurs ou « assez confus », faute de documentation, auront été savamment comblés et astucieusement rassemblés grâce à cet esprit purement romanesque au sein duquel l’auteur du Rocher de Sel se découvre cette « noble vocation ».
Pour une première, ce fut une véritable réussite ! Presque totale ! Tant ce travail mené d’arrache-pied en amont a beaucoup servi, grâce à sa richesse documentaire, à dénouer l’écheveau mais aussi à apporter un sérieux éclairage sur une généalogie ayant vécu au cœur d’un combat d’une aussi ancienne Nation qui s’est longtemps battue pour le recouvrement de son indépendance et territoire.
Mohamed Bencherif, né à Djelfa en 1879, petit-fils du Khalifa des Ouled Naïl auprès de l’Emir Abdelkader, est plutôt peu connu dans le monde de la littérature. Bien qu’il fût l’auteur du tout premier roman Maghrébin de la langue française (‘’Ahmed Ben Mostapha, goumier’’), sa réputation ne se situe cependant pas au diapason de cette haute distinction que devrait normalement lui conférer l’encre prolifique de sa plume habile.
Cet indigène privilégié, de « souche vraiment émancipée », dont la famille devait plus tard vivre dans la périphérie immédiate de la Grande Cour du pouvoir colonial, a toujours évolué avec une certaine aisance au sein de la société française, même s’il restera fidèle à la pratique de la religion de ses ancêtres, l’Islam en l’occurrence.
Ce premier livre de Mohamed Bencherif fait l’éloge du goumier. Aussi, autant dans l’histoire racontée à son sujet par Ahmed Kheireddine dans l’ouvrage Rocher de Sel, autant dans celle se rapportant à son grand-père Si Cherif Ben Lahrèche, Khalifa des Ouled Naïl auprès de l’Emir Abdelkader que véhicule une mémoire collective loin d’être éteinte ou affectée par le temps, la mort de l’un comme de l’autre parait des plus mystérieuses et fort énigmatique. La fidélité du premier-nommé à la religion Musulmane tout comme celle de son aïeul à l’Emir Abdelkader peuvent-elles être –à elles seules- les véritables causes de leur disparition ?
L’histoire de la mort suspecte du (tout premier) capitaine indigène de l’armée française comme celle du tout dernier Khalifa de celle de l’Emir Abdelkader (son grand-père) se recoupent et se ressemblent jusqu’à en jeter le doute sur la version officielle de leur interprétation.
Et si le petit-fils est mort en combattant parmi les siens en 1921 cette redoutable épidémie du typhus qui s’est déclarée dans la région de Djelfa, le grand-père, lui, l’aura été semble-t-il au cours d’un guet-apens monté contre lui par les autorités militaires d’occupation.
Faut-il également souligner que le vrai virage de la famille des Bencherif se situe au moment où cet aïeul prit pour épouse une captive européenne convertie à l’Islam. Le brassage des cultures le poussera à plus tard offrir l’hospitalité à Eugène Fromentin, lequel parle abondamment de lui dans son ouvrage ‘’Un été dans le Sahara’’.
Rocher de Sel à qui revient ce grand mérite de recomposer la trame assez dense de l’itinéraire historique de la famille des Bencherif se propose d’interroger les épisodes ambigus de la vie du héros (Mohamed Bencherif) en interprétant sa mort comme du reste celle de son grand-père, grâce à des singularités souvent contradictoires qu’il a su expurger des fins fonds d’une mémoire encore valide au sein de ce pays des grandes tentes.
Sa proximité avec l’autorité coloniale lui a permis de connaitre non seulement le gouverneur général Célestin Jonnart et ses nombreux subordonnés ou affidés mais aussi de grands hommes d’art et de lettres de l’époque, à l’instar d’Eugène Fromentin et Etienne Dinet et autres auteurs de renom. Il en résultera une assimilation presque contre-nature qui expliquera en partie la mort douteuse de ces deux indigènes hors du commun.
Entre miel et fiel, Rocher de Sel est cette fenêtre sur l’histoire de la famille des Bencherif qui puise sa sève (ou réserve) bien loin de cette littérature d’investigation et de régénération du vécu ancien de la région. Il (l’auteur) aura su mettre au goût du jour une époque surannée qui aura manqué de peu d’étouffer une plume aussi célèbre que plutôt méconnue qu’a enfantée la localité de Ain Maabed.
N’eut été la dédicace*** de choix faite par l’auteur de l’ouvrage en l’honneur de son Excellence, Monsieur l’ambassadeur de France à Alger, à l’occasion de la visite de cette haute personnalité diplomatique au lieu de résidence de Mohamed Bencherif, ce livre autrefois étalé à même le sol chez son garde-chiourme de bouquiniste de la capitale n’aurait probablement jamais effleuré ma sensibilité ou attiré mon attention à l’effet de m’imprégner de son contenu et de vous en livrer par conséquent, bien plus tard, mes impressions et commentaires à son sujet.
----------------------------------
(*) – Mohamed Bencherif, premier romancier Maghrébin d’expression française, Saint-Cyrien, capitaine de l’armée française et Caïd de Ain-Maabed (1879-1921).
(**) – Il est l’auteur de :
Aux villes saintes de l’Islam (Paris – Hachette – 1919
Ahmed Ben Mostapha, goumier (Paris – Payot 1920).
(***) – En date du 29 janvier 2011, Son Excellence, Monsieur Xavier Driancourt, était en visite à la résidence de Mohamed Bencherif à Ain Maabed (Djelfa), occasion au cours de laquelle Rocher de Sel de Ahmed Khireddine (Paris- L’Harmattan – 2006) lui fut dédicacé sur site par son auteur dont ci-contre une copie de la dédicace.
-
Du chant du coq et de l’éclat du soleil
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 1 commentaire
________________________________
Beau et coquet, tout vaniteux coq est plutôt tout juste caquet ! Imbu de son beau ramage, il se vante de son magnifique plumage. En un très élégant personnage, Il s’invente une fort impressionnante personnalité pour faire face à toute éventualité.
Au travers de son impeccable apparat, il semble être toujours à la parade ! Il se fait de droit inviter à toutes les très relevées cérémonies ou somptueuses festivités et prend part à toutes les danses des grands charmeurs et prestigieux Seigneurs.
Déjà tout jeune poussin, il s’installe sur scène, s’initie à ce fastidieux exercice vocal qui le fait monter sur ses tout frêles et graciles ergots. Il prétend être le seul à pouvoir diriger l’orchestre de la chorale qui n’accorde aucun intérêt à la morale du groupe dont il surveille ses mouvements d’un œil vigilant. Et sans le moindre filtre du bruit du son qu’il distille comme le produit sonore d’un fifre, il ose déjà occuper le pupitre !
Il est comme enivré par cet opium qui le pousse à très tôt occuper le podium. Il est aussi poussé par les décibels de la mélodie de son cri qui vrille de son bec mouvementé jusqu’à dénier aux instruments de musique la raison de leur existence ou la nature de leur fonctionnalité. Il pense juste au travers de son mélodieux chant conquérir toute l’étendue de son grand univers et pourquoi ne pas en séduire avec tout son monde à l’horizon.
Dans ses exhibitions de l’aurore, son chant manquait plutôt fondamentalement d’érudition, car dépouillé du moindre texte d’appui, au préalable bien élaboré, et qui donne corps au rythme musical savamment déployé. A mesure que la nuit s’enfuit et se replie sur elle-même en se retranchant discrètement au petit matin, levant à la volée son sombre voile, il se met à balayer de son regard tout son grand univers.
Enhardi par son égo démesuré, il se hasarde à jouer à l’impudent effronté, se donnant en spectacle devant ses semblables afin mieux les persuader du nouveau rôle qu’il désire s’attribuer et de l’importance qu’il accorde à son désormais très relevé statut. Et pour couronner le tout, il ouvre grandes ses ailes et se redresse ensuite dans un geste très solennel.
Il semblait faire remarquer au monde qui l’entoure que c’est grâce à son chant matinal que se lève le jour ! Que se dissipent les ténèbres de la nuit ! Que scintillent et brillent les rayons du soleil ! Que réapparait à nouveau, chaque jour, la lumière ! Il en est convaincu au point où il n’accorde aucun crédit ou même très peu d’intérêt au reste des volatiles et le commun de l’humanité.
Selon sa propre philosophie, l’éclat du soleil dépend de la musicalité de son chant matinal. En d’autres termes : sans ses longs et très mélodieux cocoricos point de lever du jour ! Comme si sans son existence c’est la nuit qui s’emparera définitivement du jour pour que le noir des ténèbres triomphe à jamais de la clarté et de la lumière du jour.
Voilà donc où peut mener tout résonnement farfelu d’un coq imbu de ses nombreux atouts, se vantant de son joli costume plumé et duveté, et surtout se croyant au-dessus de tout son monde ou même présumant que tout lui est acquis en toute propriété et sans le moindre concurrent ou opposant.
A mesure que le temps passe et que lui gravit des échelons pour occuper d’autres fonctions au sein du pouvoir du grand poulailler, il se sent déraisonnablement à tout moment pousser ces impressionnantes ailes que nul autre volatile ne peut détenir dans la ferme. Se flatter l’égo est son crédo. Paraitre le plus beau du monde est son seul but. Ravir la vedette à tout son monde est sa politique à long terme. Il en est d’ailleurs très conscient pour tout inspecter et tout surveiller à la ronde.
Plutôt chose vraiment rare, mais pour défendre son groupe et son territoire, il lui arrive cependant de faire la guerre à un inconnu au bataillon ou contre un prétendu conquérant ou très sérieux concurrent. Gagner tous ses combats devient dès lors une obligation. Et même s’il n’y parvient pas du premier coup, il reviendra dès demain de nouveau à la charge.
Cependant, dans l’intervalle s’étirant entre son dernier revers et son tout prochain combat, il s’attèlera à mieux affuter ses armes, à bien affiner sa technique et à surtout très régulièrement peaufiner ses mouvements d’ensemble. Il ira même faire, souvent en groupe très compact, cette grande tournée des Héros de la contrée du pays dans l’habit d’un potentiel vainqueur.
De passage dans ces bourgs embourbés dans leur misère endémique, dans ces bourgades embrigadées dans leur oubli durable, ou au sein de ces reculées contrées de l’Algérie profonde, il se promènera dans la peau d’un tout prochain zaïm, enfilant différents accoutrements, ceux propres à la région visitée, quêtant leur baraka et demandant le grand pardon auprès de ces Maisons de Dieu composées de ses tribus, de zaouïas et de mosquées.
A force de s’attarder à jouer au coq du village, en labourant tous ces gigantesques territoires du pays et institutions religieuses, ne finit-on pas par laisser un peu partout toutes ces belles et nombreuses plumes qui dénudent par leur absence le supposé Grand Seigneur dans sa tentative de monter tel un véritable Roi sur le très haut toit de la demeure convoitée ?
A vouloir autant que faire se peut s’engager dans la voie de ce ridicule qui consiste à « purifier » ou à « réhabiliter » un quelconque coq imbu de son aura par le biais d’une manœuvre de force ou d’un déni de justice dans son « enrobé politique » ne se dirige-t-on pas tout droit dans cette entreprise dangereuse qui polluera notre politique et discréditera à jamais nos lieux de culte, institutions religieuses et valeurs spirituelles sacro-saintes de l’Islam ?
Quel vent ramène-t-il de nouveau ces autres « coqs migrateurs» sur le sol Algérien pour longtemps errer si éperdument, aidé par une solide organisation de souteneurs activant à la périphérie des institutions de l’Etat ou des Maisons de Dieu, déambulant de zaouïas en mosquées, de basses-cours en prés de prêches, de jardins en vergers religieux, de hameaux de la piété en bourgades, de contrées en patelins pieux, de vallons saints en collines de prière, de ce territoire-ci à celui-là ?
Pourquoi donc tous ces grands shows médiatiques ? Et bien maintenant ? A quoi rime tout ce méticuleux et néanmoins savant scénario ? Mais que cherche-t-on à prouver au travers de toutes des grandes randonnées et interminables chevauchées ?
Sont-ils tous ces invités de marque au moins dotés par la Nature de ce chant très matinal à la musicalité chatouillant l’ouïe pour réveiller avec au petit matin le monde de nos campagnes pour aller travailler leurs champs de blés ? Savent-ils au moins pousser aussi haut et à gorge déployée tous ces beaux et très longs cocoricos qui égaillent la contrée et annoncent à coup de mélodies de trompètes répétées le lever du jour imminent ? Sinon font-ils dans cette très cupide « démarque inconnue » qui nous trouble l’esprit ?
Au vu de leur âge jugé comme assez avancé et de leur physionomie, plutôt sérieusement émoussée et altérée par l’effet du temps, l’usure et la fatigue, ces coqs-là, un peu coq de bruyère (le tétras), un tantinet gaulois, dans leur jeunesse vraiment Méditerranéens et à l’origine tous Algériens, ont désormais la base de leur crête trop aplatie, son lob postérieur pendant et le « crétillon » de son fierté presque totalement effacé. A telle enseigne que le support physique naturel, appelé à recevoir le fameux trône, semble plutôt être absent.
Aussi, leurs grandes rémiges sont pratiquement confondues avec leurs rémiges secondaires à cause d’un physique difforme et peu solide. Ne leur reste en bonne place plus que leur barbillon, gardé intact même s’il parait très poreux ou si perforé. Souvent pour se donner vraiment de l’importance ou de l’autorité, ils montent sur leurs ergots, donnent un coup dans la fourmilière à leurs faucilles en actionnant les tectrices de leurs ailes ; lesquelles aussitôt basculent dans le vent pour brasser de l’air tel un avion prêt à décoller.
De très près, on aurait dit –sans le probable risque de nous tromper- que ce produit de la volaille n’a rien à voir avec la famille des galliformes, celle connue sous l’appellation de gallinacée, appartenant au genre Gallus. Tellement tout lui en ne dicte ou annonce la moindre ressemblance avec ce monde ailé, resté cher au poulailler.
On aurait conclu en milieu fermé ou intime qu’il fut le produit d’un œuf à la coquille autrefois bariolée de différentes couleurs afin que la poule qui le couvait, puisse en ces moments-là en répercuter celles-ci sur son plumage sous l’effet de la lumière et de la chaleur de son duvet pour plus tard se revendiquer son appartenance à tous ces pays et contrées du monde qu’il a visités et où il a travaillés.
Et même si l’explication de la transmission de ces couleurs au travers de ces seuls effets et autres reflets de la lumière et de la chaleur de la poule dans son couvoir reste très aléatoire ou peu plausible, il ne peut justement nous avancer nul autre argumentaire relatif à sa grande mouvance et continus mouvements professionnels.
Seulement leurs galops se réalisent sur le sol Algérien en quête de prébendes politiques et de galons religieux manifestées lors de ses tournées au sein de ces « zaouïas lessiveuses de péchés » et de ces mosquées rédemptrices ou tribus régénératrices de leur matrice politique afin de le délester de tous fautes et autres vices commis au préjudice du peuple et de la Nation.
Alourdis de toutes ces nombreuses tares, ils sont incapables de pousser à pleins poumons les jolis cris mélodieux de ces jeunes pousses de la basse-cour. Quant à espérer avec nous convaincre de l’utilité de déclencher l’éclat du soleil du jour naissant, leur vaine tentative risque de les faire tourner en bourrique ! C’est plutôt croire en une vraie utopie ! Au crépuscule du jour finissant, les rayons du soleil peuvent-ils rester toujours aussi ardents ?
De quelque pouvoir et fortune aurions-nous longtemps rêvés et surtout profités, nous repartirons plus que certains le jour venu ou convenu, les mains vides ou bien nues ! De quelque bien avions-nous tout le temps usé ou vraiment abusé –croyant pour toujours le posséder- nous le quitterons sûrement un jour, en partant pour l’au-delà les mains vides ou sans le moindre sou, puisque c’est à Dieu que nous avions –à plus forte raison- nous-mêmes toujours appartenu.
De quelque société ou monde des humains avions-nous ou même aurions-nous voulu nous identifier, pour quelques heures seulement ou même des décennies durant, nous lui cèderons, en dernier lieu, tout ce que nous possédons comme fortune mais aussi tous nos nombreux enfants. Et le meilleur des trésors que nous aurions laissé sur place ou légué à l’humanité n’est autre que celui qui survivra à tout ce que nous avions nous-mêmes bien vécu.
Il sera ce seul survivant de tout ce que nous avions réellement vécu, juste une empreinte forgée dans le temps qui colle à notre peau lorsque notre corps se résumera à quelques menus et fragiles os sous terre cachés !
Chez le monde paysan, tout bourrin qui a quitté de lassitude son attelage –parce que atteint par l’âge de la vieillesse- n’a plus droit à un quelconque harnais. Il sera aussitôt libre de ses mouvements. Le même traitement est d’ailleurs valable pour ces pur-sang Arabes qui ont abandonné les champs de course. Fut-il juste pour une prise de photo de souvenir !
Pour services rendus à la fantasia, aux labours et à la moisson, ils seront préservés des pénibles travaux des champs. Leur place est désormais au sein de la grande écurie de la tribu dont ils auront servi les intérêts, les guerres, les hautes luttes, défendu les honneurs et tout ce qui gravite autour de leur vie ou même parfois survie et postérité.
En ami fidèle du paysan, tout cavalier qui se respecte connait le mérite à accorder à cette monture et surtout son importance dans son quotidien et devenir. Tel un véritable écuyer, il sait qu’il ne vaut absolument rien sans l’apport de ce pur-sang Arabe qui lui fait gagner des titres et vaincre ses plus redoutables adversaires.
Telles des médailles de grand mérite, ils ne seront exhibés, déterrés ou exhumés que comme une preuve de ce vaillant combat pour la vie. Que comme ce triomphe contre des troupes ennemies. Que comme ce souvenir qui nous fait revigorer et surtout avancer dans le temps.
Et tout autre usage nuirait autant à la Nation qu’à la qualité de son écurie ! Autrement, la réputation de la Maison en prendrait un sale coup !
La relève envisagée à l’intérieur de notre poulailler ne déforme nullement la beauté musicale du cocorico matinal du coq de la ferme. Et même si celui-ci précède toujours de quelques instants le lever du jour, il n’aura aucune influence sur l’éclat du soleil. Là où s’arrête justement l’effet du mensonge du coq vaniteux commence alors forcément ce combat pour la vie mené sur un tout autre front par celui bien hardi.
Car le temps est toujours en marche. Sans relâche ! Et l’histoire est implacable dans son jugement. Et surtout sans appel !
-
Ce pays chaoui qui m’a ébloui ! /Par Slemnia Bendaoud
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 1 commentaire
______________________________________

Ce pays Chaoui qui m’a vraiment séduit !
Et pourtant ce n’est pas la première fois que je m’y rends ! Ce n’est, non plus, la première fois que j’y mets les pieds pour une visite des lieux aussi importante ! A mon retour sur ces mêmes lieux, je ne fus que davantage émerveillé par tant de beauté naturelle et insoupçonnable dont je ne savais, à l’époque de ma jeunesse, mieux l’apprécier et surtout considérer à son juste titre ou bien réelle valeur.
J’étais persuadé qu’au sein de la région des Aurès, le bruit de la détonation des armes pouvait rivaliser, en cas de folie, avec le grondement du tonnerre. Et que la défense de la patrie tenait à s’adjuger tous les qualificatifs ou superlatifs propres au courage manifesté par ses vaillants militants et habitants révoltés contre l’occupant français.
Mais je ne savais guère que l’air fluide de la flûte, si mélodieux et à la symphonie très fine à l’ouïe, s’accrochait, lui, à cette dynamique naturelle pour s’inspirer aussi profondément de ce vent très puissant, en embuscade dans la contrée, qui les propulsait aux premières lignes du combat.
Toutefois, avec ce grand recul dans le temps qui dépasse celui imparti à toute une génération, je m’en été rendu compte que cette même flûte, faite à base de ce roseau qui plie mais qui ne rompt jamais, en référence à cette valeur ancestrale reconnue à ses habitants, pouvait désormais imiter ce chant souverain d’un rossignol fou de joie de retrouver sa liberté de donner libre cours à sa Majestueuse voix en cette saison printanière, jugée comme très prometteuse.
Là, j’avoue que la Nature qui a façonné ce monde, à l’identique de sa propre dimension et autres valeurs nominales, ne pouvait se trahir, en enfantant des hommes de moindre calibre, piètre carrure, et de modeste envergure, des gens de second rang ou de bas étage, des rejetons à jeter en pâture ou laisser à l’abandon.
Déjà, à notre accueil au niveau de l’intersection menant à l’aéroport de la ville de Batna, j’étais convaincu qu’on venait de passer entre de bonnes mains. Qu’on allait en un seul saut nous blottir dans le giron de nos hôtes.
En un unique jet nous jeter de toutes nos forces pour nous projeter dans les fins fonds de cette vie des hauts-plateaux typiquement berbères. Qu’on allait de suite fouiller le côté intime et discret de ce peuple chaoui, totalement méconnu par certains membres de notre groupe qui s’y rendaient en de vrais aventuriers.
Tout le reste ou ce qui s’ensuivit tout le long de notre grand séjour, ne pouvait sur tous les plans que confirmer, au détail près sinon avec toute la précision voulue, mes premières intentions et très logiques appréhensions.
Lorsqu’on tient ses menues qualités humaines d’une Nature aussi merveilleuse que très généreuse, en dépit de ce manque chronique de précipitations durant la saison la plus gaie de l’année, on est comme assuré de forcément reproduire ces mêmes valeurs à travers le temps et le cycle continu des générations.
On est comme vacciné dès les premiers jours de notre naissance contre tout ce qui détruit notre culture et nuit à notre Histoire légendaire. Pour vraiment ne prendre comme repère que celui dicté par nos aïeuls et valeurs propres à notre territoire d’appartenance ou de naissance.
Ce dont je ne doutais guère fort justement. Au regard notamment de ces indices qui ne trompent jamais au sujet d’un monde dont le moule de son identité a depuis longtemps banni de son vocabulaire la tricherie tout comme la supercherie, et de son dictionnaire, l’égoïsme et le caractère condescendant et très pédant des êtres humains.
Faire la lumière sur tout ce vrai périple, auquel nous fûmes conviés, revient manifestement à lui consacrer tout un gros volume pour retracer les faits saillants tout comme les évènements marquants d’une visite qui aura eu le mérite de nous ressourcer avec cet inestimable potentiel de notre patrimoine culturel, matériel et immatériel, dont regorgent les différentes régions du pays.
L’endroit du Site ne s’y prêtant nullement pour pareille expédition littéraire de longue haleine, je me limiterai cependant à un simple survol, à l’effet de vous en restituer le panorama le plus fidèle ainsi que l’image, sur le champ mémorisée, qui nous submerge dans toute son envergure et vraie splendeur.
Le Mont Chélia (les Aurès) qui tutoie du haut de ses 2328 mètres d’altitude tout son monde à la ronde, solidement agrippé à ses pieds comme celui à la peine accroché à ses flancs, sinon tout le reste de ceux venus librement peupler ses piémonts, ainsi que ces profonds balcons du Ghouffi (Arris), constituent sans conteste ce Grand patrimoine chasse-gardée de la région, auxquels s’ajoutent, bien évidemment, les légendaires ruines de Timgad et du tombeau numide d’Imedghassen.
Chélia veille, du mieux qu’il le peut, en grande sentinelle sur toute l’étendue de la région et surveille au loin les mouvements suspects de potentiels « visiteurs douteux » qui s’y rendent en véritables conquérants ou vrais espions.
Au moment où El Ghouffi, plus connu au travers de ses balcons où pullulent encore les vestiges de ses très anciennes habitations, a pris, lui, le soin d’ensevelir dans les décors et nombreux plis de son sol à chair ferme sur les deux rivages de son très profond lit tout un très Grand trésor de l’humanité, dont nous tournons, à présent, et bien malheureusement, volontairement le dos.
Quant à ces monuments somptueux que constituent ces vestiges -encore vivants- de ces ruines de Timgad et du mausolée d’Imedghassen, le bruit du moteur de toute voiture qui passe à vive allure à proximité de leur forteresse, s’arrange à volontairement étouffer les gémissements continus de cette Histoire légendaire de la contrée, susurrée au voyageur de passage par ces lieux si anciens, du fond du cœur et à souffles intermittents.
Celle-là même qui crie, de toutes ses forces et à gorge fort déployée, son supplice et grand malheur du moment à ses pourtant fétus mais vraiment têtus arrières petits-fils, lesquels refusent manifestement et si étrangement de lui tendre un tant soit peu l’oreille et d’accourir à son secours.
C’est, en effet, tout un pan de notre culture, très ancienne, qui part en fumée. Toute une véritable identité qui se désintègre et s’émiette au fil des jours, pour disparaitre à jamais. Toute une si vieille et très Grande Histoire qui risque d’être effacée d’un seul trait de plume qui fait dans cet oubli qui tue bien plus que l’arme à feu ou qui obstrue volontairement des vérités tangibles.
A l’image de toutes les contrées de l’Algérie profonde, Batna ne déroge nullement à cette règle, plutôt bien générale, qui tend à réduire les vestiges de notre Histoire à de simples épaves d’une ère désormais révolue ou à de vulgaires reliques d’une période surannée, qui ne compte plus pour son aspect matériel tant recherché et intérêt pécuniaire du moment.
Mais Batna n’est pas uniquement branchée sur cet oubli qui dénigre à la contrée les vrais atouts de son Histoire légendaire. Fort heureusement, l’itinéraire de son tracé de route qui la lie à la ville de Khenchela, sa sœur jumelle, paré de ses nombreux atours, s’interprète tout en musique, et s’annonce en une vraie symphonie de lieux par où l’on doit transiter, si douce et très féconde, juste en prononçant ces noms de villages que l’on parcourt en coup de vent et en file indienne.
Kais, fayes et Boulefrais en font partie. D’autres contrées, disséminées à travers ce territoire des Aurès, se prêtent elles aussi à cette rime au son chatouillant et si chantonnant : Seriana, Merouana, Menaa, Bouzina et Segana, pour ne citer que celles-là.
Depuis que l’eau de pluie y est en partie emmagasinée, grâce à ces barrages de création récente, le pommier a investit les lieux et les rendements de blés sont devenus plus importants. On y enregistre cet intérêt certain et grandissant au profit du travail de la terre.
Et c’est tout ce monde paysan qui revient finalement à sa réelle vocation : à ses premiers amours et métiers de base ou d’antan. En dépit de quelques retouches de pure forme, notre séjour dans les Aurès reste encore gravé dans notre mémoire. Nous ne cessons, chaque jour, de ruminer les succulents moments de notre voyage qui nous a conduits en pays Chaoui.
-
Une randonnée bien ordonnée
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 2 commentaires
________________________
 Autant le Chaoui ne fait qu’à sa tête, autant l’habitant de la région du Haut Chélif est, lui aussi, un vrai entêté ! Le premier plie mais ne rompt jamais, tandis que ce dernier nommé tient à la parole donnée et ne recule jamais ! Les deux tiennent beaucoup à leur caillou de territoire, mais aussi rigueur au temps. Ainsi se perpétue leur souche et se conçoit leur vie.
Autant le Chaoui ne fait qu’à sa tête, autant l’habitant de la région du Haut Chélif est, lui aussi, un vrai entêté ! Le premier plie mais ne rompt jamais, tandis que ce dernier nommé tient à la parole donnée et ne recule jamais ! Les deux tiennent beaucoup à leur caillou de territoire, mais aussi rigueur au temps. Ainsi se perpétue leur souche et se conçoit leur vie.Au milieu de ce monde paysan et rustre, le rythme de leur vie distille à sa manière sa litanie quotidienne qui enrichie leur Histoire, la plus ancienne. Le souffle du vent délivre leurs sentiments, tandis que le soleil, plutôt assez régulier, qui fait dans la région ces va-et-vient incessants, leur procure cette chaleur qui fait chaud au cœur et dont ils en profitent pour la partager avec les Autres.
Chevillés à leur légendaire mentalité de bédouin, ils auront, chacun sur son propre territoire et registre, réussi à s’adapter à cette Nature, laquelle tantôt leur sourit et les nourrit, tantôt leur lance plein-la-figure tous ces temps de chiens qui leur donnent vraiment à réfléchir…
Cette main qui les chérit et nourrit est celle-là même qui leur donne parfois une vraie raclée, avec exceptionnellement une ruine à la clef ! Ils en sont bien conscients et s’y préparent, en fonction des saisons et de leur déluge de pluie, de vent, de crues, de grandes chaleurs et de tempêtes…
Mais tous tiennent à cette générosité exceptionnelle d’une Nature qui donne sans compter, qui leur fournit tous ces fruits, légumes et céréales à engranger, souvent à bon marché, et en quantités industrielles…
Purs produits de ce moule naturel qui a su les façonner à la mesure d’une logique propre au bon sens paysan, ils auront porté à bras-le-corps toutes ces si vieilles traditions qui nous font aujourd’hui revenir à ces temps si anciens dont nous puisons l’essentiel de notre culture.
C’est dans ce contexte-là justement que s’inscrit cette louable initiative d’échanges culturels et touristiques interrégionaux, par associations d’anciens lycéens interposées. Les anciens élèves du Lycée Mustapha Ben Boulaid furent les premiers à donner le signal, en invitant en Avril dernier leurs homologues du lycée Mustapha Ferroukhi de Miliana (Ain-Defla).
A l’automne de cette même année, cette dernière association (ALMF) se devait de lui rendre la pareille. Un programme fut concocté à hauteur de l’évènement et surtout en fonction du rang reconnu à ses invités d’honneur, lui parvenant de l’association des anciens lycéens et collégiens du lycée Mustapha Ben Boulaid de Batna (Les Aurès).
Et ce fut ainsi qu’est venue l’idée de coordonner les travaux de cette randonnée bien ordonnée. Riche en paysages géographiques, espèces végétales et animales, auxquels résiste très peu la tentation du touriste avisé, la région recèle, en effet, d’innombrables opportunités, dont il fallait impérativement en faire le tri pour n’en saisir que ce qui a trait au cachet très particulier du patrimoine et produits du terroir.
Trois grands axes et pôles d’attraction furent donc retenus pour cette très ordonnée randonnée, à mi-chemin entre le vrai périple et la très osée promenade en rase campagne. Le bouquet choisi ne pouvait être qu’un savant mélange d’attirantes fleurs et de belles couleurs, de senteurs du terroir et d’odeurs magnifiques d’une Algérie profonde.
En plus, trois typologies de reliefs et par conséquent de microclimats différents étaient au menu de nos invités Aurassiens. Ils avaient le choix entre ce pays de la montagne (Miliana et le Zaccar, mais aussi Theniet El Had et El Meddad), paysage qui ressemble un peu au leur, celui de la grasse plaine du haut Chélif (Ain-Defla), dominé par un autre type de verdure et de produits agricoles, et enfin celui de Cherchell et sa particularité marine et spécificité historique et aquacole.
Le tout formant un conglomérat de facettes magiques d’une région où rayonnait autrefois, à Mille lieues de sa forteresse, le lycée Mustapha Ferroukhi, fort justement de sa grande stature, haut nichée et somptueuse citadelle Milianaise.
Ses élèves d’autrefois, ayant depuis gardé le contact, renouent avec ces retrouvailles cycliques qui les arrachent à leur quotidien morose ou difficile pour les retremper de nouveau dans leur ambiance de jeunesse, où tout un chacun désire sentir encore à ce parfum de ses vingt printemps.
L’art culinaire proposé à nos invités de marque suivait, lui aussi, cette même logique et itinéraire géographique. Au repas moderne varié et empaqueté du barrage de B’da (Arib – Ain-Defla), allait succéder ce couscous maison fumant d’El Meddad (Theniet ElHad – Tissemsilt garni de viande de bélier), pour terminer avec cette succulente soupe de poisson et ces grillades de fruit de mer de la côte Cherchelloise (Tipaza).
Et le tout était réglé comme sur du papier à musique ; en un magique tournemain qui donnera le tournis à bien d’anciens lycéens, pourtant très habitués à ces sorties en grandes randonnées.
A vrai-dire, même les moments de détente étaient judicieusement exploités, savamment mis à profit. On pouvait aisément passer du théâtre au chant Chaabi pour revenir après au bedoui (bédouin) et au Chiir El Melhoun (poésie populaire) et aux secrets bien gardés du Musée, celui dit moderne ou encore celui de l’antiquité.
Nos invités de marque ont eu à s’essayer non sans succès à l’équitation, à la randonnée pédestre, au tourisme culturel. Ils y ont découvert d’autres types de couvert végétal, autre que celui propre à leur région d’origine, mais d’autres espèces de la flore et de la faune du terroir.
Il y avait un choix en la matière très étoffé et assez varié pour répondre pratiquement à tous les goûts et à tous les désirs formulés ou esquissés. Mais il reste que certains besoins et autres sensibilités happés au vol n’ont pu être satisfaits en totalité, tenant compte de certains impondérables, en dépit de toute la bonne volonté des organisateurs.
Déjà les organisateurs de Batna avaient, « à l’allée », placé la barre très haut. Leurs hôtes du mois d’Avril dernier ne pouvaient, « en retour », que s’aligner sur ce « standard » qui leur fut offert.
Animés par le sens du partage propre à ces contrées du pays, ils espèrent n’avoir épargné aucun effort ni même lésiné sur de quelconques moyens mis à contribution dans le cadre de cette randonnée. Pour le moment, le sourire affiché tant à l’arrivée qu’au départ par nos invités batnéens laisse à penser que leur séjour exprime cette joie commune recherchée de part et d’autre, à l’effet de pérenniser nos relations réciproques.
Le souhait le plus cher des organisateurs de voir se développer pareilles initiatives dont leur apport au profit de la communauté n’est plus à démontrer, au plan des dividendes à en récupérer à tous les niveaux.
Puisse Le Grand Seigneur nous donner encore la force d’aller au plus profond de nos rêves !
-
La chèvre et le troupeau de moutons
- Par algermiliana
- Le 04/07/2025
- Dans Le coin de Slemnia Bendaoud
- 1 commentaire
_____________________________________
La chèvre est cet animal domestique qui lève un peu trop souvent la tête ! Ce qui n’est d’ailleurs pas sans réelle conséquence sur l’ensemble du troupeau. Mais cette attitude-là n’est guère du goût du pâtre de la contrée. Ce qui le pousse bien souvent à la réprimer et toujours la mépriser.
Chez les pâtres des hauts reliefs pastoraux, il arrive bien souvent sinon quotidiennement qu’une solitaire chèvre montre le chemin à suivre à tout un pourtant très fourni troupeau de moutons. C’est dans ses cordes et c’est la topographie même de la région qui le veut ou parfois l’exige.
Lorsque ce territoire qui sert de zone de pacage est traversé par une quelconque route bitumée ou un ruisseau en crue, c’est à la chèvre que revient de droit de jouer le rôle qui consiste à sauter la première cet écueil où roule et coule en abondance ce grand trafic routier ou cette eau de pluie hivernale et souvent printanière.
Du coup c’est tout le troupeau de moutons qui le suivra sans même se poser la moindre question dans son mouvement d’ensemble pour aller paitre plus loin que la bergerie. Tout caprin, comparé aux ovins, est de nature bien malin. Le mouton est plutôt très connu sous l’angle d’un animal bien tranquille et très glouton.
Le berger en est d’ailleurs très conscient mais aussi bien convaincu, lui qui aura à surveiller de près la chèvre bien mieux qu’il ne le fera pour l’ensemble de tout le troupeau.
Mais qu’y-a-t-il de si particulier pour qu’il concentre tous ses efforts sur ce seul caprin, au lieu de plutôt donner plus d’intérêt au cheptel et prêter davantage attention au groupe fort compact des ovins qu’il a sous la main et dans le même pré ?
Tout pasteur en est automatiquement vacciné à ce sujet. A telle enseigne que même les bébés du monde paysan en ont déjà appris par cœur la leçon ! Garder une chèvre unique est déjà en soi une bien périlleuse entreprise ! Quant à en garder ou encore surveiller de près tout un très fourni troupeau de caprins, cela relève, bien évidemment, d’une véritable corvée et périlleuse acrobatie !
La chèvre, ce guide improvisé du troupeau de moutons, leur apporte, en effet, une dynamique de mouvement. C’est elle qui leur imprime la marche à suivre ainsi que la démarche cadencée à entreprendre. Elle n’en mesure toutefois jamais le risque à prendre. Ni ne subit toute seule les conséquences qui en résultent.
Elle ose et propose ces pistes à explorer qui s’écartent de l’itinéraire tracé par le berger pour y foncer ensuite la première, et tête baissée ! A tel point que tout le pourtant très tranquille troupeau se retrouve être soudainement réveillé par la présence même du moindre caprin en son sein ou dans ses rangs.
Elle lui imprime cette dynamique de mouvement d’ensemble qui donnera des sueurs froides au pâtre à qui échoit cette désormais très compliquée charge de les garder. De lui assurer le lieu où il doit paitre ainsi que la sécurité dont il doit en profiter.
Elle passe pour cet animal bien maudit et fort méprisé qui fait courir dans tous les sens et souvent sans raison le troupeau de moutons. Elle dénude les arbres de leurs feuilles et détruit sans ménagement leurs fleurs à l’état bourgeonnant. Et y grimpe à une appréciable hauteur en vue d’atteindre ses branches les plus reculées de son épais tronc mais aussi celles les plus éloignées du sol.
Bien mieux qu’un très puissant bélier, il lui arrive très souvent de très courageusement tenir tête au pourtant redoutable chacal contre lequel elle mène ce combat des braves, pour la vie et celui de la survie de ses tout petits chevreaux, lequel combat mené avec hargne et courage finira toujours par la libérer de sa mauvaise posture ou piètre situation du moment.
Habituée dès son jeune âge à ces écueils de la vie, elle en prend parfois ce plaisir un peu trop risqué mais plutôt exceptionnel. Ou encore ce goût prononcé à se mettre en évidence et à se laisser aller à tester ses réelles capacités de défense.
Sur ce plan-là, il lui arrive de parfois sauver tout le troupeau de moutons d’un imminent danger, d’une très prévisible catastrophe, jusqu’à bien souvent réveiller en sursaut le pâtre de son sommeil diurne, grâce à ses bellement affolés et au bruit de ses coups de cornes répétés donnés à l’animal sauvage qui rode dans les parages à l’affut d’une quelconque proie.
Sur un arbuste, elle est aussi à l’aise qu’un chimpanzé oscillant ou valsant sur ses branchages préférés. A la seule différence que, elle, en mange souvent des petits bouts de branche pour ne laisser à l’arbre escaladé avec beaucoup d’agilité et une facilité déconcertante que le tronc et quelques vraiment robustes branchettes ou très vieux rameaux.
Entre le singe magot propre à l’Algérie et la chèvre du pays, la différence reste plutôt liée à « la conscience de civilité » accordée de droit à celui-ci dans la préservation de tout l’environnement forestier dont fait montre le premier-cité. La chèvre, aux yeux des gardes forestiers, demeure ce danger à extirper des lieux boisés. Cet animal à surveiller de très près. Et pour cause, ces dégâts qu’elle leur occasionne !
Elle saute allègrement par-delà les barricades hérissées d’épines et franchit sans peine les autres haies broussailleuses pour atteindre – parfois au péril de sa vie- toutes les plantes protégées et tous les espaces verts de près surveillés de la contrée.
La chèvre n’est jamais dépaysée lorsqu’elle gravit les hauteurs, prend du plaisir à monter en altitude ou encore grimpe sur les crêtes de ces hauts reliefs. Elle en fait son propre territoire et même son préféré jardin. A telle enseigne que les chemins de chèvres y sont habilement gravés, tous marqués de l’empreinte de son petit sabot et de l’impact de son va-et-vient incessant sur ces lieux rocheux.
Coteaux, collines, montagnes ou même forêts lui sont si familiers. Et c’est là où elle a l’habitude de se promener sans souci. Y faisant ces randonnées à la recherche de sa nourriture (de l’herbe à brouter) ou de l’eau pour se désaltérer.
Pourtant moins tranquille que la brebis, elle demeure aux yeux de la fermière plutôt sa « vache préférée ». Car plus généreuse en production de lait, même si son produit est moins condensé, plus dilué ! Et d’ailleurs la pauvre paysanne l’a toujours élevée au rang d’une véritable vache !
Connue sous cet aspect d’un animal destructeur et grand ravageur des jardins potagers et arbustes en progression, elle reste pourtant ce mal nécessaire au troupeau de mouton ! Cette espèce qui part sans rechigner « aux toutes premières lignes du front ».
A elle seule, elle arrive –par sa façon de mener le bal- à bien modifier les comportements habituels de tout le troupeau d’ovins, leur apprenant avec succès et grande témérité à se hasarder dans ces fugues improvisées ou à encore tenter sans peur d’escalader tous les écueils dressés par l’homme en vue de les empêcher de quitter sans son autorisation la bergerie ou le pré.
Elle les stimule pour se lancer dans cette gymnastique prohibée et les motive à oser toutes ces acrobaties dangereuses et interdites qui nuisent au troupeau et mais également aux intérêts du pâtre. Elle leur confère cette énergie qui les éloigne de leur inertie et docilité à accepter sans rechigner les ordres du maitre des céans.
Tel un vent qui engendre la tempête, elle jette le trouble parmi le troupeau pour le conduire là où elle veut ! Elle le prend en otage pour en faire son seul héritage, comme source de gage, dans ses grandes chevauchées qui perturbent sa quiétude et grande tranquillité.
Plutôt très habile dans ses folles escapades et surtout imprévisibles courses imprimées à tout le troupeau de moutons qui la suivent au pas de charge, le museau humant l’odeur de l’herbe grasse à distance, elle en constitue ce gendarme qui les tient au garde-à-vous, à l’étroit dans tous les endroits, ce guide qui peut mener tout son monde plus loin que l’horizon.
Etant le seul caprin à vivre parmi le monde des ovins, elle aura toujours à se comporter ainsi ou de la sorte. Sans jamais changer d’attitude envers son monde animalier ni même un tantinet déroger à cette ancestrale habitude ! C’est plutôt circonscrit dans le sang et inscrit dans ses veines ! Mieux encore, toutes tentatives de l’en déloger resteront vaines !
Mais dès lors qu’elle met bas à ses tout petits chevreaux, elle fait chambre à part au sein de la bergerie commune et abandonne volontairement le troupeau de moutons pour aller paitre dans le pré en petite famille de caprins ainsi constituée, en marge du nombreux cheptel.
A chaque fois que le troupeau va dans une direction donnée, la chèvre, déjà forte des petits qui l’accompagnent, choisit, elle, le sens qui lui est complètement opposé, donnant au berger vraiment de l’insomnie sinon du fil à retordre pour finalement le pousser à lui consacrer plus d’efforts mais aussi beaucoup de son temps et une surveillance des plus accrues.
Désormais elle n’est plus le chef du groupe, ni même le guide autrefois tout indiqué à ce pourtant très fourni troupeau de moutons qu’elle menait à la baguette et sans grande peine. Elle se désolidarise de cette famille très ovine et la déstabilise pour ne choisir de vivre qu’au sein de celle plutôt très restreinte et peu peuplée, mais caprine de souche.
Plus édifiant encore, depuis cette mémorable journée du 22 Février 2018, tous les moutons sont devenus de droit de vrais des mutants, se métamorphosant en ces bêtes ou sujets impossible à surveiller dans leurs mouvements, pour s’imposer en force à leur monde dans le flux continu de ce fleuve humain, lucide et intrépide, quoique gagné par une colère sourde, afin de jouer à fond leur destin.
Elle mène, dans ces conditions, la vie dure, à la fois, au reste du troupeau, mais surtout à son pauvre berger, lui, qui ne sait désormais plus où donner de la tête. Fort désemparé par cette surprenante scission qui lui donne autant de frissons, il se doit de trouver une solution à ce problème qui lui procurerait du répit : revenir à la case de départ ou encore se passer carrément de la race caprine au sein de son troupeau de moutons.
Que choisir ? Et comment faire ?
Le choix est-il évident devant tant d’impondérables qui donnent autant de soucis au pauvre berger ? Un tel exercice n’est pas donc pas de tout repos pour ce pâtre qui se voit pousser des cheveux blancs à tout instant, malgré son jeune âge, à l’occasion de chaque fugue de sa turbulente chèvre. Il en est tout le temps embarrassé, l’esprit à fleur de peau, à tout moment vraiment dérangé !
Et qu’en est-il donc de ce comportement de race « exclusivement caprine » dans son rapport très particulier avec celui « purement ovin chez le commun des humains » ? Comment donc s’y prendre pour ramener cette unique mais très méchante chèvre au très fourni et bien docile troupeau ?
Le souci de gouvernance des pays sous-développés en fait d’ailleurs tout un programme politique. Car parmi le peuple, ils n’en voient que des chèvres turbulentes ou rebelles, que de potentielles brebis galeuses, que de supposés boucs aux mauvaises odeurs, que de très peu tranquilles agnelles, que des béliers grands bagarreurs, mais rarement d’innocents agneaux en nombre suffisant ou important …
De vrais sujets mais jamais d’honorables citoyens ! De personnes contre lesquelles il s’agit de lever très haut le lourd gourdin mais jamais une population à laquelle s’identifie la nation dont dépend justement sa pérennité ! Un peuple à de très près surveiller le mouvement suspect de son action plutôt qu’un monde très instruit et bien éveillé ou très cultivé !
Leur chèvre, à eux, est donc traitée selon les moyens dont ils disposent et en fonction de la formule jugée la mieux appropriée pour le faire. Elle peut être mise en quarantaine ou encore cloitrée entre les murs de la ferme dont la loge ou le bouge où elle se trouve seront fermés à clef, souvent à double tour …
Sévèrement matraquée puisque violentée à tout moment mais aussi traquée à tous les tournants de la ville, grâce de très vils procédés en vue de la dompter et domestiquer par la force des armes et l’emploi des moyens coercitifs au plan de ses libertés d’action ou celles d’entreprendre.
Sinon bien choyée, flattée et très soudoyée par les sous-traitants de service du Grand Seigneur, selon son apport ou impact réel au bruit de la rue ! Car son comportement suspect ou mouvement de locomotion contaminant est jugé comme très dangereux pour la tranquillité du Grand Palais !
Génératrice de véritables troubles à l’ordre public, elle s’identifie ou est encore considérée comme une vraie menace à la paix sociale ; raison pour laquelle, en haut lieu de la gouvernance, se décident à son seul profit toutes ces « largesses » et « galons de salons » qui lui sont accordées au mépris de la loi, juste pour acheter son silence, simuler son consentement, maitriser l’impact de son mouvement, la corrompre aussi souvent que les conditions matérielles le permettent !
On en fait, bien souvent d’ailleurs, cette improvisée société civile qui vit « au crochet de l’Etat Providentiel », très solidement accrochée aux mamelles de la rente du brut et autres richesses naturelles, souvent bien parallèle à l’autre véritable société civile qui, elle, vit d’expédients ou fouille et retourne continuellement et si profondément les poubelles publiques et les décharges des nombreux déchets des potes du régime !
La « chèvre politique » a plutôt la même toison que tout le reste du « troupeau humain » du pays. D’où cette difficulté à pouvoir convenablement l’identifier au simple regard au regard du seul habit qu’elle porte où celui de l’apparat dans lequel elle est tout le temps pelotonnée et emmitouflée, bien semblable à celui de ses nombreux pairs !
Et pour y parvenir, on s’active, çà et là, à lui en procurer pour lui coller à ses basques ou à ses trousses tout une valetaille de pions et d’espions qui la suivent comme son ombre, qui la « tiennent en veille » ou à une bonne distance du troupeau, et qui surveillent et épient ses mouvements comme ses fréquentations ou lieux visités dans ses menues promenades et autres très régulières activités.
Parler de la chèvre dégage cette odeur qui « sent déjà le bouc » ! Lui identifier un quelconque être humain, même aussi vilain que le tout désigné caprin dans son esprit bien malin, c’est le jeter en pâture à ces vieux loups de l’espèce humaine ! Nul doute qu’il sera dévoré, assaisonné à toutes les sauces, sinon mangé tout cru, tout nu. Et séance tenante !
Du grand plaisir de l’acte de le dévorer, magistralement savouré par son bourreau, le pauvre peuple n’en retiendra finalement en mémoire que l’image surprenante de ses fourchues dents, encore ruisselantes de son jus, au moment où l’ogre humain ouvre sa gueule pour nous découvrir ses crocs en signe de vrai triomphe !
Faut-il encore rappeler que durant la colonisation française, le toubib tout comme d’ailleurs, l’homme de la Loi, de Droit, de la Religion et celui du Savoir, étaient tous traités bien différemment que le commun des mortels. C’est leur métier qui en décidait, outre cette obligation de réserve à laquelle ils étaient astreints.
Mais lorsque le très sage Toubib est pris pour « ce bouc puant » ou encore sa très tranquille et bien gentille consœur qui est, à son tour, assimilée à une « chèvre turbulente » et bien méchante, par une gouvernance qui les tabasse en tout venant et se soigne à l’étranger aux frais du contribuable, c’est la santé publique qui en prend un sale coup. Une sacrée raclée !
Et pas seulement ! Car le mal a atteint toutes les autres corporations, mais aussi le peuple dans son ensemble et diversité humaine. C’est aussi, ou du reste, l’hôpital qui se morfond dans ses profondes douleurs !
C’est la médecine qui regarde avec pitié du côté du cimetière de la cité, les bras levés en l’air en signe d’impuissance ! Contre ce mal sociétal incurable qui freine la science dans son élan et envoie en bloc tout son monde au purgatoire !
Pour rester bien tranquille dans sa bulle, le pouvoir consulte régulièrement sa boule de cristal. Il y voit, à présent, tout au fond, cette chèvre habillée de l’emblème national ! Depuis le 22 Février 2019, celle-ci habite la rue. Elle a décidé d’en faire sa bergerie de toujours. Pour y défiler chaque vendredi, emmitouflée dans les couleurs nationales auxquelles elle s’identifie.
Les tenants du régime ont depuis cette date-là perdu le Nord. Dans leur conscience, ils sont vraiment dérangés. De leur cheptel constitué à l’origine de bien sages moutons, ils n’en comptent désormais que des chèvres folles qui défilent sans discontinuité. Leur docilité s’est transformée en un tournemain en une si étrange insolente attitude qui défie les règles usuelles de leur pourtant légendaire tranquillité !
Ils en sont complètement désemparés. Manifestement très inquiets. Car chaque vendredi, ces pourtant inoffensifs moutons d’hier font monter les enchères, pancartes de prix à débourser en mains, telles des chèvres qui progressent à l’assaut de l’arbre du pouvoir à escalader sans tarder, croyant fermement le dépouiller de tous ses fruits et de son beau feuillage vert.
Telles des bêtes blessées, elles rugissent, et surgissent de nulle part, leurs slogans en avant mis en scène, clament leur colère enjolivée de fiel de très mauvaise odeur lancé à la face du maitre des céans pour désormais l’acculer dans ses tout derniers retranchements. Au motif de leur avoir depuis longtemps manqué de respect et surtout attenté toute honte bue à leur dignité.
Raison pour laquelle elles leur tiennent une rancune si tenace. Sans relâche ! Car dans leur quotidien, elles se sentent lésées, lessivées, vraiment blésées, humiliées, telles des poules mouillées !
Contre le système en place, elles ont cette dent qui se réveille chaque vendredi, furieuse et déterminée, les poussant à crier de toutes leurs forces leur malaise qui dure depuis d’un demi-siècle déjà. À présent, elles veulent en finir, sans jamais avoir à souiller leur dignité ou à se dénigrer.
Ne dit-on pas que le doux agneau d’aujourd’hui sera ce féroce bélier de Demain. Comme quoi : dans le monde des ovins, il existe déjà cette fibre animalière si sensible qui fait la nette différence entre la nature « pacifiste » du groupe du cheptel et l’instinct « guerrier » de toute une population de ruminants qui se sent attaquée, persécutée, terrorisée, humiliée…
Nul besoin donc de s’étonner après que le troupeau de moutons passe désormais à l’offensive et emprunte aux caprins sa qualité d’animal « rebelle » pour complètement abandonner ce cliché de « moutons de panurge » qui lui colle toujours à la peau.
Ni un doux agneau, ni une poule mouillée, ni même un troupeau humain à conduire au pré, le peuple qui manifeste dans la rue, montre aux tyrans du pays la porte de sortie à travers laquelle ils doivent très vite s’engouffrer. Lorsque sa vie est danger, il s’engage pour une lutte sans merci. Il s’agit d’un combat pour la survie.